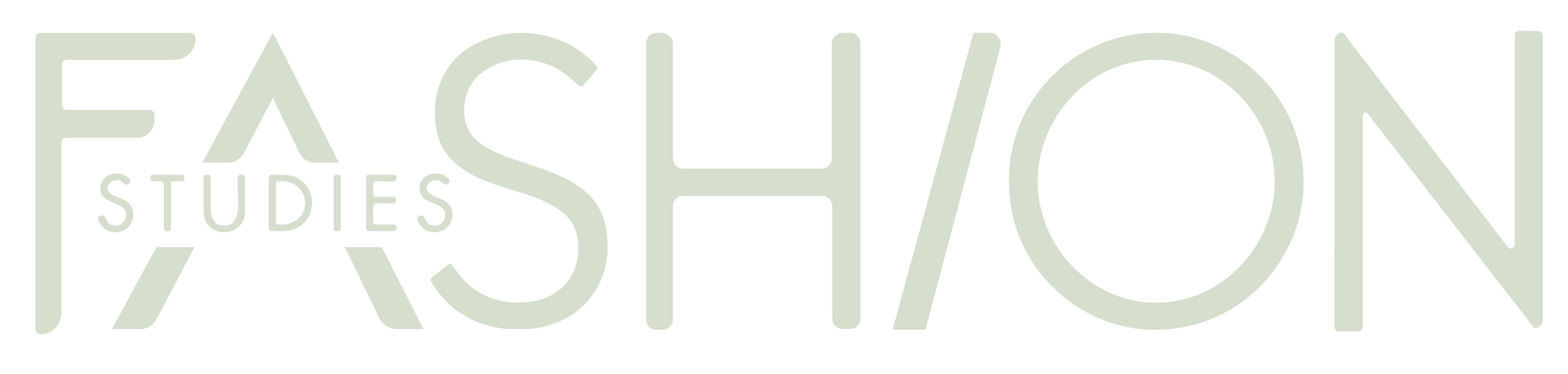Entrevue avec l’artiste 2Fik
Par Youssef Benzouine
DOI: 10.38055/FCT040103
MLA: Benzouine, Youssef. « Entrevue avec l’artiste 2Fik ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 1-18. https://doi.org/10.38055/FCT040103
APA: Benzouine, Y. (2025). Entrevue avec l’artiste 2Fik. Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, 4(1), 1-18. https://doi.org/10.38055/FCT040103
Chicago: Benzouine, Youssef. « Entrevue avec l’artiste 2Fik ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies 4, no. 1 (2025): 1-18. https://doi.org/10.38055/FCT040103
Numéro spécial 3, Numéro 1, Article 3
Mots-clefs
Théories du genre
Masculinités
Art
Vêtement
2Fik
Résumé
Cette entrevue a été réalisée avec l’artiste montréalais 2Fik. J’ai découvert son travail lorsque j’étais en train d’entreprendre les premières démarches de ce qui allait devenir ma recherche doctorale. Son travail m’a particulièrement fasciné, m’amenant à me questionner sur les masculinités et les rapports que l’on peut avoir avec elles. C’est cette fascination pour l’artiste et ses personnages qui m’a amené à faire sa rencontre et à proposer une entrevue dans le cadre de ce numéro.
L’entrevue avec 2Fik aborde son parcours, mais aussi son rapport avec les vêtements et les accessoires. En effet, ces derniers sont au centre de son travail artistique – ce qui explique la présence de cet article au sein de cette revue. L’un des personnages de 2Fik, Ludmilla-Mary, est particulièrement marquant, mélangeant des éléments (voile en cuir, talons hauts, barbe) qui, de prime abord, n’ont pas l’air concordants. Ce trouble de genres – qui ne se limite pas au seul personnage de Ludmilla-Mary et qui est présent de manière extensive dans le travail artistique de 2Fik – rend compte du fait que les vêtements et les accessoires ne sont pas seulement un habillement, mais aussi des signes renvoyant à des catégories plus larges (société, religion, politique, corps). Ainsi, le travail artistique de 2Fik n’a pas seulement pour but de provoquer, mais cherche, fondamentalement, à amener les individus et la société à se questionner. Fondamentalement, 2Fik invite à se demander qui porte quoi et comment.
Introduction
J’ai découvert le travail de 2Fik, par hasard, par le biais d’une simple recherche Internet. 2Fik est un artiste pluridisciplinaire montréalais dont les œuvres sont photographiques ou performatives (« 2Fik Or Not 2Fik » Qui est 2fik? » s. d.). Le questionnement identitaire est au cœur de son travail, notamment en lien avec les questions de genre (2Fik joue beaucoup avec les codes de masculinité et de féminité) ou encore « la race ».
Lorsque j’ai découvert 2Fik, en 2021-2022, j’avais commencé un microprogramme de 2e cycle en études religieuses et participais à un séminaire portant sur les thèmes du genre, de la religion et du féminisme. C’est grâce à ce séminaire que j’ai développé un intérêt pour les études critiques des masculinités (Connell et Messerschmidt 2005; Waling 2019), en particulier les masculinités musulmanes. Mon attention s’est particulièrement portée sur les hommes musulmans vivant dans un contexte migratoire où la religion musulmane est minoritaire. En faisant mes premières recherches par mots-clefs sur mon sujet de thèse, je suis tombé sur le travail artistique de 2Fik qui touchait à des registres croisant les miens (comme la « masculinité » des hommes d’origine musulmane). Cette découverte m’a immédiatement interpellé, me poussant à me questionner sur la définition de la masculinité et à me demander s’il serait possible d’imaginer des masculinités autres qui sortiraient ou se détacheraient des représentations que l’on s’en fait habituellement (violence, agressivité, force, etc.).
Au-delà de la masculinité, on peut se demander quel lien peut exister entre 2Fik et les Fashion Studies. Pour rappel, les Fashion Studies sont un champ d’études multidisciplinaire qui est aussi « multi-dimensional; it is clothing, accessories, body manipulation and modification, makeup, ornaments, life styles, and behavior. [...] It speaks to identities of gender/s, race, and class. » (Paulicelli, Manlow, et Wissinger 2021, 1). Si l’on considère une telle définition du champ d’études, le travail de 2Fik s’y inscrit pleinement. En effet, le « dress » (habillement), référant à un « assemblage of modifications of the body and/or supplements to the body » (Roach-Higgins et Eicher 1992, 1), est au centre du travail de 2Fik puisque ce dernier mobilise des vêtements et des accessoires variés. Ce qui explique la présence de cette entrevue dans le cadre du numéro de cette revue.
Plus globalement, les vêtements et les accessoires sont une partie intégrale du travail de 2Fik : c’est grâce à eux que ses personnages existent et prennent chair. Cela est spécifiquement prégnant avec Ludmilla-Mary, l’un des personnages de 2Fik qui a le plus capté mon attention lorsque je suis tombé sur son travail. En effet, ce dernier m’a fasciné avec sa grosse barbe et son foulard en cuir (voir les images 5 et 6). Non seulement il m’a fasciné, mais il n’a aussi mis mal à l’aise : on aurait dit que j’avais du mal à le catégoriser, tant ce dernier mobilise et utilise différents registres. Ce personnage trouble les genres. Pour quelle raison ? Parce qu’il se présente comme une « femme » ayant une barbe (un attribut qui est lié à la masculinité, entrant en contradiction avec le fait que c’est un personnage qui a l’air féminin), portant un foulard (un attribut qui est lié à la féminité et à l’islam), tout en arborant des robes aux couleurs criardes et voyantes (ce qui capte l’attention). D’ailleurs, par rapport à cette idée de « femme ayant une barbe », il y a toute une longue histoire de personnes qui ont subverti ou désobéi aux normes de genre en lien avec la pilosité. À cet égard, il faut rappeler que l’une des inspirations de 2Fik est Clémentine Delait (1865-1839), l’une des plus célèbres « femmes ayant une barbe » qui a vécu en France.
L’existence de Ludmilla-Mary montre qu’il est tout à fait possible de faire coexister des éléments qui sont généralement perçus comme étant antinomiques ou, du moins, qui ne vont pas forcément ensemble. En effet, Ludmilla-Mary mobilise des éléments qui sont, si l’on schématise grossièrement, à la fois « masculins » et « féminins », « occidentaux » et « orientaux ». De plus, cette mobilisation se fait, par l’entremise des vêtements et des accessoires, sur un corps qui est racisé. Un corps qui est différent, sortant des normes et des standards de beauté qui sont généralement liés à la blancheur (Deliovsky 2008). C’est cet assemblage qui fait en sorte que Ludmilla-Mary suscite cet effet paradoxal de fascination/répulsion. Conséquemment, les vêtements et les accessoires portés par Ludmilla-Mary, loin d’être seulement de simples apparats, finissent par se transformer en symboles sociaux renvoyant à des enjeux plus larges.
2Fik utilise les vêtements et les accessoires non pas simplement pour provoquer ou pour mettre à l’aise, mais pour amener un questionnement. 2Fik questionne différentes choses, notamment la place des corps non blancs dans l’espace public des pays occidentaux ou encore les normes de genre. Il faut rappeler que les vêtements, et aussi les accessoires, renvoient à des normes sociales, dont celles du genre (Barbier et al. 2021; Paulicelli, Manlow, et Wissinger 2021). Ce faisant, les « goûts et les pratiques vestimentaires [révèlent] à condition d’articuler les dimensions de classe et de genre pour les saisir, les déterminismes sociaux les plus prégnants, les logiques économiques et sociales les plus structurelles et les modes de domination les plus naturalisés » (Barbier et al. 2021, 815). En l’occurrence, dans certaines représentations communes occidentales, la barbe, comme accessoire esthétique, est généralement associée à la masculinité (Oldstone-Moore 2018), tandis que, à l’inverse, les talons hauts sont généralement associés à la féminité (Monneyron 2008). Ludmilla-Mary fait exploser ces associations qui ont l’air naturelles et logiques. En brouillant ces associations logiques communes qui sont généralement faites entre les vêtements et les accessoires et le genre (un homme = une personne qui porte une barbe et non une femme), 2Fik amène, selon moi, les personnes à se questionner sur la « naturalité » de l’association sexe/genre (Guillaumin 1978), mais aussi sur la naturalité des associations entre les vêtements/accessoires et le genre.
De plus, 2Fik mélange des vêtements et des accessoires qui ne sont pas, dans l’imaginaire commun, supposés se mélanger. En l’occurrence, si l’on revient au personnage de Ludmilla-Mary, la « barbe », portée par une personne ayant l’air d’un homme arabe ou musulman (Ahmad 2004, 1278), est, dans le contexte occidental, mise en lien avec la figure du « Terroriste » (le « musulman dangereux ») (Selby, Barras, et Beaman 2018) qui symbolise l’archaïsme et la violence. À l’inverse, les talons hauts portés par Ludmilla-Mary sont usuellement vus comme étant un apparat occidental qui symbolise plutôt la modernité et le raffinement. Ces deux éléments sont, d’une certaine manière, antinomiques, n’étant pas censés aller ensemble. En soi, la barbe, les talons hauts, la robe ou encore le foulard ne sont pas problématiques. C’est leur association, sur fond de corps racisé, non blanc, qui est problématique.
Fondamentalement, 2Fik met bien le doigt sur une question cruciale à se poser par rapport au vêtement et à l’accessoire : il faut se demander qui porte quoi et comment. Ce faisant, pour paraphraser Frédéric Monneyron, le vêtement, et j’ajouterai aussi l’accessoire, doivent être vus comme des « élément[s] premier[s], fondateur[s], déterminant les comportements individuels comme les structures sociales » (Monneyron 2008, 10). Ce ne sont pas juste des « habillements », ils incarnent à la fois les individus et la société dans laquelle ils s’insèrent.
Entrevue
Youssef
Peux-tu te présenter brièvement ? Qui est la personne qui se cache derrière l’artiste ? (1)
2FIK
Je m’appelle Toufik mais mon nom d’artiste est 2Fik. J’utilise ce surnom depuis que je suis adolescent donc il m’est paru totalement naturel de le prendre pour me représenter comme artiste. À vrai dire, je signe « 2Fik » la quasi-totalité de mes interactions écrites. Peut-être que 2Fik est en fin de compte mon vrai nom.
Dans tous les cas, la personne qui se cache derrière l’artiste ne se cachera plus très longtemps dans la mesure où l’artiste et la personne sont les mêmes. Je suis inspiré par ma propre expérience de vie et mon art a très grandement impacté ma vie personnelle, professionnelle, sociale et publique.
En quelques mots, je suis un homme cisgenre pédé. Certains considéreront que le terme est offensant mais, politiquement, c’est le terme qui me correspond le mieux. C’est une insulte que j’ai entendue toute ma vie et que je prends désormais comme blason de fierté et personne ne pourra m’en empêcher (rire).
Youssef
Peux-tu désormais plus me parler du parcours de 2Fik ? Comment s’est faite sa genèse ?
2FIK
Tout a commencé en hiver 2005, lorsque je me suis retrouvé dans un minuscule appartement sans salle de bain. Le seul évier était dans la cuisine, la cabine de douche se trouvait dans ma chambre tandis que la toilette miniature se trouvait dans une sorte de placard. Je venais de me séparer de mon premier amoureux et vivais une situation de solitude considérable.
Pour passer le temps, je jouais avec des accessoires que j’avais ramenés avec moi de Paris : des robes, des hijabs, des perruques et des talons hauts. Je créais des mises en scène avec moi-même en portant ces déguisements qui faisaient interagir mes personnages.
Petit à petit, je me retrouvais à prendre certaines attitudes et poses qui étaient propres à certains accessoires. Quand je portais une tagguya (petit chapeau marocain ressemblant à une grande kippa), je jouais le macho. Quand je portais un hijab, je sentais plus une énergie douce, maternelle et sensible. Certaines robes me faisaient sentir féroce et bourgeois tandis que d’autres ramenaient une attitude déjantée et all over the place.
Ainsi, une nuit de 2006 sont nés mes huit premiers personnages : Alice, Abdel, Benjamin, Fatima, Francine, Manon, Marco et Sofiane. The rest is history!
image 1
#Look. ©2Fik. Photographie de Norman Legault.
image 2
#Octoportrait. ©2Fik. Travail artistique de 2Fik.
Youssef
D’où vient l’intérêt pour le vêtement dans ton parcours artistique ? C’est quelque chose qui n’est pas juste essentiel, mais semble même central dans ton travail artistique. On dirait que tes personnages prennent vie notamment grâce aux vêtements et aux accessoires que tu choisis.
2FIK
Exactement, le vêtement est une sorte de représentation de soi pour le monde extérieur.
Pour mes personnages, leur accoutrement représente leur personnalité, tout simplement. Certains sont discrets et basiques, d’autres plus flamboyants et intenses.
Aussi, le vêtement, lié aux différentes pilosités faciales, et aux accessoires pour tête/visage, permet de créer des codes visuels pour les personnages afin que le public les reconnaisse instantanément. Par exemple, Sofiane a toujours un goatee et une casquette, Fatima, elle, porte un hijab.
Youssef
Quels sont les critères que tu utilises pour choisir tes vêtements et tes accessoires ? Est-ce que tu pourrais m’en dire un peu plus sur le processus mental qui t’amène à choisir un vêtement plus qu’un autre ou à combiner des vêtements entre eux ?
2FIK
Je me mets dans la tête de mon personnage afin de l’habiller. Chacun et chacune ont une personnalité, une vie amoureuse plus ou moins pertinente et des ambitions. Pour ce faire, je vais acheter ou trouver des habits qui leur correspondent et idéalement aller les chercher là où ils sont. Alice n’ira pas faire du thrift shopping [magasinage de vêtements usagers], elle ira dans des magasins spécialisés et de designers, c’est une fashionista. Manon, elle, courra dans les espaces de seconde main pour se faire un look bohemian-chic. Marco est plutôt casual chic donc mélangera des pièces de différents styles pour se créer son look.
Le style est quelque chose de tellement fluide et malléable qu’il peut m’arriver de chercher un vêtement pendant des semaines avant de trouver la perle rare. J’ai passé des semaines à vouloir trouver une robe pour Alice dans « 2Fik court la Chasse-Galerie ». Je voulais quelque chose de chic, écolo et visuellement frappant. C’est là où j’ai trouvé cette robe en vegan leather [cuir végétalien] d’une designer québécoise. La robe m’a coûté cher mais ça valait totalement le coup.
image 3
#Transformer. ©2Fik. Travail artistique de 2Fik.
Youssef
Ton travail invite à ce qu’on se pose cette question : qui porte le vêtement ? En soi, il n’y a aucun problème à ce qu’un homme porte un bleu de travail avec des talons hauts. Il y a quelque chose de plus problématique à ce que ces vêtements soient portés par un homme qui a l’air arabe/musulman.
2FIK
Tout à fait, je crois véritablement que mon travail serait perçu de façon totalement différente si je n’étais pas un homme « arabe ». Je ne suis pas Arabe comme tel mais plutôt Berbère du Maroc. Un homme qui me ressemble n’est pas censé faire ce que je fais, cela ne correspond pas à la caricature.
Les artistes qui m’ont précédé et qui m’ont pavé la voie comme Anthony Giolcolea, Samuel Fosso, Cindy Sherman ou Yasumasa Morimura, sont tous et toutes de différentes origines et le public ne peut pas omettre leur image car elle est au cœur de leur travail.
Qu’un homme arabe ouvertement homosexuel fasse un travail sur l’identité, le genre et l’image dès 2005 était particulièrement effronté. N’oublions pas que nous sommes quelques années après les attaques du 11 septembre. L’Arabe était (et est encore) un danger simplement à cause de son faciès. Même problème pour toutes les personnes basanées.
Lors de ma première exposition à New York en 2011, beaucoup de personnes ont questionné la pertinence de mes œuvres par crainte de la polémique. Si j’avais été un homme ou une femme blanche, on ne questionnerait pas la polémique. Cette dernière est donc liée à ma couleur de peau et non à mes œuvres.
Youssef
La première fois que j’ai vu ton travail, en particulier le personnage de Ludmilla-Mary, c’est venu me chercher. On dirait que cela m’a amené vers un espace de vulnérabilité : comment définir mon propre rapport à la masculinité ? Qu’est-ce que veut dire la masculinité ? Est-ce qu’il faudrait plutôt parler de masculinités plurielles ?
2FIK
Il est intéressant de souligner que mon rapport à ma masculinité a énormément évolué entre le début de ma carrière et aujourd’hui. Au début de ma carrière, je sentais une émasculation constante de la part des hommes du milieu gay montréalais : on était dans l’ère du Masc4MascOnly (masculin pour masculin seulement). Il faut aussi garder en tête que je suis un homme maghrébin et que donc tout un ensemble de fétichisations raciales est projeté sur des hommes comme moi : le macho, le dominateur, l’agresseur, l’homo refoulé et marié. Donc, en étant ouvertement pédé et folle, je me suis déjà fait dire que je n’étais pas vraiment un homme car je portais des perruques et des talons hauts.
Une de mes dates a fait demi-tour quand il a vu que je portais du rose, il m’a dit que les mecs ne portaient pas cette couleur, c’était assez hallucinant comme scène. Il est fascinant de voir que la représentation de la masculinité à énormément évolué et c’est assez magique à voir. Cela est dû principalement au fait que l’on ne voit plus le genre comme une chose binaire mais comme un spectre : cela vient casser toutes les préconceptions et laisse enfin de la place aux personnes d’exprimer leur genre de façon plus proche de ce qu’ils-elles-iels sont. Personnellement, je me trouve au summum de ma virilité lorsque je porte mon bleu de travail avec mes talons. Il y a quelque chose de l’ordre de la posture, de la grâce et du statement [affirmation] qui me fait sentir beau et attirant.
Je suis sûr que beaucoup ne seront pas certains de comprendre cette affirmation, mais il est essentiel de garder en tête qu’il faut porter les choses qui nous plaisent personnellement. Je ne m’habille pas pour les autres, je m’habille pour moi et lorsque j’ai trouvé cette combinaison tenue d’homme/chaussures de femmes, je l’ai adorée sur place. Je porte ce type de mélange des genres depuis 2007 environ, que ce soit dans le cadre de mes œuvres ou alors dans ma vie personnelle ! J’ai souvent fait des réceptions ou des vernissages habillé de la sorte. À l’époque, je ne faisais pas toujours l’unanimité. Maintenant, c’est une chose courante et – encore une fois – c’est superbe à voir !
Je veux prouver qu’on peut être perçu comme un danger public (image de l’homme arabe barbu) et en même temps repousser les frontières de la préconception.
Figure 4
#Uniforme ©2Fik. Photographie d’Oscar Heliani.
image 5
# Ludmilla-Mary à Ontario Place. ©2Fik. Photographie de Richard Rhyme.
Youssef
Dans les vidéos où Ludmilla-Mary se balade dans certaines villes, on peut voir des gens intrigués qui s’arrêtent, d’autres qui rigolent et qui commencent à filmer. J’ai l’impression que voir un corps racisé (que l’on va lier à la virilité ou l’animalité) portant des vêtements « féminins » (donc l’inverse de la virilité) perturbe les personnes. Penses-tu que le vêtement modifie la place que peuvent avoir les corps dans l’espace public ?
2FIK
Je pars du principe que notre présence dans l’espace public n’est pas perçue de la même façon. Les espaces publics de certains pays sont des espaces qui appartiennent à tout le monde : ta présence est scrutée par quiconque et n’importe qui peut venir t’alpaguer pour exprimer son ressenti face à toi. En Amérique du Nord, l’espace public n’appartient à personne, les gens sont dans leur bulle et même s’ils voient quelque chose de bizarre, ils n’auront pas tendance à exprimer leur point de vue là-dessus.
Avec ma série de performance « My Name is Ludmilla-Mary », faire marcher mon personnage de femme à barbe voilée dans des tenues très stylées crée un choc. Je pourrais me faire taxer de faire de la provocation mais tout est réfléchi dans mes œuvres donc s’il y a provocation, il y a message et il y a ouverture à la discussion.
Provoquer pour provoquer est une perte d’énergie. Provoquer pour poser des questions sur l’identité et le genre, et créer des ponts entre les personnes dans une perspective de dialogue est ce qui m’intéresse vraiment. Je suis un artiste, mon travail est de mettre le doigt là où ça fait mal, quitte à me prendre quelques conséquences désagréables comme des insultes ou des menaces de mort. Par exemple, quand je suis allé faire une performance en Irlande en 2014 dans le cadre du Fringe Festival de Dublin, j’ai réinterprété une œuvre nationale célèbre pour poser des questions sur le mariage forcé et l’avortement.
En 2014, l’avortement n’était pas légal en Irlande et il y a eu quelques réactions négatives mais j’ai eu beaucoup de remerciements et de mots encourageants provenant de femmes qui me disaient que ce sujet ne doit pas être tabou. J’ai mon rôle à jouer en brisant les tabous. Provoquer va simplement servir à attirer l’attention.
Ça fait partie du jeu et je ne suis pas désolé de cette situation, je l’assume pleinement.
image 6
#Ludmilla-Mary à Place des Arts. ©Richard Rhyme. Photographie de Richard Rhyme.
Youssef
Ce qui choque avec Ludmilla-Mary c’est, entre autres, le fait qu’elle porte le voile. Pourrais-tu m’en dire plus sur le voile et ton rapport avec ce dernier ? C’est un vêtement/accessoire que tu mobilises beaucoup dans ton travail.
2FIK
Ludmilla-Mary est un concentré de symboles : la barbe, le hijab, le cuir, le talon.
Sa barbe est liée à la caricature des islamistes, que l’on imagine facilement tous ressembler à Oussama Ben Laden. Comme si les radicaux ne savaient pas utiliser de rasoir, c’est assez drôle.
Le hijab est un accessoire religieux pour les femmes musulmanes. Celles-ci sont souvent perçues comme faibles, soumises et incapables de décider pour elles-mêmes, ce qui est totalement faux. Ces femmes choisissent de porter le hijab et ce dernier est aussi l’expression d’un statut social.
Le cuir est le matériel avec lequel sont faits tous les hijabs de Ludmilla-Mary, je voulais ici intégrer une notion gay dans ce personnage. En effet, le cuir est un fétiche mais aussi un lifestyle [mode de vie] pour toute une partie de la communauté gay. Tous les hijabs ont été faits dans un sex shop [boutique érotique] montréalais, custom-made [faits sur mesure].
Le talon est bien entendu lié à la féminité, au pouvoir de séduction caricatural que les femmes ont quand elles en portent. L’attractivité d’une femme n’a strictement rien à voir avec le talon haut, mais je joue toujours avec les traits grossiers que l’on met sur les personnes et les objets qui leur sont liés.
Le fait qu’elle soit jouée par un homme arabe est la cerise sur le sundae.
Youssef
J’ai cru comprendre que tu étais aussi influencé par la mode dans ta manière de penser ton travail artistique. J’ai vu plusieurs gros livres de mode sur ton étagère. Pourrais-tu développer sur ton rapport à la mode ?
2FIK
J’ai toujours été un amoureux des images fortes. La mode m’a toujours donné de quoi rêver. Je me rappelle encore du défilé Orient Express de Dior, ceux de McQueen début 2000 avec Shalom Harlow et sa robe peinte par des robots ou encore celui du jeu d’échecs. Être capable de voir ces documentations complètes était à l’époque pas si facile car Internet n’était pas aussi bien huilé qu’aujourd’hui.
Aussi, j’ai eu la chance de vivre de nouveau à Paris entre 16 et 24 ans et donc ces années là étaient superbes niveau créativité : je trainais dans un milieu qui mélangeait des gens des milieux de la mode, de la musique, du journalisme. Beaucoup de soirées folles où la créativité allait bon train.
Youssef
Est-ce que tu dirais qu’il y a quelque chose d’identitaire ou de politique derrière la mode ? Est-ce que la mode peut être un outil politique ou d’affirmation identitaire ?
2FIK
Totalement, tout est politique. De ce que l’on porte à ce que l’on consomme, de notre façon de voter à notre façon de défendre nos idées personnelles. Donc choisir de s’habiller de telle ou telle façon EST un acte politique en soi.
J’ai la chance de pouvoir faire du code switching. C’est-à-dire que je change mes codes vestimentaires, sociaux et culturels en fonction du lieu où je me trouve. À ce jour, je peux prétendre parler trois langues couramment et connaître trois cultures assez bien : la française, la marocaine et la nord-américaine. De ce fait, lorsque je me retrouve ici ou là, je m’habille pour exprimer différentes facettes de ma personne.
La chose la plus flagrante est lorsque je me retrouve dans le village de mes parents dans les montagnes du Maroc. Instinctivement, je porte des tenues traditionnelles et deviens visuellement exactement comme les autres personnes du village. Bien entendu que tout le monde sait que je viens du Canada, mais cela rend les interactions plus simples : je n’apparais pas comme le Berbère qui a rejeté ses origines et se croit meilleur que les autres. Je suis perçu comme l’homme qui a quitté son pays d’origine mais qui est fier de sa culture et de ses origines. Ça change absolument tout et cela, sans dire aucun mot : c’est très puissant.
Youssef
Plus globalement, est-ce que tu penses que tu serais un représentant de quelque chose ?
Je trouve que ton travail permet d’imaginer, justement, des « possibles » différents, notamment en lien avec l’arabité et la maghrébité. Michel Foucault ([1967] 2004) parlait d’hétérotopie : dans la lignée de cela, ton corps héberge et matérialise, avec l’aide de vêtements et d’accessoires, des imaginaires de genre et de sexualité.
2FIK
Je ne me permettrai pas de dire que je représente quoi que ce soit car je fais le travail que je fais pour moi. Il est l’expression de ma vision du monde et de ce que je considère important à mes yeux.
Mon imagination, ma créativité et mes œuvres font de moi un meilleur humain. Je me sens Arabe de par mon image, musulman et maghrébin de par ma culture. Je suis aussi Nord-Américain, Français et pédé. Disons que le mélange pourrait être vu comme cocasse, mais il est justement ma plus grande force.
Je ne vois l’hétérotopie de Foucault en moi qu’avec toutes ces années d’expérience. Cela fait dix-neuf ans que je fais ce travail et jamais je n’aurais pensé qu’il aurait pu avoir cet impact sur moi ou sur le public. La preuve concrète que les vêtements font beaucoup plus de choses qu’on ne le pense. L’exemple typique que je prends pour parler du pouvoir du vêtement est une juge ou un éboueur : leur travail leur fait porter un uniforme. Quand ces personnes les enlèvent, elles peuvent être n’importe qui. On ne pourrait jamais imaginer une juge avec un style plutôt punk ou hippie et, pourtant, tout est possible. La personne qui ramasse nos poubelles peut être habillée de façon totalement classe ou fashion. Les habits nous présentent au monde : tout est une question d’angle de vue et de perception.
Youssef
Je te remercie beaucoup pour cette entrevue qui a été très éclairante sur ton parcours, ton travail, mais aussi sur les liens qui peuvent exister entre le vêtement, le genre, l’identité et le politique !
Bibliographie
« 2Fik Or Not 2Fik » Qui est 2fik? » s. d. 2fikornot2fik. Consulté le 17 juin 2024. https://2fikornot2fik.com/fr/qui-suis-je/.
Ahmad, Muneer I. 2004. « A Rage Shared by Law: Post-September 11 Racial Violence as Crimes of
Passion ». California Law Review 92 (5) : 1261‑1330.
Barbier, Pascal, Lucie Bargel, Amélie Beaumont, Muriel Darmon, et Lucile Dumont. 2021. « Vêtement ». Dans Encyclopédie critique du genre, 806‑17. Sous la direction de Juliette Rennes. Hors collection Sciences Humaines. Paris : La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.renne.2021.01.0806.
Connell, R. W., et James W. Messerschmidt. 2005. « Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept ». Gender & Society 19 (6) : 829‑59. https://doi.org/10.1177/0891243205278639.
Deliovsky, Kathy. 2008. « Normative White Femininity: Race, Gender and the Politics of Beauty ». Atlantis: Critical Studies in Gender, Culture & Social Justice 33 (1) : 49‑59. https://journals.msvu.ca/index.php/atlantis/article/view/429.
Foucault, Michel. 2004. « Des espaces autres ». Empan 54 (2) : 12‑19. https://doi.org/10.3917/empa.054.0012.
Guillaumin, Colette. 1978. « Pratique du pouvoir et idée de Nature (2) Le discours de la Nature ». Questions Féministes, no 3 : 5‑28. https://www.jstor.org/stable/40619120.
Monneyron, Frédéric. 2008. La frivolité essentielle. Du vêtement et de la mode. Quadrige. Paris : Presses Universitaires de France. https://www.cairn.info/la-frivolite-essentielle--9782130571780.htm.
Oldstone-Moore, Christopher. 2018. « Social Science, Gender Theory and the History of Hair ». Dans New Perspectives on the History of Facial Hair: Framing the Face. Sous la direction de Jennifer Evans et Alun Withey, 15‑32. Cham : Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73497-2.
Paulicelli, Eugenia, Veronica Manlow, et Elizabeth Wissinger. 2021. « Introduction ». Dans The Routledge Companion to Fashion Studies. Sous la direction de Eugenia
Paulicelli, Veronica Manlow, et Elizabeth Wissinger, 1‑5. London : Routledge. Roach-Higgins, Mary Ellen, et Joanne B. Eicher. 1992. « Dress and Identity ». Clothing and Textiles Research Journal 10 (4) : 1‑8. https://doi.org/10.1177/0887302X9201000401.
Selby, Jennifer A., Amélie Barras, et Lori Gail Beaman. 2018. « Le Terroriste, l’Homme éclairé et le Patriarche : les figures qui hantent le quotidien des musulmanes ». Anthropologie et Sociétés 42 (1) : 155‑82. https://doi.org/10.7202/1045128ar.
Waling, Andrea. 2019. « Rethinking Masculinity Studies: Feminism, Masculinity, and Poststructural Accounts of Agency and Emotional Reflexivity ». The Journal of Men’s Studies 27 (1) : 89‑107. https://doi.org/10.1177/1060826518782980.
Biographie
Photo par Manoucheka Lachérie
Youssef Benzouine est présentement doctorant en sciences des religions à l’Université de Montréal à l’Institut des études religieuses. En parallèle, il a aussi eu des implications dans le milieu associatif étudiant, et est aussi membre du Conseil interculturel de Montréal.
Article Citation
Benzouine, Youssef. « Entrevue avec l’artiste 2Fik ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 1-18. https://doi.org/10.38055/FCT040103
Copyright © 2025 Fashion Studies - All Rights Reserved
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license (see: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)