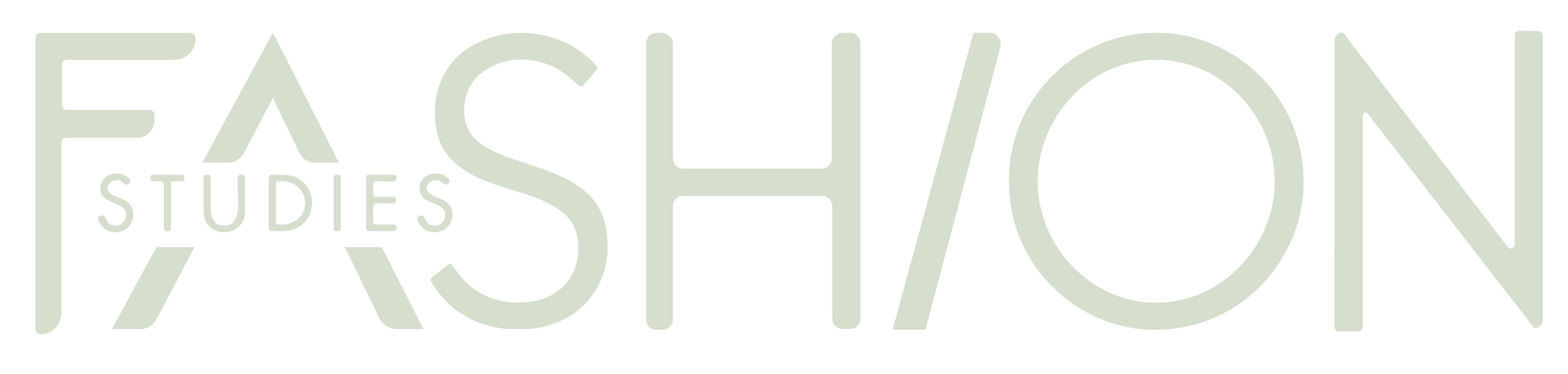Jupes bibliques : de l’ourlet divin à la robe sale de Jérusalem
Par Anne Létourneau
DOI: 10.38055/FCT040105.
MLA: Létourneau, Anne. « Jupes Bibliques : de l’ourlet divin à la robe sale de Jérusalem ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 1-26. https://doi.org/10.38055/FCT040105
APA: Létourneau, A. (2025). Jupes Bibliques : de l’ourlet divin à la robe sale de Jérusalem. Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, 4(1), 1-26. https://doi.org/10.38055/FCT040105
Chicago: Létourneau, Anne. « Jupes Bibliques : de l’ourlet divin à la robe sale de Jérusalem ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies 4, no. 1 (2025): 1-26. https://doi.org/10.38055/FCT040105
Numéro spécial 3, Numéro 1, Article 5
Mots-clefs
Bible hébraïque
Vêtement
Jupes
Isaïe
Lamentations
Genre, violence
Masculinité divine
Personnification féminine
Résumé
Un même terme hébraïque (šûlîm) désigne l’ourlet d’une jupe, d’une robe ou d’une tunique dans la Bible hébraïque. Ce mot est employé à la fois pour des personnages masculins (prêtres, divinité) et féminins (personnifications de Jérusalem/Sion et de Ninive). Cet article s’intéresse à la construction genrée des corps – masculinité divine et sacerdotale, féminité urbaine et violentée – que ce simple mot permet d’entrevoir. En effet, dans le cas des personnifications féminines, la mention des šûlîm signifie chaque fois une manipulation agressive, un retroussage qui annonce une violence sexuelle. La robe de majesté de YHWH (Is 6, 1) et la robe sale de Jérusalem (Lm 1, 9) retiendront ici l’attention.
Le bord peut être rebord et inviter au débord, car la bordure est sur la marge, au propre comme au figuré et elle invite à regarder au-delà du tissu. L’entrecroisement qui fait textile bute sur de l’Autre. Du vide ? Du nu ? Du tenu qui ne serait pas ténu ? Du sens à coup sûr. (Pellegrin 2000, 11)
Dans l’introduction à l’ouvrage collectif Lisières et bordures, Nicole Pellegrin présente ces espaces « limites » des vêtements comme étant chargés de multiples significations. Elle note pourtant qu’il s’agit d’une « zone textile » encore sous-étudiée (2000, 21), d’où l’importance de l’ouvrage paru en 2000, à la suite des journées d’étude de 1996. L’intérêt historique des bordures et des lisières a aussi été souligné dans les études récentes consacrées au vêtement au Proche-Orient ancien. On pense aux travaux de l’historienne de l’art Alison Thomason, notamment le chapitre « Clothing and Nudity in the Ancient Near East: Archeological and Iconographical Aspects » (2019). Dans ce chapitre, elle dédie plusieurs pages aux ourlets de vêtements représentés dans l’iconographie, leur décoration et leur association étroite avec l’identité de ceux ou de celles dont ils accompagnent les corps (2019, 112-113). Thomason rappelle d’ailleurs, avec d’autres avant elle, que l’impression de la lisière du vêtement (sissiktum) pouvait servir de signature sur des tablettes cunéiformes (2019, 113; cf. Sauvage 2021, 52). C’est précisément à des ourlets – ou jupes – bibliques « signifiants » que je consacre le présent article. À l’instar du travail de thèse de Bethany Wagstaff, je souhaite m’entraîner à « suivre les objets » (2017, 64), en particulier cet objet textile spécifique que sont les šûlîm, au sein des textes bibliques. Dans la Bible hébraïque, ce terme désignerait une jupe ou l’ourlet d’une jupe, d’une robe ou d’une tunique. Nous verrons cependant que d’autres interprétations sont aussi proposées. Ce mot est employé à la fois pour des personnages masculins (grand prêtre et divinité) et féminins (personnifications de villes et de nations).
La robe de majesté de YHWH (Isaïe 6, 1) et la robe sale de Jérusalem personnifiée (Lamentations 1, 9) retiendront particulièrement mon attention. À la suite de travaux récents sur les vêtements et les parures dans la Bible hébraïque et le Levant ancien (Berner et al. 2019; Finitsis 2019, 2022; Quick 2021), je m’intéresse en particulier aux connexions haptiques[1] entre les corps et leurs objets personnels. Dans le sillon de Nili Sacher Fox, je souhaite approfondir l’idée selon laquelle : « clothes were believed to bear aspects of their owner’s very being » (2009, 71), y compris les performances de genres[2] auxquelles les objets portés participent, dont ils se lestent et s’imprègnent, et ce, dans le monde de la littérature ancienne et des représentations qui s’y déploient. Cette contribution s’inscrit par ailleurs dans un projet de recherche plus vaste qui vise à analyser la circulation de la violence et du pouvoir dans les textiles « textuels » et ses effets sur les constructions de genres des personnages.
[1] À ce sujet, on consultera notamment Levitt (2020), Smoak (2019) et Stanes (2019).
[2] Je m’inspire ici de certains éléments de la performativité du genre, théorie d’abord développée par Judith Butler dans son ouvrage Gender Trouble (1990).
Les šûlîm : le choix d’une traduction textile et non « génitale »
D’abord, un mot sur le terme šûlîm/šûlê – qui apparaît toujours au pluriel et au construit accompagné d’un suffixe pronominal dans la Bible hébraïque (cf. Roberts 2015, 94; Williamson 2018, 13, note 5; Bender 2008, 232-233) – et les interprétations et traductions qui en ont été proposées par les commentateurs anciens et modernes. On compte onze occurrences du terme dans la Bible hébraïque[3] : six dans le livre de l’Exode – 28, 33-34 et 39, 24-26 – pour désigner l’ourlet de la robe du grand prêtre à laquelle sont brodées des grenades et attachées de petites cloches en or; quatre dans les livres prophétiques : en Isaïe 6, 1; en Jérémie 13, 22.26 et en Nahoum 3, 5; une dans le livre des Lamentations 1, 9. En Is 6, 1, les šûlê (pluriel construit) appartiennent à YHWH alors que dans tous les autres textes prophétiques et poétiques, ce sont des personnifications féminines de villes ou de nations – Jérusalem, Judah, Ninive – qui les possèdent[4].
Selon certains exégètes, le terme šûlîm/šûlê serait apparenté à l’arabe (sav/wila) et l’hébreu mishnaïque plus tardif semble faire référence à quelque chose qui « s’accroche sur » ou « pend » (Driver 1971, 88; Popko 2010, 511; Jastrow 2004, 1534). Les traductions par « ourlet » [hem], « pan », « jupe » [skirts] ou parfois « traîne » [train] sont les plus communes en français et en anglais[5]. Ce n’est cependant pas la seule interprétation/traduction proposée dans les commentaires anciens et modernes. L’ensemble des explorations de ce terme repose souvent – et trop lourdement à mon avis – sur l’étude philologique de G. R. Driver datant d’il y a plus de 50 ans (1971). Dans ce texte, il adopte une posture pour le moins ambiguë. Il est très favorable à une traduction par
« “fesses, membres inférieurs, extrémités” du corps » (Driver 1971, 88, ma traduction), à la suite de plusieurs versions anciennes, rejetant la traduction par « jupes[6] » (1971, 88-90). Cependant, comme le note Eslinger, dans le cas particulier d’Is 6, 1 qui nous intéresse ici, Driver fait volte-face et « habille » de nouveau la divinité puisque, selon lui, « […] the prophet will [not] have imagined God’s extremities or lower limbs as exposed to view » (1971, 90; cf. Eslinger 1995, 146). Plus de vingt ans après, Eslinger reprend plusieurs éléments d’analyse de Driver et propose une hypothèse encore plus audacieuse. Il insiste sur le fait que ce qui « pend » ainsi, c’est la génitalité, le pénis de YHWH (Eslinger 1995, 157-158). Ce qui est particulièrement intrigant avec cette interprétation, reprise récemment par plusieurs, c’est que la traduction de šûlîm/šûlê par une partie du corps n’est pas en soi récente[7]. En effet, les anciennes versions, en particulier grecques et latines, optent ou suggèrent une partie du corps pour plusieurs occurrences (Popko 2010, 512-513; Eslinger 1995, 147).
[3] À Qumran, en plus des occurrences présentes dans des fragments bibliques (Ex 28, 33; Is 6, 1; 47, 2 (cf. note 4); Na 3, 5; Lm 1, 9), on retrouve l’emploi du terme dans le rouleau de cuivre (3Q15 1, 11; 4, 9; 9, 1) et le Pesher Nahum (4Q169 3-4 ii, 11-12) portant précisément sur Na 3, 5. Dans le cas du rouleau de cuivre (3Q15), le terme apparaît en lien avec la localisation de choses précieuses, de trésors cachés sur le « bord » de différents endroits (cf. Parrott 2023, 47, note 50).
[4] Voir aussi la « traîne » (šōvèl) de Babylone personnifiée en Is 47, 2, un hapax dans le texte massorétique. Williamson note qu’1QIsa[a], le rouleau d’Isaïe à Qumran, a plutôt le mot šûlêk (« tes ourlets/jupes ») pour ce passage (2018, 14).
[5] Voir la note 18 qui présente une série de traductions pour Is 6, 1 et Lm 1, 9.
[6] Driver (1971) distingue strictement « ourlet » de « jupes », ce qui me semble problématique.
[7] C’est d’ailleurs un des principaux arguments de Driver (1971) en faveur des extrémités corporelles.
Le tableau suivant, développé à partir des versions anciennes et de Driver (1971), Popko (2010) et Eslinger (1995), en donne une bonne idée :
[8] Ce terme traduit aussi l’hébreu pātîl (fil) en LXX Ex 39, 31.
[9] Roberts (2015, 89b) traduit par « that which was under him ». Les manuscrits de la Vulgate présentent (évidement) certaines variantes. Par exemple, on retrouve parfois ipso au lieu de eo dans ce passage.
[10] D’après la traduction de Bae (2023, 382) : « (the brightness) of his glory ».
[11] Cf. Cathcart et Gordon 1990, 139.
[12] Un euphémisme sexuel est possible dans l’identification des pieds. À ce sujet, voir notamment Ex 4, 25; Jg 3, 24; 1 S 24, 4; 1 R 15, 23; 2 R 18, 27; Is 7, 20; 36, 12; Ez 16, 25; Rt 3, 4.7-8.14, etc.
[13] Cf. Jastrow 2004, 1566.
L’idée d’une traduction par une partie du corps – impliquant souvent une allusion ou un euphémisme de nature sexuelle[14], y compris pour les pieds ou les cuisses – est donc déjà présente dans les versions grecques, latines et peut-être aussi araméennes (cf. Lm 1, 9) pour plusieurs šûlîm bibliques appartenant à des personnifications féminines. Comme je le mentionnais plus tôt, si Driver suggère que le texte massorétique fait lui aussi référence à la génitalité, pour YHWH, en Is 6, 1, il n’adopte pourtant pas sa propre hypothèse, au contraire d’Eslinger (1995), d’Alan Hooker[15] (2014) et de Francesca Stavrakopoulou (2021). Dans God: An Anatomy, Stavrakopoulou soutient que « […] shul, is more commonly used by biblical prophets not to refer to the edges of garments, but to pointedly allude to the fleshy realities of the sexual organs » (2021, 104). Il me semble pourtant qu’une telle traduction/interprétation élimine le potentiel herméneutique multiple du vêtement – que tous reconnaissent au moins à l’œuvre de manière indéniable en Ex 28;39 – vis-à-vis du corps. Une traduction par une partie « génitale » fait disparaître, en le sectionnant, le lien métonymique entre le vêtement et le corps. Comme le défend justement Popko[16], la position d’Eslinger fait d’ailleurs disparaître l’ambiguïté et la charge « euphémisante » du vêtement, pourtant à maintenir (2010, 517-518). Le risque est aussi de masquer le rôle du vêtement comme deuxième peau et extension du corps (Entwistle 2001), connectant précisément ce dernier avec d’autres. Avec Baert et Sidgwick, rappelons que l’ourlet de tout vêtement – qu’il s’agisse d’une jupe, d’un manteau ou d’une robe – constitue « […] a border between one’s own body and the body of the other » (2011, 323). Par-delà l’identification au corps qu’il vêt, il agit aussi comme un « seuil », un lieu de construction et de communication de l’identité, ainsi que de circulation du pouvoir[17], de l’affect, de la mémoire et aussi de la violence (Baert & Sidgwick 2011, 323, 331-332; Hunt 2014; Stanes 2019). La traduction par un terme textile permet d’insister sur le rôle de dévoilement et de façonnement de la corporalité et du genre d’une personne, d’un personnage comme d’une personnification, par la lisière ou le pan d’un vêtement (Baert & Sidgwick 2011, 324). Bien que la traduction du mot šûlîm par un terme vestimentaire soit suivie par la majorité des exégètes, ceux-ci prennent rarement le textile « textuel » au sérieux. En témoignent notamment les traductions choisies sur lesquelles on s’attarde peu. Dans sa thèse de doctorat, Parrott note par exemple le travail genré à l’œuvre dans ces traductions. En effet, le terme de « jupes » est rarement choisi pour YHWH en Is 6 ou le grand prêtre en Ex 28; 3918. On préfère mentionner l’ourlet d’une robe ou d’un manteau plutôt que les jupes, peut-être un terme jugé trop féminin pour imaginer le vêtement de la divinité et des hommes à son service (Parrott 2022, 66; 2023, 46).
[14] Sur la manière de parler de la sexualité dans la Bible hébraïque et plus largement dans la région de l’Asie du Sud-Ouest, cf. Stavrakopoulou 2021, 97-98.
[15] Hooker s’intéresse à l’association de la kāvôd (« gloire » dans la majorité des traductions) divine avec la masculinité et le phallus (défini à partir de la psychanalyse) (2014, 17-34).
[16] Cela ne signifie aucunement que je sois en accord avec la thèse de Popko selon laquelle il n’y a pas de violence sexuelle en Jr 13, 26 (Popko 2010, 510ss).
[17] Sur l’association entre métaphore vestimentaire de la jupe et pouvoir, cf. le chapitre de Parrott sur Jr 13, 22.26 (2023, 36-75).
[18] Voici quelques exemples pour Is 6, 1: « his robe » (Jewish Publication Society [JPS]); « the hem of his robe » (NRSV); « the train of his robe » (New International Version; New King James Version); « les pans de sa robe » (Segond 1910) ou « le bas de son vêtement » (Segond 2002); « son manteau » (Bible Nouvelle Traduction [BNT]); « sa traîne » (TOB), etc. Seule la traduction de la TOB dévie un peu de cette tendance générale. Pour comparaison, quelques traductions de Lm 1, 9 : « sa jupe » (TOB); « ses franges » (BNT); « pans de sa robe » (Segond 1910) ou « sa robe » (Segond 2002); « her skirts » (JPS; NIV; NKJV; NRSV). La traduction par sa/ses jupe(s) est la plus courante.
Par-delà le travail déjà complexe de traduction, d’autres enjeux de genre sont aussi à l’œuvre. En effet, si les šûlîm ne sont pas en soi un objet genré puisqu’« hommes » et « femmes » en disposent (bien qu’il s’agisse d’une divinité et de personnifications féminines), les manières d’en représenter la manipulation et le mouvement sont distinctes. C’est ce à quoi j’aimerais m’attarder en considérant d’abord l’exemple de YHWH en Is 6, 1, puis celui de Jérusalem personnifiée en Lm 1, 9.
Les šûlîm et la masculinité : le cas de YHWH en Is 6, 1
Nous disposons de deux cas de jupes/ourlets pour des personnages masculins : le grand prêtre en Ex 28; 39 et YHWH en Is 6, 1. Dans le premier cas, on mentionne cette bordure du vêtement appelé me‘îl avant tout pour en souligner l’ornementation – grenades brodées et cloches dorées –, ces éléments faisant partie de la tenue compliquée du grand prêtre qu’il se doit de respecter afin de rester en vie (v. 35) : les clochettes permettent de prévenir YHWH de sa présence alors que les couleurs, la matière et la décoration du vêtement assurent le camouflage de son corps dans l’espace du Tabernacle (Schipper & Stackert 2013, 473). Le vêtement n’est pas présenté comme étant manipulé par le grand prêtre. C’est plutôt la confection du vêtement selon les instructions divines qui est au cœur de ces mentions. Tout en gardant ces autres passages en tête, c’est le verset d’Is 6, 1 qui retient avant tout mon attention dans le présent article. Il s’agit de la vision de Dieu – théophanie – à laquelle a droit le prophète Isaïe.
Je propose la traduction suivante du verset 1 :
L’année de la mort du roi ‘Uziyyāh, tu verras Adonai/Seigneur assis sur son trône exalté et haut et ses jupes remplissant le temple/palais.
Dieu y est présenté en compagnie de membres de sa cour céleste, les séraphim[19]. Bien que plusieurs exégètes – incluant des spécialistes du livre d’Isaïe – discutent en profondeur de la vision du prophète, les jupes divines retiennent rarement l’attention. Certains vont même jusqu’à dire qu’elles n’ont aucune importance. Par exemple, selon Ehud Ben Zvi, si les « pans » du vêtement divin confirment que le dieu d’Israël est bel et bien habillé et non pas nu comme d’autres divinités anciennes, cette simple mention des šûlayw, sans description, les positionnent comme n’étant pas dignes de mémoire, au contraire des vêtements sacerdotaux. Le bibliste va même jusqu’à identifier « [an] underlying, but strong tendency to dis-prefer depictions and imaginative exercises involving YHWH’s clothes, even if he had to be remembered as not naked » (Ben Zvi 2019, 171). Bref, de longues pages de son texte sont dédiées à réfuter l’importance de ce vêtement. On peut néanmoins opposer à l’argumentation de Ben Zvi le fait que la liste, qu’il s’agisse de vêtements ou d’autres objets, est un genre littéraire particulier aux visées spécifiques au Proche-Orient ancien[20]. Une telle liste serait-elle appropriée dans la vision prophétique d’Isaïe ? De plus, doit-on disqualifier le détail d’un micro-récit parce qu’il n’est pas développé ? Une telle disqualification mènerait à conserver bien peu de choses de la majorité des récits de la Bible hébraïque. Je préfère l’invitation de Wagstaff à prêter attention aux objets, y compris les jupes de YHWH, comme le font d’ailleurs LeMon & Purcell dans leur enquête iconographique (2019).
[19] Sur la nature des séraphim (séraphins), cf. Anthonioz 2018, 75-92. Ces derniers ne ressemblent aucunement à des bébés joufflus ailés. Il s’agit plutôt de « serpents brûlants » (84). Dans un article de 1989, Hurowitz interprétait les šûlîm comme des êtres célestes au service de la divinité (Ben Zvi 2019, 167). Cette hypothèse est néanmoins rarement retenue.
[20] Pour des exemples de listes poétiques en hébreu biblique, akkadien ou ougaritique, on consultera notamment Watson 1986, 251-256.
En plus de suggérer le gigantisme du personnage divin, comme l’ont noté plusieurs auteurs et autrices (LeMon & Purcell 2019, 270; Parrott, 2023, 51; Roberts 2015, 94; Stavrakopoulou 2021; Williamson 2018, 14), les excroissances textiles viennent signifier la puissance du roi céleste (Flynn 2019, 18, 25-28; LeMon & Purcell 2019, 274; Parrott 2023, 51), tout comme les séraphim qui annoncent précisément que sa gloire (kāvôd) remplit la terre (v. 2-3). D’ailleurs, comme le notent Flynn et LeMon & Purcell, plusieurs parallèles sont possibles entre cette représentation biblique du vêtement du dieu d’Israël et les rituels et textes portant sur les vêtements divins en Mésopotamie. On rappelle notamment le rituel d’habillement et de parure des statues très répandu au Proche-Orient ancien (Flynn 2019, 12). Il n’est pas nécessaire de rouvrir le débat quant à la possibilité d’une statue de YHWH au temple de Jérusalem (cf. Römer 2009) pour considérer que le rapprochement avec la statuaire divine mésopotamienne est, de toute manière, fort pertinent. Flynn insiste surtout sur le vêtement stylisé à volants (pala) mentionné dans des tablettes cunéiformes et associé à la cérémonie lubuštu, soit le don de vêtements à la divinité. À son avis, YHWH porte une tenue similaire dont l’association à la royauté divine est très claire (Flynn 2019, 14, 25). Du côté de l’iconographie, LeMon & Purcell mettent pour leur part en lumière des représentations de divinités sur leurs trônes appartenant aux cultures mésopotamienne et ougaritique, notamment des sceaux-cylindres. Ils mentionnent notamment un exemple de représentation où la robe du dieu-roi présente une bordure « double » et clairement « épaisse » en lien avec le pouvoir qui est le sien (LeMon & Purcell 2019, 271). Dans l’analyse d’Is 6, 1, on doit aussi porter attention au rapport à l’espace que le vêtement accapare et sculpte à l’image de la divinité. Tout en soulignant, elle aussi, le pouvoir divin que le vêtement vient signaler, Parrott note de manière très intéressante, à la suite de l’analyse de Maier au verset 1, qu’à la verticalité du haut trône, les jupes ajoutent un plan horizontal en « envahissant » le temple (Parrott 2023, 51). Contrairement à Roberts qui insiste sur la longueur fixe de l’ourlet divin à la cheville, en correspondance avec l’ensemble des représentations iconographiques néo-assyriennes, y compris celle du roi Jéhu sur l’obélisque noir de Shalmaneser III [Image 1] (Roberts 2015, 94-95; cf. Driver 1971, 90), il me semble que le vêtement divin et géant défie ces codes esthétiques néo-assyriens par l’excès.
image 1
Jéhu se prosternant et offrant un tribut au roi Shalmaneser III. Obélisque Noir de Shalmaneser III, Période néo-assyrienne, 858-824 ANE, Nimrud (Kalhu), Irak actuel.
© The Trustees of the British Museum. Shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licence.
Dans « Folds, Fragments, Surfaces: Towards a Poetics of Cloth », Barnett offre une réflexion sur le pli textile qui donne à penser pour YHWH en Is 6 : « Here, folds double back on themselves like ocean waves, withdraw, and almost cease to generate » (1999, 27).
Je suggère en effet que l’emploi double du verbe ml’ (« remplir »), en Is 6, 1.3, permet de faire ressortir le mouvement « tentaculaire », envahissant, du vêtement divin et contribue à dire le dieu dans ses dimensions royale et créatrice. Une petite enquête mène d’ailleurs à constater que, dans ses associations avec le divin, la racine est souvent impliquée dans différentes manifestations théophaniques : c’est non seulement la gloire (kāvôd) de YHWH qui remplit le Sanctuaire ou le Temple (Ex 40, 34-35; Ez 43, 5; 44, 4; 2 Ch 7, 1-2), mais aussi la nuée (1 R 8, 10-11; Ez 10, 3-4; 2 Ch 5, 13-14). La divinité se manifeste aussi en « emplissant » un espace d’autres manières : de façon guerrière avec des chevaux et des chars de feu sur une montagne (2 R 6, 17); de manière aimante avec sa ḥesed à la surface de toute la terre (Ps 33, 5; 119, 64). Ce même verbe (ml’) est mobilisé dans l’entreprise créatrice de Dieu pour appeler les créatures aquatiques à remplir les eaux (Gn 1, 22), puis l’être humain la terre (v. 28), un impératif qui sera réitéré, après le déluge, à Noé et ses enfants (Gn 9, 1)[21]. Le mouvement expansif des jupes de YHWH rappelle donc non seulement ce foisonnement créateur que les paroles divines font advenir, mais différentes manifestations de la présence divine.
Il est utile d’insister, comme plusieurs biblistes, sur la correspondance entre les versets 1 et 3 d’Isaïe 6 et leur emploi du verbe ml’. En effet, aux jupes dans le temple correspond la gloire (kāvôd) divine qui remplit la terre (Bae 2023, 381-382; Parrott 2023, 51; Vermeylen 2014, 63). En raison de ce parallélisme soutenu par la présence de la même racine, le terme kāvôd mérite qu’on s’y attarde. Cette « gloire » est très souvent rapprochée du melammu mésopotamien défini comme suit par Bae : « radiant aura that the Mesopotamian gods and kings allegedly possess » (Bae 2023, 378[22]), bref une brillance associée à la divinité et à la royauté. Plusieurs auteurs et autrices ont délaissé une compréhension transcendantale et abstraite du kāvôd pour une compréhension corporelle[23]. Bae, à la suite de Hundley (2011), fait quant à lui l’hypothèse d’un attribut vestimentaire royal (regalia) (Bae 2023, 372-392). L’idée est d’autant plus intéressante qu’elle permet d’« étoffer » l’interprétation du corps divin vêtu : à la bordure d’une robe royale que l’on doit imaginer richement brodée – possiblement double, à volants, etc. – s’ajoute l’éclat du kāvôd qui vient signaler la présence active de la royale divinité, inspirant « émerveillement et crainte » (« awe and fear », Bae 2023, 387). L’habit divin remplit non seulement le temple, mais aussi toute la terre, telle une marée de tissus somptueux. Cette abondance textile participe à un imaginaire de la divinité qui me semble important malgré la brève mention. Cet excès des jupes divines – ici surtout tactile dans leur déploiement spatial, mais s’accompagnant aussi de suggestions visuelles – participe au façonnement du corps même de la divinité, y compris de sa masculinité non humaine. D’ailleurs, selon plusieurs auteurs, le kāvôd est un attribut masculin, voire phallique[24], de la divinité (Clines 2019; Hooker 2014). Dans sa brève enquête, Hooker aborde seulement Is 6. À la suite d’Eslinger, son interprétation en termes « génitaux », permet d’insister de manière intéressante sur la fécondité et le militarisme au cœur de la masculinité du dieu-roi, surtout à partir des métaphores arboricoles et des images de destruction des versets 12 et 13 (Hooker 2014, 29-30). Néanmoins, le verbe ml’ des versets 1 et 3 peut aussi alimenter ces associations à la fertilité, à la création et à la terreur que peut inspirer le dieu guerrier. Les ourlets foisonnants de la robe divine fonctionnent véritablement comme une signature du dieu YHWH; les lisières de son vêtement inscrivent sa présence dans le temple (v. 1) et à la surface de la terre (v. 3) et révèlent différentes facettes de l’identité divine : un corps vêtu gigantesque, puissant, immanent[25], détenteur d’un pouvoir royal, créateur et guerrier[26].
[21] Le participe apparaît aussi en Jr 23, 24 pour désigner l’état d’omniprésence de YHWH, « remplissant » tous les espaces de la création à la fois.
[22] À ce sujet, voir aussi Hooker 2014, 20-21.
[23] Ce qui implique aussi une diversité de possibilités. Cf. le survol des avis dans Bae 2023, 373-376.
[24] Sur la dimension psychanalytique de cette interprétation, cf. Hooker 2014, 20.
[25] Voir notamment Bae 2023, 387.
[26] Sur la violence au cœur de la masculinité divine, on consultera notamment Clines 2019.
Les šûlîm et la féminité : le cas de Jérusalem en Lm 1, 9
Si les longues jupes prolongent de manière dynamique et agissante le corps du dieu-roi Adonaï, un dieu qui se révèle dans son gigantisme, son excès et sa puissance, qu’en est-il des jupes de personnages féminins dans la Bible hébraïque ? En introduction de son ouvrage The Objects That Remain, Laura Levitt mentionne que les vêtements « […] are objects that cover and hold our bodies. We wear these textiles. We live inside them. The longer we inhabit them, the more of us they contain » (2020, 2). Que contiennent donc les jupes des villes et des nations personnifiées, Juda, Ninive et surtout Jérusalem (ou Sion) en Lm 1, 9 ?
Un motif commun unit les mentions des šûlîm en Jr 13, 22.26 et en Na 3, 5 : dans chaque cas la ville personnifiée se retrouve humiliée – agressée sexuellement – alors que la punition qui lui est imposée pour ses comportements adultères/idolâtres est la suivante : YHWH/Dieu retrousse les jupes de la femme-métaphore sur son visage (Jr 13, 26; Na 3, 5), exposant sa nudité. Le verbe employé pour signifier l’agression divine est gālāh[27] (« découvrir », « enlever », « retrousser ») en Jr 13, 22 et Na 3, 5[28]. En Na 3, 5, c’est la capitale assyrienne, Ninive, qui est ainsi humiliée, alors qu’elle est d’ailleurs présentée comme une reine, une sorcière, une prostituée (v. 4). Au verset 6, on mentionne par ailleurs que des šiqûṣîm (« saletés ») sont lancées sur Ninive, souillant son corps, mais aussi, sans aucun doute, ses jupes recouvrant désormais son visage[29]. Ce sont d’autres jupes « sales », celles de Jérusalem[30] personnifiée en Lamentations 1, 9, dont je traite ici plus en profondeur dans la comparaison avec Isaïe 6, 1. Parrott considère d’emblée ces deux mobilisations des šûlîm comme parfaitement antithétiques (2023, 53). Je reviendrai sur ce point en conclusion.
[27] En Jr 13, 26, on trouve le verbe ḥāsaf pour signifier le geste de dénudement et donc la manipulation des « jupes » (cf. aussi Is 47, 2). Voir aussi les autres emplois du verbe gālāh au Niphal ou au Piel signalant la mise à nu agressive de personnifications féminines en Is 47, 3 (Babylone) et en Ez 16, 36-37; 23, 29 (Jérusalem ou Oholibah) (Bauer 1999, 103-104). Elles sont dépouillées de leurs beaux atours de princesses et de reines, étroitement associés à leurs agentivités royales et érotiques. Je suis Parrott (2023) sur l’association du vêtement au pouvoir.
[28] On note d’ailleurs un parallèle entre le « retroussage » des jupes (šûlayik) et la violence (ḥāmās) faite aux talons (‘ǎqēvāyik) de Judah en en Jr 13, 22 (cf. Bauer 1999, 101), le suffixe pronominal permettant d’ailleurs d’insister sur la connexion entre ourlets/jupes et talons et donc sur le bas du corps. La suggestion de violence sexuelle me semble amplifiée (redoublée) par le parallèle textile/corps et la « manipulation » de l’un comme de l’autre. Je vois mal comment on peut la rejeter comme le fait Popko (2010, 520-521). Plus récemment, Parrott en nie la certitude et la pertinence (2023, 39, 59). Cette dernière considère que le vêtement constitue un « means of perception management » (40). YHWH, en tant qu’« agent du vêtement » corrige par ses manipulations la mauvaise perception qu’a Jérusalem d’elle-même (40, 68). Voir infra sur la différence importante avec ma propre interprétation.
[29] Sur Na 3, 5, on consultera notamment les travaux de Cook (2016) et de Lanner (2006).
[30] Les identifications de la personnification varient tout au long de Lm 1-2 : Judah, Fille (de) Sion, Jérusalem, etc. À partir de Lm 1, 7, elle est appelée Jérusalem. Cf. Wendland 2021, notamment 70-71.
L’ouverture de ces nouvelles voies a notamment permis de dévier du chemin habituellement emprunté autour des questions de culpabilité, de péché, de rédemption et de théodicée pour s’intéresser plutôt à l’expression de la souffrance de la Jérusalem personnifiée (Bier 2015; Boase 2006; Conway 2012; Floyd 2012; Linafelt 2000; Mandolfo 2007). Comme le résume fort justement Bier à propos de Lm 1 : « [t]he jarring immediacy of Zion’s pain thus displaced any straightforward ‘sin + punishment = suffering’ equation » (2015, 63). Dans la brève réflexion proposée, je suis particulièrement inspirée par l’interprétation du bibliste Tod Linafelt qui pense le livre des Lamentations comme une « littérature de survie »
(2000). C’est l’arrière-plan à partir duquel je souhaite réfléchir aux « jupes impures » de Jérusalem et à leurs manières de signifier sa souffrance. En Lm 1, 1-9b, celui que les exégètes appellent tour à tour le « narrateur », l’« observateur masculin » (Hens-Piazza 2017, 1), le « mentor pastoral » (Berman 2023, 31), le « poète » ou le lamenter (Wendland 2021), dresse un portrait tragique de la personnification. Avant même d’atteindre le verset 9, on sait déjà que Jérusalem est dans un état désastreux, de dévastation complète. La princesse est abandonnée par tous, seule au monde. Elle est désormais veuve, réduite aux travaux forcés, ses enfants amenés en captivité (v. 3 et 5) (Maier, 2008, 145-146; Mandolfo 2007, 87). Je retiens le premier segment du verset 9 qui mentionne :
« son impureté [était] dans ses jupes (toume’âtâh bešûlêhâ), elle ne se souvenait pas
de son futur; elle descendait merveilleusement, personne pour la consoler […] ».
Jérusalem prend ensuite la parole pour la première fois afin de demander à YHWH de regarder sa souffrance. Elle coupe ainsi la parole (Hens-Piazza 2017, 11) à celui qui la scrute et vient tout juste d’attirer l’attention sur l’état de la bordure[32] de son vêtement et sur sa chute[33].
[31] Voir notamment le travail pionnier de Linafelt (2000) et ceux de Boase (2006; 2016).
[32] Voir l’image 2 de l’annexe. Cette bordure de tunique usée, d’époque nabatéenne, permet d’imaginer l’état de la robe de Jérusalem après la chute de la ville aux mains des Babyloniens. Puisque les textiles levantins de la période du Fer sont très rares – à peine quelques fragments dont les images ne peuvent être reproduites –, j’ai choisi d’illustrer mon propos à l’aide d’une tunique d’époque plus tardive.
[33] Cf. aussi la « descente » (yrd) de Babylone personnifiée en Is 47, 1 (Salters 2010, 64).
image 2
Bordure d’une demi-tunique en laine de taille adulte avec bandes de couleur. Période nabatéenne, 1er au 3e siècles, Khirbet Qazone, Jordanie actuelle.
Bien qu’il s’agisse d’une tunique levantine de date plus tardive, sa bordure donne à penser pour les vêtements bibliques.
© The Trustees of the British Museum. Shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licence.
Les biblistes débattent encore aujourd’hui de la nature de cette impureté qui se trouve dans la lisière du vêtement de Jérusalem personnifiée. La racine ṭm’ peut effectivement désigner une variété d’impuretés en lien avec les corps des femmes : adultère[34], nourriture interdite[35], menstruations (niddāh) et autres écoulements ou pertes de sang – y compris dans le contexte de l’accouchement[36] –, idolâtrie[37] présentée sous les traits de l’adultère, etc. Dans le cas de Lm 1, 9, l’impureté menstruelle correspond à l’interprétation la plus commune. En effet, le terme niddāh apparaît au verset 17 du même chapitre et possiblement au verset 8 avec une légère différence orthographique[38] (nîdāh). Ce double emploi du mot nîdāh/niddāh milite en faveur de taches de sang menstruel dans les jupes de Jérusalem. Néanmoins, d’autres optent pour une interprétation de ces impuretés en termes (de fluides) sexuels. En effet, comme le note Hens-Piazza, « [t]hough the text never narrates Zion as an adulterer, there is a great deal of confluence among readers leading to this conclusion[39] » (2017, 9-10). Par exemple, le statut de grande pécheresse de Jérusalem et sa nudité au verset 8 alimentent cette idée de comportements sexuels illicites (Hens-Piazza 2017, 9; Mandolfo 2007, 90, note 12). À la suite des lectures résistantes de Deryn Guest et de Carleen Mandolfo, on peut néanmoins refuser de laisser l’important vocabulaire de la transgression et du péché en Lm 1[40] (Guest 1999, 423) orienter notre lecture de la souffrance de Jérusalem et de ses jupes qui garderaient ainsi la trace de sa culpabilité ou même de sa punition. On peut plutôt opter pour une interprétation qui s’inscrit à rebrousse-poil de cette orientation, en focalisant entièrement notre attention sur la condition souffrante de Jérusalem (Mandolfo 2007, 84) et en refusant de voir Lm 1 comme le récit de sa « réhabilitation spirituelle », de sa confession et de sa réconciliation avec YHWH (Berman 2023). D’autres d’impuretés pourraient aussi être signifiées dans ses jupes (ou les ourlets de celles-ci), permettant d’appréhender différemment les « expériences » de la femme-cité. À la suite de Dobbs-Allsopp et Linafelt, il faut aussi considérer la possibilité que cette impureté – sang ou fluides corporels – soit le résultat de violences sexuelles[41]. Les auteurs ont démontré de manière convaincante la présence (et je cite) d’un « network of mutually reinforcing images of rape » (Dobbs-Allsopp & Linafelt 2001, 81) en Lm 1-2[42]. Par exemple, au verset 10, on dit à propos de Jérusalem que « ses choses précieuses » (maḥǎmādêhā) sont emportées et que son sanctuaire est « pénétré par les nations ». L’adjectif šōmēmāh, « dévastée », au verset 13 pourrait aussi indiquer la présence d’un traumatisme en lien avec le viol. Ce terme est souvent employé dans les textes prophétiques pour identifier les villes en train d’être détruites et la même racine sert à désigner l’état de Tamar, fille du roi David, alors qu’elle se trouve dans la maison de son frère Absalom après le viol qu’elle a subi aux mains de son demi-frère Amnon[43] (2 S 13, 20). Comme Tamar, Jérusalem est abandonnée et condamnée à disparaître. Les violences contre les femmes de Judah en contexte de guerre sont d’ailleurs mentionnées en Lm 5, 11[44]. Bosworth insiste sur le statut de bat, « fille », de Jérusalem et pense la personnification enracinée dans les réalités des filles en temps de guerre dans l’Antiquité (2013, 218). Au contraire de ce que plusieurs affirment, la métaphore ne flotte pas au-dessus des réalités sociales et des expériences des femmes[45]. Rappelons avec Hooker que « [w]e must forgo the idea that the metaphorical is synonymous with the nonliteral or immaterial since our embodied, material existence is the locus of metaphorical language » (2014, 18). Le siège et la destruction de Jérusalem et les violences vécues par les femmes en contexte militaire se croisent et façonnent la personnification de Lm 1 (Hens-Piazza 2017, 2). Elle pleure, salit son vêtement dans ce contexte de destruction et d’exil. Entourée de mort et de saleté, elle est désormais errante, sans domicile fixe. Pham l’imagine assise sur le sol (cf. Lm 1, 1), en plein rite de deuil, la poussière constituant la « saleté » s’incrustant dans les plis de sa jupe[46] (Pham 1999, 75). La proximité constante avec la mort en elle et autour d’elle – on imagine les cadavres et les effusions de sang[47] – est une autre source d’impureté possible dans le contexte de la destruction de Jérusalem (Mandolfo 2007, 90-91). Son retour à un état de pureté est impossible.
[34] Nb 5, 13-14.19-20.27-29.
[35] Jg 13,7.14.
[36] Lv 12, 2.5; 15, 25.26.30.33; 18, 19; Ez 22, 10; 36, 17 (comparaison).
[37] Ez 23, 7.13.17.30.
[38] Cf. Kalmanofsky 2021, 117, note 13. Deux racines sont possiblement à l’origine du terme: nwd (« se moquer », « errer ») ou ndd (« être isolée », « se retirer », racine liée à la question de l’impureté) (Bier 2015, 50-51; Boase 2006, 175-176).
[39] Voir aussi Guest (1999) et Mandolfo (2007) sur l’idée d’adultère et la culpabilité qui y est associée dans le livre, une perspective adoptée dans de nombreuses interprétations exégétiques.
[40] Sur ce vocabulaire, cf. Berman 2023, 29.
[41] Cette interprétation n’échappe pas nécessairement à la logique transgression-punition du texte, renforcée par plusieurs interprètes qui justifient la violence sexuelle en rappelant les péchés de la personnification. À ce sujet, cf. Hens-Piazza 2017, 11-12.
[42] Voir aussi Hens-Piazza (2017, 10), Maier (2008, 146) Mandolfo (2007, 101) et surtout Guest (1999, 416-422) sur les différents versets (Lm 1, 3.8-10.13) qui suggèrent à la fois le siège d’une ville et des violences sexuelles contre la personnification féminine.
[43] Cf. Maier 2008, 146; Guest 1999, 419. Le choix de traduction de cette dernière par « deflowered » pour Tamar ne me semble cependant pas du tout approprié. Voir Létourneau 2020 sur l’importance du vêtement de Tamar dans le récit.
[44] « Des femmes en Sion ils ont violées, des [jeunes filles] nubiles de Judah » (Lm 5, 11).
[45] Contre Parrott (2023, 65), notamment sa critique de Carroll.
[46] Voir aussi l’interprétation similaire de Popko 2010, 512. Le sol lui-même peut être considéré comme souillé, un espace envahi par les Babyloniens et jonché de morts.
[47] Mandolfo fait un lien fort intéressant avec Jérémie 2, 34 où le pan ou la jupe (knf) de Jérusalem est taché par le sang de personnes pauvres ou innocentes (Mandolfo 2007, 90, note 12; cf. aussi Parrott 2023, 48).
À la suite de Boase[48] (2006, 176-177), je ne pense pas qu’il soit nécessaire ou même utile d’établir de manière rigide et définitive si la personnification est impure en raison des violences vécues ou d’un adultère ou encore de la proximité de la mort et des rites de deuil dans la poussière[49]. À mon avis, Jérusalem/Sion est potentiellement impure pour toutes ces raisons, les jupes – ou les ourlets du vêtement – représentant l’ensemble de ces statuts. Au contraire de Parrott, je ne pense pas que « lack of perspective and memory has metaphorically soiled שולים […] »
(2023, 54). Parler des impuretés en ces termes mène à évacuer les traumatismes et les souffrances très concrètes de Jérusalem personnifiée pour insister plutôt sur sa « mauvaise perception » d’elle-même qui doit être corrigée (Parrott 2023, 40, 68, 74). Les taches que l’on imagine parsemant la lisière du vêtement témoignent d’expériences qui rendent le futur inimaginable, impensable pour Jérusalem, et non pas de la nécessaire conversion du regard qui l’attend (contre Berman 2023, 31 et Parrott 2023, 35-75). Il est intéressant d’imaginer ces impuretés comme des taches; comme le rappelle Baert, les taches prospèrent en milieu textile et sont hautement signifiantes (2017, 272-273).
[48] Boase insiste sur le fait que « […] the varied meanings possible for these verses need to be held in tension » (2006, 177).
[49] Plusieurs autrices notent d’ailleurs que les hypothèses proposées impliquent des impuretés bien différentes : certaines morales (ex. : adultère), d’autres rituelles (ex. : menstruations) ou métaphoriques (le sang menstruel pour représenter l’idolâtrie, ex. : Ez 16, 37). Cf. en particulier Maier (2008, 147).
Elle transporte avec elle, dans la saleté profonde de son vêtement – qu’il s’agisse des ourlets ou des plis d’une jupe –, la souillure de chaque groupe social qu’elle comprend en tant qu’unité totalisante : ses prêtres (v. 4, 19), ses dirigeants (v. 6), ses anciens (v. 19), ses jeunes hommes (v. 15, 18) et ses jeunes femmes (v. 4, 18), ses enfants (v. 5, 16) – même ses ennemis ! –, toutes leurs expériences de violence, de pertes et de ruines se déposent dans le vêtement qui constitue une « forme de mémoire » (Stallybrass 1993, 49) collective, mais aussi intime, à partir de l’expérience profondément genrée d’une femme ayant tout perdu. Comme le rappelle Hunt, « well-used fabric has a capacity—if note unique then unusually powerful—to embody both a communal historical moment and a local individual, specific story » (2014, 20). La bordure souillée raconte l’histoire de Jérusalem, une histoire devenue textile qui pousse la personnification à interpeller YHWH pour la première fois à la fin du verset 9, afin qu’il voie sa chute et son vêtement « impur », qu’il regarde celle qu’il a choisi de faire souffrir (v. 5). Si des « péchés » (v. 8) ou des « transgressions » (v. 5) ont laissé leur trace sur son vêtement, ils ne sont qu’une salissure parmi d’autres et ne disent pas l’entièreté de l’histoire de la femme-cité. De même, si les intertextes « intertextiles » de Jr 12, 22.26 et de Na 3, 5 mènent à insister sur la violence sexuelle dont chacune des personnifications-avec-jupes est victime, le bas du vêtement est aussi un espace mémoriel qui raconte le récit bien plus vaste d’une survivante.
Conclusion
Ceci nous mène, pour conclure, à une brève comparaison des jupes de YHWH (Is 6, 1) à celle de Jérusalem (Lm 1, 9). Les deux objets textiles ne sont évidemment pas mobilisés de la même manière. Ils sont connectés à des corps bien différents. En Is 6, 1, comme l’ont noté nombre de biblistes, les jupes divines sont associées au pouvoir et à l’autorité de YHWH (Flynn 2019; Parrott 2023), qui incarne une masculinité royale non humaine, voire surhumaine, car divine (Nissinen 2014, 7), une identité agissante et créatrice qui se révèle en remplissant tout l’espace de manière textile et à travers la brillance de son kāvôd (v. 3). Adonai est par ailleurs entouré de ses séraphins, de sa cour. Bien au contraire, comme l’indique le premier verset du livre des Lamentations, Jérusalem personnifiée est seule, abandonnée de tous. Elle n’a plus de trône et son vêtement n’a certainement pas la grandeur suggérée en Is 6. Si son vêtement en est sans doute un d’apparat – après tout Jérusalem est une princesse (sārāh) – il est désormais souillé, rempli d’impuretés. S’il est vrai qu’elle est dans un état d’impuissance et de dépossession, à l’opposé d’Adonai qui décide de la circulation du pouvoir dans les šûlîm[50] (Parrott 2023), cet état ne dit pas tout de la femme-cité Jérusalem en Lm 1, 9. En effet, l’attention portée au textile dans le cadre de cette brève étude comparative permet de sortir de la seule alternative pouvoir masculin et divin, dépossession et ruine féminines. En effet, la perspective de la biographie de l’objet (Stanes 2019, 231) – y compris textuel – permet d’ouvrir à d’autres manières de concevoir les ourlets ou les jupes de Jérusalem.
[50] Parrott identifie YHWH comme « the ultimate agent of םילוש »
(2023, 55)
La cité personnifiée porte le sang et la saleté des routes de l’exil sur son vêtement. Chaque impureté est un témoignage face à la violence infligée à son peuple, mais aussi à la survie de sa communauté. En comparaison avec les jupes gigantesques d’Adonai, celles de Jérusalem sont d’une lourdeur différente, mais ne sont pas moins riches en expériences. Si la vision de Dieu et de ses envahissants ourlets s’impose à Isaïe, la Jérusalem personnifiée, au contraire du prophète, ne subit pas simplement la bordure de ce vêtement qui l’habille. Bien au contraire, elle exige même, preuve d’une agentivité forte, que le regard divin se pose sur elle et son extension textile (Lm 1, 9).
Bibliographie
Anthonioz, Stéphanie. 2018. « Mutations religieuses : le cas des séraphins / Religious Mutations: the Case of the Seraphim ». ASDIWAL. Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire des religions 13 (1) : 75-92.
Bae, Sun Bok. 2023. « YHWH in a Suit: Kəbôd YHWH as the Regalia of the Priestly God ». Journal for the Study of the Old Testament 47 (4) : 372-92.
Baert, Barbara et Emma Sidgwick. 2011. « Touching the Hem: The Thread between Garment and Blood in the Story of the Woman with the Haemorrhage (Mark 5:24b-34parr) ». TEXTILE 9 (3) : 308-51.
Baert, Barbara (2017). « Stains. Trace—Cloth—Symptom ». TEXTILE 15 (3) : 270-291.
Barnett, Pennina. 1999. « Folds, fragments, surfaces: towards a poetics of cloth », dans P. Barnett et P. Johnson (dir.), Textures of Memory: the poetics of cloth [catalogue d’exposition]. Nottingham : Angel Row Gallery : 25-34.
Bauer, Angela. 1999. Gender in the Book of Jeremiah: A Feminist-Literary Reading. Studies in Biblical Literature, v. 5. New York : P. Lang.
Bender, Claudia. 2008. Die Sprache des Textilen: Untersuchungen zu Kleidung und Textilien im Alten Testament. Stuttgart : W. Kohlhammer.
Ben Zvi, Ehud. 2019. « Were YHWH’s Clothes Worth Remembering and Thinking about among the Literati of Late Persian/Early Hellenistic Judah/Yehud? Observations and Considerations », dans A. Finitsis (dir.), Dress and Clothing in the Hebrew Bible: « For All Her Household are Clothed in Crimson », 161-182. Londres : T & T Clark.
Berman, Joshua. 2023. The Book of Lamentations. Cambridge : Cambridge University Press.
Berner, Christoph et al. (dir.). 2019. Clothing and Nudity in the Hebrew Bible. Londres : T&T Clark.
Bier, Miriam. 2015. « Perhaps There Is Hope »: Reading Lamentations as a Polyphony of Pain, Penitence, and Protest. Londres : Bloomsbury T & T Clark.
Boase, Elizabeth. 2006. The Fulfillment of Doom: The Dialogic Interaction Between the Book of Lamentations and Pre-exilic/Early-exilic Prophetic Literature. Londres : T & T Clark. ———. 2016. « Fragmented Voices: Collective Identity and Traumatization in Lamentations ». Dans E. Boase & C. G. Frechette (dir.), The Bible Through the Lens of Trauma, 49-66. Atlanta : SBL Press.
Bosworth, David A. 2013. « Daughter of Zion and Weeping in Lamentations 1-2 ». Journal for the Study of the Old Testament 38 (2) : 217-37.
Butler, Judith. 2006 [1990]. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York : Routledge.
Cathcart, Kevin et Robert P. Gordon. 1990. The Aramaic Bible. Volume 14. The Targum of the Minor Prophets. Collegeville : Liturgical Press.
Clines, David J.A. 2019. « The Most High Male: Divine Masculinity in the Bible », dans O. Creangă (dir.), Hebrew Masculinities Anew, 61-82. Sheffield : Sheffield Phoenix Press.
Conway, Mary. 2012. « Daughter Zion: Metaphor and Dialogue in the Book of Lamentations », dans M. J. Boda, C. J. Dempsey, et L. S. Flesher (dir.), Daughter Zion: Her Portrait, Her Response, 101-126. Atlanta : Society of Biblical Literature.
Cook, Gregory D. 2016. « Nahum and the Question of Rape ». Bulletin for Biblical Research 26 (3) : 341-52.
Dobbs-Allsopp, F.W. et Tod Linafelt. 2001. « The Rape of Zion in Thr 1,10 ». Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 113 (1) : 77-81.
Driver, G.R. 1971. « Isaiah 6:1 ‘His Train Filled the Temple’ ». dans H. Goedicke (dir.), Near Eastern Studies in Honor of William Foxwell Albright, 87-96. Baltimore : Johns Hopkins University Press.
Entwistle, Joanne. 2001. « The Dressed Body » dans J. Entwistle et E. Wilson (dir.), Body Dressing, 33-58. Oxford : Berg.
Eslinger, Lyle. 1995. « The Infinite in a Finite Organical Perception (Isaiah VI 1-5) ». Vetus Testamentum 45 (2) : 145-73.
Finitsis, Antonios (dir.). 2019. Dress and Clothing in the Hebrew Bible: « For All Her Household Are Clothed in Crimson ». Londres : T&T Clark. ———. 2022. Dress Hermeneutics and the Hebrew Bible: « Let Your Garments Always Be Bright ». Londres : T&T Clark.
Floyd, Michael H. 2012. « The Daughter of Zion Goes Fishing in Heaven », dans M. J. Boda, C. J. Dempsey, et L. S. Flesher (dir.), Daughter Zion: Her Portrait, Her Response, 177-200. Atlanta: Society of Biblical Literature.
Flynn, Shawn. 2019. « YHWH’s Clothing, Kingship, and Power: Origins and Vestiges in Comparative Ancient Near Eastern Contexts », dans A. Finitsis (dir.), Dress and Clothing in the Hebrew Bible: « For All Her Household Are Clothed in Crimson », 11-28. Londres : T & T Clark.
Fox, Nili S. 2009. « Gender Transformation and Transgression: Contextualizing the Prohibition of Cross-Dressing in Deuteronomy 22:5 ». dans N. S. Fox, D. A. Glatt-Gilad, et M. J. Williams (dir.), Mishneh Todah: Studies in Deuteronomy and Its Cultural Environment in Honor of Jeffrey H. Tigay, 49-72. Winona Lake : Eisenbrauns.
Guest, Deryn. 1999. « Hiding Behind the Naked Women in Lamentations: A Recriminative Response ». Biblical Interpretation 7 (4) : 413-48.
Hens-Piazza, Gina. 2017. Wisdom Commentary: Lamentations. Collegeville : Liturgical Press.
Hooker, Alan. 2014. « “Show Me Your Glory”: The Kabod of Yahweh as Phallic Manifestation? », dans O. Creangă et P-B. Smit (dir.), Biblical Masculinities Foregrounded, 17-34. Sheffield : Sheffield Phoenix Press.
Hundley, Michael B. 2011. Keeping Heaven on Earth: Safeguarding the Divine Presence in the Priestly Tabernacle. Tübingen: Mohr Siebeck.
Hunt, Carole. 2014. « Worn Clothes and Textiles as Archives of Memory ». Critical Studies in Fashion & Beauty 5 (2) : 207-32.
Jastrow, Marcus. 2004 [1971]. המילים ספר : Dictionary of the Targumim, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi and Midrashic Literature. New York : Judaica Treasury.
Kalmanofsky, Amy. 2021. « The Sound and the Fury: Women and Suffering in Ezekiel and Lamentations », dans H. A. Thomas et B. N. Melton (dir.). Reading Lamentations Intertextually, 110-122. Londres : T&T Clark.
Lanner, Laurel. 2006. « Who Will Lament Her? »: The Feminine and the Fantastic in the Book of Nahum. New York: T & T Clark.
LeMon, Joel M. et Richard A. Purcell. 2019. « The Garments of God. Iconographic Case Studies from Isaiah 6 :1; 59 :17; and 63:1-6 », dans C. Berner et al. (dir.). Clothing and Nudity in the Hebrew Bible, 269-287. Londres : T&T Clark.
Létourneau, Anne. 2020. « Genre et beauté en 2 S 13-18 : Tamar, Absalom et la violence de l’idéologie royale », dans D. Couture, A. Létourneau et É. Pouliot (dir.), Égalité femme-homme et genre. Approches théologiques et bibliques, 3-26. Leuven : Éditions Peeters.
Levitt, Laura. 2020. The Objects That Remain. University Park : Penn State University Press.
Linafelt, Tod. 2000. Surviving Lamentations: Catastrophe, Lament, and Protest in the Afterlife of a Biblical Book. Chicago : University of Chicago Press.
Maier, Christl M. 2008. Daughter Zion, Mother Zion: Gender, Space, and the Sacred in Ancient Israel. Minneapolis : Fortress Press.
Mandolfo, Carleen. 2007. Daughter of Zion Talks Back to the Prophets: A Dialogic Theology of the Book of Lamentations. Atlanta : Society of Biblical Literature.
Nissinen, Martti. 2014. « Biblical Masculinities: Musings on Theory and Agenda », dans O. Creangă et P-B. Smit (dir.), Biblical Masculinities Foregrounded, 271-285. Sheffield : Sheffield Phoenix Press.
Parrott, S.J. 2022. Dressed to the Nines, Stripped to the Bones: The Symbology and Rhetoric of YHWH’s Acts of Investiture and Divestiture of Dress in Prophetic Literature. Thèse de doctorat, Université d’Oxford.
Parrott, S. J. 2023. The Conceptualization of Dress in Prophetic Metaphors. Leiden : Brill.
Pellegrin, Nicole. 2000. « Des mots et des lisières. Rêveries lexicales et propos liminaires », dans F. Cousin, S.Desrosiers, D. C. Geirnaert-Martin et N. Pellegrin (dir.) Lisières & bordures : actes des premières journées d’études de l’Association française pour l’étude du textile, Paris, 13-14 juin 1996. Trames & savoirs, 11-28. Bonnes : Gorgones.
Pham, Xuan Huong Thi. 1999. Mourning in the Ancient Near East and the Hebrew Bible. Sheffield : Sheffield Academic Press.
Popko, Łukasz. 2010. « What Has Happened with Jerusalem in Jer 13:26? » Revue Biblique 117 (4) : 510-27.
Quick, Laura Elizabeth. 2021. Dress, Adornment and the Body in the Hebrew Bible. Oxford : Oxford University Press.
Roberts, J. J. M. 2015. First Isaiah: A Commentary. Minneapolis : Fortress Press.
Römer, Thomas. 2009. « Le dossier biblique sur la statue de YHWH dans le premier Temple de Jérusalem : Enquêtes scripturaires à travers la Bible hébraïque », Revue de Théologie et de Philosophie 141 (4) : 321-342.
Salters, Robert B. 2011. A Critical and Exegetical Commentary on Lamentations. Londres : T & T Clark.
Sauvage, Caroline. 2021. « Senses and Textiles in the Eastern Mediterranean: Late Bronze and Early Iron Ages (1550–1100 BCE) », dans K. Neumann et A. Thomason (dir.), The Routledge Handbook of the Senses in the Ancient Near East, 35-61. New York : Routledge.
Schipper, Jeremy et Jeffrey Stackert. 2013. « Blemishes, Camouflage, and Sanctuary Service: The Priestly Deity and His Attendants ». Hebrew Bible and Ancient Israel 2 (4) : 458-478.
Smoak, Jeremy D. 2019. « Wearing Divine Words: In Life and Death ». Material Religion 15 (4) : 433-55.
Stallybrass, Peter. 1993. « Worn Worlds: Clothes, Mourning and the Life of Things ». The Yale Review 81 (2) : 35-50.
Stanes, Elyse. 2019. « Clothes-in-Process: Touch, Texture, Time ». Textile: The Journal of Cloth and Culture 17 (3) : 224-45.
Stavrakopoulou, Francesca. 2021. God: An Anatomy. Londres : Picador.
Thomason, Alison. 2019. « Clothing and Nudity in the Ancient Near East: Archeological and Iconographical Aspects », dans C. Berner et al. (dir.). Clothing and Nudity in the Hebrew Bible, 87-126. Londres : T&T Clark.
Vermeylen, Jacques. 2014. Le livre d’Isaïe une cathédrale littéraire. Paris : Les Éditions du Cerf.
Wagstaff, Bethany Joy. 2017. « Redressing Clothing in the Hebrew Bible: Material-Cultural Approaches ». thèse de doctorat inédite, Université of Exeter. https://www.proquest.com/docview/2001109901/abstract/E5B363722B5B42ACPQ/1.
Watson, Wilfred G. E. 1986. Classical Hebrew Poetry: A Guide to its Techniques. Sheffield : JSOT Press.
Wendland, Kristin J. 2021. « Naming Jerusalem: Poetry and the Identity of the Personified City in Lamentations 1-2 ». Journal for the Study of the Old Testament 46 (1) : 64-78.
Williamson, H. G. M. 2018 [2006]. A Critical and Exegetical Commentary on Isaiah 1-27. Londres et New York : Bloomsbury & T & T Clark.
Biographie
Anne Létourneau est professeure agrégée à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal. Ses principaux domaines de spécialisation sont l’exégèse de la Bible hébraïque et les études féministes et de genres. Sa monographie Manger et mourir? Femmes étrangères dans la Bible hébraïque paraîtra en 2025 aux éditions Peeters. Ses publications les plus récentes s’inscrivent dans deux volets de recherche principaux : les questions croisées du genre, de la violence et du vêtement et l’intersection du genre et de l’animalité dans les textes bibliques.
Article Citation
Létourneau, Anne. « Jupes Bibliques : de l’ourlet divin à la robe sale de Jérusalem ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 1-26. https://doi.org/10.38055/FCT040105
Copyright © 2025 Fashion Studies - All Rights Reserved
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license (see: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)