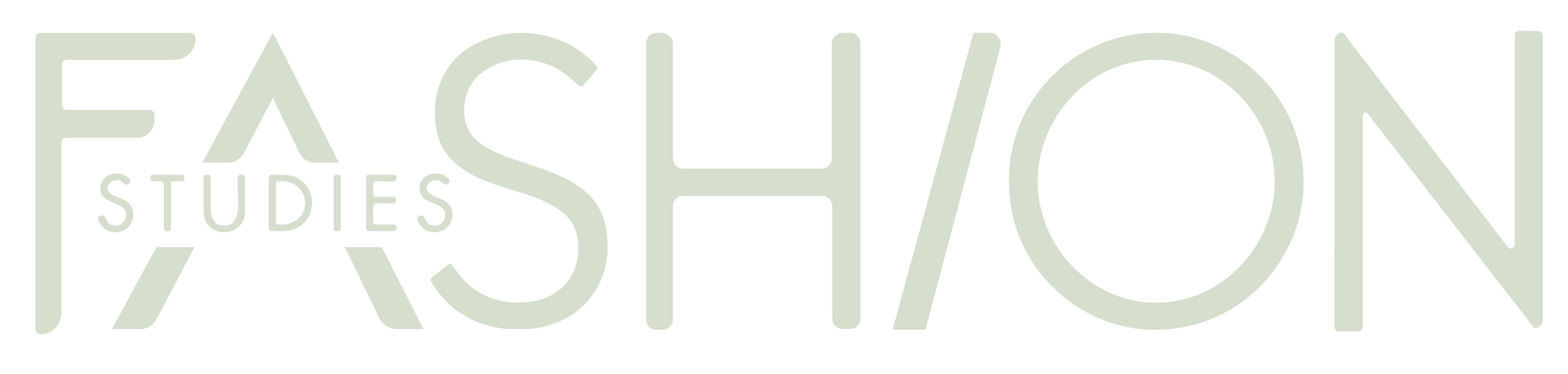La douleur quotidienne : Engagement du corps féminin dans la confection et l’entretien des vêtements au Québec
Par Laurence Provencher St-Pierre et Jocelyne Mathieu
DOI: 10.38055/FCT040106.
MLA: Provencher St-Pierre, Laurence, et Jocelyne Mathieu. « La douleur quotidienne : Engagement du corps féminin dans la confection et l’entretien des vêtements au Québec ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 1-19. https://doi.org/10.38055/FCT040106
APA: Provencher St-Pierre, L., et Mathieu, J. (2025). La douleur quotidienne : Engagement du corps féminin dans la confection et l’entretien des vêtements au Québec. Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, 4(1), 1-19. https://doi.org/10.38055/FCT040106
Chicago: Provencher St-Pierre, Laurence, et Jocelyne Mathieu. « La douleur quotidienne : Engagement du corps féminin dans la confection et l’entretien des vêtements au Québec ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies 4, no. 1 (2025): 1-19. https://doi.org/10.38055/FCT040106
Special Issue Volume 4, Issue 1, Article 6
mots-clefs
Corps
Quotidien
Douleur
Confection
Entretien
Résumé
Les gestes répétés modèlent le corps et fixent les postures. L’histoire et l’anthropologie du travail en ont souvent fait la démonstration, notamment en ce qui concerne le corps de l’ouvrier. Qu’en est-il sur le plan du travail domestique ? La production et l’entretien des vêtements ont traditionnellement été associés au travail féminin et occupent une part importante du temps de travail à la maison. Valorisé dans le discours moral et religieux de l’époque, ces tâches domestiques sont un moyen pour la femme, de la fin du 19e jusqu’aux milieu du 20e siècle, de démontrer ses qualités de bonne maitresse de maison, d’élever son âme et de rendre meilleure sa famille. Ce travail était-il souffrant ? Pour cerner cette douleur soupçonnée, les magazines féminins, les manuels d’économies domestiques et les journaux s’avèrent être des sources à explorer. Ils illustrent la place qu’occupaient les travaux de confection ou d’entretien des vêtements dans le quotidien et l’engagement de toutes les parties du corps que ces tâches nécessitent. La douleur occasionnée par cette besogne pouvait donc se manifester n’importe où sur le corps des femmes, de la tête aux pieds. Cette fatigue physique et mentale s’énonçait de manière cohérente avec la mentalité de l’époque. Néanmoins, les traces de la difficulté, de l’effort physique ou de la douleur, liées aux travaux domestiques, étaient rares et évoquées de manière détournée dans les journaux et les magazines, les femmes ne se plaignant pas. Les mentions de la pénibilité des tâches domestiques émergent dans des discours a posteriori, lorsque la technologie permit de faciliter la tâche quotidienne ; on rappelle alors comment les anciennes manières de faire étaient inconfortables, désagréables, difficiles ou douloureuses. Le contexte socio-culturel de l’époque semble empêcher la femme de percevoir la douleur ou, du moins, de s’en plaindre.
Les gestes répétés modèlent le corps et fixent les postures. L’histoire et l’anthropologie du travail en ont souvent fait la démonstration, notamment en ce qui concerne le corps de l’ouvrier (Pillon, 2012, 2014). Qu’en est-il sur le plan du travail domestique ? La production et l’entretien des vêtements ont traditionnellement été associés au travail féminin et occupent une part importante du temps de travail à la maison. Valorisées dans le discours moral et religieux de l’époque,[1] ces tâches domestiques non rémunérées sont un moyen pour les femmes de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e de démontrer leurs qualités de bonnes maitresses de maison, d’élever leur âme et de rendre meilleure leur famille. Elles s’insèrent dans les rituels domestiques que chaque ménagère, urbaine ou rurale, se doit d’accomplir sans relâche (Lemieux et Mercier, 1992). Comme le rappelle les manuels de l’époque, « [à] la ville ou à la campagne, la femme dirige et surveille tout ce qui se fait dans l’intérieur de la maison ; elle doit maintenir la propreté et établir la régularité qui faciliteront toutes les tâches de l’entretien du foyer » (Gallet, 1947, p. 7). La ménagère administre les dépenses quotidiennes, la nourriture, les vêtements, l’entretien du logement, les soins et l’éducation des enfants tout en étant appelée à offrir du soutien à son époux, à trouver des sources de revenus supplémentaires et à participer à des réseaux d’échanges et d’entraide (Baillargeon, 1991, p. 24).
Depuis une cinquantaine d’années, les analyses et les débats féministes concernant le travail domestique ont montré que ce dernier est indispensable au fonctionnement et au maintien de l’organisation économique et sociale (Ibid. p. 25). La rationalisation du travail domestique entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle, en Amérique du Nord comme en Europe, en fait à la fois une science du ménage et en un art ménagé qui s’apprennent et se maitrisent (Blunden, 1982 ; Perrot, 2023 ; Werner, 1984).
Était-il cause de souffrances ? Les heures passées au métier à tisser, le lourd fer à repasser à soulever et à déplacer, les vêtements à frotter vigoureusement sur la planche à laver… Les femmes devaient-elles souffrir pour habiller leur famille ? Nos sensibilités contemporaines projettent sur le travail domestique de ces femmes le sentiment d’un travail pénible, voire insupportable. Or, quelle perception de ce travail se dégage du discours de l’époque ?
Pour cerner cette douleur soupçonnée, les manuels d’économies domestiques, les magazines féminins ainsi que les journaux s’avèrent des sources à explorer car elles sont susceptibles de contenir des traces de cette douleur quotidienne présumée. Pour saisir l’importance de cette responsabilité féminine, il est utile de rappeler, d’abord, les gestes rattachés à la confection et à l’entretien des vêtements ainsi que leur poids dans l’organisation quotidienne du foyer. Ensuite, l’analyse permet de cibler les différentes formes de douleurs quotidiennes qui s’y rattachent et d’interroger la variabilité de leur perception.
Figure 1
Publicité du Dr. Chase Nerve Food. Source : La Canadienne : le magazine du Canada français, volume 1, numéro 5, juillet 1920, p. 45.
[1] Le discours normatif, notamment de l’Église, est attesté et s’observe tant en Europe qu’en Amérique. Voir, entre autres, Frédérique El Amrani-Boisseau (2012) Nadia Fahmy-Eid et Micheline Dumont (1983).
Manuels et modèles
Dans la société traditionnelle, la confection des vêtements s’inscrit dans un artisanat de subsistance impliquant toutes les étapes de transformation, de la graine de lin jusqu’à la couture ; du mouton, au gilet. Cela vaut d’abord pour le milieu rural, mais aussi en ville, alors que la mère de famille doit coudre et tricoter pour subvenir aux besoins des siens. Si, au 19e siècle, la production textile artisanale est largement intégrée à la vie quotidienne des familles du Québec, l’industrialisation entraine une baisse progressive de la production des textiles domestiques avant que celle-ci soit revalorisée dans les premières décennies du 20e (Lamontagne et Harvey, 1997).
Ces regroupements deviennent peu à peu des repères pour les femmes qui veulent apprendre ou perfectionner certaines techniques. Au Québec, à partir de 1937, les arts domestiques font partie du cursus scolaire obligatoire des jeunes filles (Mathieu, 2003 ; Thivierge, 1982) ; cette formation s’inscrit dans un contexte de crise économique et de guerre qui favorise la confection des vêtements et leur entretien afin de prolonger leur durée de vie (Baillargeon, 1991).
Les manuels d’économie domestique diffusés au Québec renseignent sur la place qu’occupent la fabrication et l’entretien des vêtements dans l’emploi du temps journalier, hebdomadaire et saisonnier des femmes. Par exemple, dans L’Économie domestique à l’école primaire supérieure et aux cours de lettres-sciences datant de 1942, trois jours par semaine, soit près de la moitié du temps hebdomadaire, sont spécialement consacrés au travail relatif aux vêtements et aux textiles ; le lundi est dédié au lavage, le mardi au repassage et le mercredi au raccommodage et à la confection. À ce rythme hebdomadaire se superpose celui des changements de saisons qui marquent aussi une intensité particulière de travail en ce domaine car il faut réviser les garde-robes pour trier, remiser, réparer puis coudre pour la saison qui commence. Les périodes de fêtes ajoutent aux obligations sociales du bien paraître alors qu’il faut se présenter sous son meilleur jour en arborant des toilettes de circonstance. Toutes ces exigences coutumières d’horaire et de convenances exercent une pression indue sur les femmes de qui on attend beaucoup. Impossible pour elles de céder à la fatigue ou à la maladie en ces circonstances.
Outre l’horaire suggéré dans les ouvrages destinés à l’éducation des futures maitresses de maison, les manuels d’économie domestique proposent quelques conseils et rappellent que la gestion des vêtements de la famille est particulièrement chronophage, comme en témoigne l’extrait suivant :
S’il n’est pas séant de toujours s’occuper de chiffons et de dentelles, admettons tout de même que le vestiaire de la famille absorbe pour sa confection, son entretien et sa réparation, une grande part des heures de la ménagère […]. Chaque soir on voit à la correction des vêtements du jour ; après la lessive, on met à part le linge avarié qu’on répare dès le lendemain à l’heure prévue par le tableau de l’emploi du temps ; le lundi et au lendemain des fêtes, on s’occupe des toilettes portées la veille, les nettoyant, les remettant à point, […]. (L’économie domestique à l'école primaire supérieure et aux cours de lettres-sciences, 1942, p. 11)
Dans l’horaire ici proposé, l’ordre des activités s’inscrit dans une logique d’efficacité. Chaque jour, l’avant-midi est consacré à une tâche particulière : le lavage, le repassage, le raccommodage ou la confection. Les travaux de couture peuvent se faire l’après-midi, et le reprisage le soir, dans la salle où se réunissent les membres de la famille pour la veillée.
Les manuels renseignent également sur les gestes eux-mêmes : quels sont-ils ? Comment les exécuter ? Dans quel ordre ? Dans quelles conditions ? Pour la confection des vêtements, les jeunes filles apprennent les techniques de filage, de tissage, de couture, de tricot et de broderie ainsi que la posture idéale à adopter lorsqu’elles pratiquent ces activités. De même, pour l’entretien des vêtements, les manuels enseignent tous les gestes liés au lavage, au blanchissage, au repassage, au brossage et à la réparation ou au reprisage.
Figure 2
Le lavage des vêtements Source : L’économie domestique à l’école complémentaire, 1950, p. 112.
Figure 3
Le repassage. Source : L’économie domestique à l’école primaire, 1929, p. 243.
[2]
Les Cercles de fermières sont une association féminine et constituent des réseaux de solidarité locaux et régionaux. Ces regroupements visent le progrès technique et social. Ils valorisent, entre autres, l’artisanat, notamment des arts textiles comme en font foi leurs expositions et leurs concours annuels. Les Cercles de fermières s’inscrivent dans un mouvement international, surtout occidental, à visées éducatives et socio-économiques. Pour en savoir plus, consulter Jocelyne Mathieu, « Les Cercles de fermières : cent ans d’expertise et d’engagement dans les arts textiles », Les Cahiers des Dix, no 68, Québec, Les Éditions La Liberté, 2014, p. 93-118 et Yolande Cohen, Femmes de parole: L'histoire des cercles de fermières du Québec, 1915-1990 (Montréal : Le Jour, 1990).
Les illustrations qui accompagnent les textes de ces volumes mettent en scène des personnages se tenant le dos droit et arborant un visage neutre, sans émotion. Pourtant, s’occuper des siens n’est-il pas supposé être un plaisir pour la ménagère ? C’est ce qui ressort du discours de l’époque dans lequel le travail domestique est synonyme de santé et de bonheur, comme l’affirme la journaliste et communicatrice Françoise Gaudet-Smet[3] qui écrit dans le Bonheur du jour : « Les outils de ta santé, il faut que tu en fasses le tour au jour le jour : ah ! La tête, ah ! Les pieds, ah ! Les ailes ! ah ! les mains, ah ! Le ventre ! Et maintenant, lève-toi et marche… » (Gaudet-Smet, 1980, p. 19).
Pour sa part, l’auteur du Livre de la maîtresse de maison précise que : « La qualité fondamentale dont il importe qu’une maîtresse de maison soit pénétrée…, c’est l’esprit d’ordre … qui est une vertu. » (Combes, 1952, p. 26-27) Il ajoute que : « la base de l’organisation rationnelle du foyer, tant du point de vue moral qu’au point de vue matériel, c’est la recherche du bonheur domestique. » (p. 29)
Comme l’écrit l’agronome Armand Létourneau dans Le bulletin des agriculteurs, « Tant vaut la femme, tant vaut la ferme » (14 septembre 1918, p. 9).
[3] Journaliste et communicatrice, Françoise Gaudet-Smet (1902-1986) écrit dans des journaux, des revues (dont certaines qu’elle a créées comme la revue Paysana publiée de 1938 à 1949), participe à des émissions de télévision, donne des conférences et publie divers ouvrages s’adressant aux femmes.
Figure 4
Le brossage des vêtements. Source : L’économie domestique à l’école primaire supérieure et aux cours de lettres-sciences, 1942, p. 157.
Les formes de la douleur quotidenne
Entre le discours véhiculé et la réalité des gestes à poser, on peut se demander en quoi ce travail pouvait être douloureux physiquement. Pendant les travaux de confection ou d’entretien, tout le corps féminin est en alerte. Toutes les parties du corps sont sollicitées ; ces opérations engagent le dos, les épaules, les bras, les mains, les yeux. C’est sans compter le travail minutieux que, par exemple, le raccommodage ou la couture réclame, l’attention ainsi nécessaire provoquant une fatigue à la fois physique et mentale. La douleur peut donc se manifester n’importe où, de la tête aux pieds. Les messages publicitaires livrent quelques indices sur ce mal en ventant des produits supposément efficaces, voire miraculeux, pour le contrer.
Figure 5
Publicité du Dr. Chase Nerve Food. Source : La Canadienne : le magazine du Canada français, volume 5, numéro 3, juin 1922, p. 35.
Le mal de dos et les douleurs musculaires
Les références aux maux de dos ou aux douleurs musculaires sont, somme toute, assez fréquentes. Il existe de multiples publicités proposant des médicaments contre les maux de dos dans les journaux et les magazines. Cette douleur n’est pas spécifique au travail du vêtement, mais l’iconographie démontre que la femme est souvent le public ciblé par les publicitaires. De plus, les publicités, les journaux et les magazines proposent à leur lectorat féminin différents conseils d’aménagement intérieur afin d’éviter les blessures et les douleurs produites par leur travail quotidien. Il est question de l’organisation de la maison, notamment de la cuisine qui sert aussi de lieu pour la couture et le lavage des vêtements lorsque les foyers n’ont pas de pièces dédiées à ces usages ; les femmes sont aussi sensibilisées à l’importance d’avoir un évier et un comptoir à la bonne hauteur. Dans les manuels, la femme est invitée à ne pas courber le dos lors des travaux domestiques, mais plutôt à fléchir les genoux si elle doit se pencher ; à ajuster le matériel à sa hauteur ; à utiliser un tabouret plutôt qu’une chaise en cas d’inconfort. Une posture confortable est à la base d’une bonne hygiène de travail. Les manuels d’économie domestiques enseignent que « [l]es diverses attitudes du corps témoignent, elles aussi, de la distinction de la personne et de son sans-gêne. La dignité suppose assez de mortification pour s’interdire une posture nonchalante, un pas précipité ou traînant. » (L’économie domestique à l’école complémentaire, 1950, p. 243). Assise, par exemple, pour coudre ou repriser, il est suggéré de poser ses pieds sur un tabouret ou tout dispositif permettant de diminuer la tension du bas du dos et des jambes.
Le lavage et le repassage des vêtements demeurent des besognes particulièrement éreintantes.
La machine à laver va transformer le travail de la lessive. Les ménages se dotent d’abord de machines manuelles, puis de modèles hydrauliques ou à gaz, avant d’adopter des modèles électriques. Chacun de ces appareils diminue l’engagement du corps dans le processus de lavage. L’apparition des lessiveuses-essoreuses électriques à partir de 1920 va aussi entrainer un assouplissement de la tâche. Le fer à repasser électrique permet de passer d’un fer en fonte pesant environ huit kilos à un fer électrique dont les premiers modèles pèsent autour de trois kilos. Toutefois, bien que ces appareils soient disponibles sur le marché, d’une part, tous les foyers n’ont pas encore accès à l’électricité à la maison, un service qui s’étend lentement aux campagnes au cours de la première moitié du 20e siècle et, d’autre part, tous n’ont pas les moyens financiers pour acquérir ces appareils. Leur adoption demeure relative et graduelle. L’ethnologue Suzanne Marchand démontre que l’acquisition des appareils électroménagers est restée limitée entre 1910 et 1940 ; il s’agit de biens de consommation de luxe. Néanmoins, 74% des foyers québécois ont une machine à laver en 1948 (Marchand, 1988). Si la lessiveuse entraine un allégement relatif de la tâche sur le plan de l’effort physique, elle a toutefois un impact limité sur la durée de la tâche qui prend encore toute la journée : « Entourée d’une kyrielle d’appareils et de produits supposés leur économiser temps et énergie, les ménagères québécoises n’en continueront donc pas moins à accomplir des tâches astreignantes et d’autant plus répétitives que les nouveaux appareils électroménagers constitueront en fait une invitation au travail. » (Marchand, 1988, p. 13) Soulignons que, malgré les innovations, le déplacement des vêtements mouillés, l’habilité nécessaire pour essorer les vêtements sans se pincer les doigts dans le tordeur de la machine à laver, étendre le linge sur la corde, tout cela en exposant ses qualités de ménagère attentionnée, demeurent.
Figure 6
L’usage du tabouret est recommandé afin d’éviter douleur au dos. Source : L’économie domestique à l’école primaire, théorie et pratique, 1936, p. 95.
Les brûlures
Un autre risque associé à l’entretien des vêtements est celui de se brûler. Certains conseils pour éviter les brûlures sont d’ailleurs partagés dans les pages des journaux s’adressant directement au lectorat féminin. C’est notamment le cas dans « La Page féminine » que tient Jeanne Métivier-Desbiens dans Le Devoir. Dans une rubrique du 21 août 1935 intitulée « La sécurité à la maison », la journaliste conseille de remplacer « [l]es bâtons dont on se sert pour remuer le linge dans la lessiveuse » par « des pinces bien plus commodes permett[ant] d’agir avec bien plus de précision, sans risque de projeter sur soi le savonnage bouillant » (p. 5).
Le risque de brûlure est également la principale blessure associée à la tâche du repassage ; elle est suffisamment fréquente pour que, dans les années 1910, elle soit mentionnée dans les publicités d’onguent et de crème médicamenteuses.
Suzanne Marchand rappelle que « les fers en fonte devaient être réchauffés au moins toutes les cinq minutes sur le poêle, ce qui signifiait, outre le danger constant de se brûler, de devoir travailler à une température ambiante élevée (surtout l’été) » (Marchand, 1988, p. 11). En ce qui concerne la lessive, les mains ne sont pas épargnées ; les produits utilisés pour le lavage des vêtements sont aussi sources de douleurs. Dans L’enseignement primaire, journal d’éducation et d’instruction, une leçon sur le savon et la lessive reproduit une discussion entre le maitre et l’élève. Le maitre conclut sa leçon en disant :
N’oubliez jamais cela. Si vous demandez pourquoi on emploie le savon plutôt que la soude pour se laver, je vous dirai simplement de regarder les mains de vos pauvres mères lorsqu’elles viennent de lessiver. Les avez-vous vues déjà, d’un violet pâle, contractées, endolories, gercées, parfois saignantes ? C’est que la soude et la potasse ne respectent pas plus les mains que les taches. Elles rongent tout sans pitié. Il faut un grand amour de la propreté pour s’exposer volontairement à leur action brutale. Mais les mamans aiment tant leurs enfants qu’elles ne reculent pas [devant] la souffrance pour les voir beaux et propres. Elles leur laissent le doux savon qui nettoie et gardent pour elles la soude ou la potasse qui brûlent. (« Leçon de choses, Le savon et la lessive », 1910, p. 147)
Figure 7
Publicité Zam-buk. Source : La Presse, 3 mars 1922, p. 7.
La Fatigue des Yeux
Une autre douleur qui se dégage des sources consultées est celle des yeux. On associe la confection et l’entretien des vêtements à une douleur ou à une fatigue visuelle. On sait que pour les couturières, avoir une bonne vue est essentiel. Si bien que des entreprises – à l’instar de Dominion Corset, qui fabriquait des sous-vêtements féminins – offraient à leurs employés des examens de la vue pour s’en assurer (Berger et Mathieu, 1993, p. 122). Les ouvrages d’économie domestique donnent des règles d’hygiène oculaire qui invitent à tenir compte de la lumière. La jeune fille est mise en garde contre « [u]ne lumière éclatante, vive et continue, une lumière trop faible [qui] irrite l’appareil de la vision ». Il est précisé que « [l]a lumière diffuse et réfléchie, la seule qui soit sympathique à la vision, ménage la sensibilité de la rétine et s’adapte le mieux à la conservation et à l’intégrité de l’oeil. » Les femmes sont invitées à « […] ne jamais s’asseoir en face de la fenêtre : le soleil tombant en plein sur le livre ou l’ouvrage peut occasionner des clignotements d’yeux, des étourdissements et des maux de tête. » Il leur est vivement recommandé, « [p]our coudre ou écrire, [de] se placer de manière à recevoir la lumière d’en haut ou de gauche. Autrement, si elle venait de droite à gauche, elle projetterait l’ombre de la main sur l’ouvrage, ce qui empêche de bien voir et fatigue la vue. » (L’économie domestique à l’école primaire complémentaire, 1929, p. 165)
La lumière artificielle et ses effets possibles sur la vision des femmes qui travaillent tard le soir sont également sources de suspicions. Un optométriste rappelle encore l’importance pour la ménagère d’avoir une vue « nette et précise ». Il explique que les femmes qui se rendent en clinique d’optométrie « se plaignent de leur incapacité à lire, à coudre, à regarder la télévision. De plus, les maux de têtes les assaillent durant leurs travaux de ménage. Les douleurs visuelles se présentent aussi sous d’autres formes. Ces femmes se sentent déprimées. Leur tâche pèse sur leurs épaules. » (Dr Alain Langis, (1er novembre 1963), « chronique visuelle » La voix du Sud, p. 2).
Figure 8
Les dangers de travailler à la lumière artificielle. Source : Économie domestique à l’école primaire, 1929, p. 157.
Figure 9
Publicité du Dr. Chase Nerve Food. Source : La Canadienne : le magazine du Canada français, volume 2, numéro 3, novembre 1920, p. 50.
Une Douleur Intérieure
À la fatigue des yeux s’associe la fatigue des nerfs. Les publicités du Dr. Chase, diffusées dans la revue La Canadienne, vantent des suppléments alimentaires aux multiples vertus. Certains de ces messages publicitaires identifient des travaux de couture comme une des causes de la dépression nerveuse et avertissent les femmes du danger qui les menace : « Rien ne déprime autant le système nerveux que la tension continue de la vue. Vous pouvez croire que coudre est un travail léger et cependant vous vous demandez pourquoi il vous fatigue. La tension du regard en est la cause. » (Publicité du Dr. Chase Nerve Food, La Canadienne, mai 1920, p. 47) Dans un autre numéro de la revue, la même compagnie déclare :
Malheureusement la mère de famille qui est très occupée est forcée de laisser de côté le reprisage jusqu’au moment de tranquillité qu’elle aura quand les enfants auront été mis au lit. Cela la force à travailler à la lumière artificielle, ce qui entraine un surmenage spécial des yeux. C’est ce surmenage des yeux qui fait que l’on se sent si fatiguée après avoir reprisé, cousu, magasiné ou travaillé à quelqu’ouvrage de fantaisie. […] [L]’effort des yeux produit la fatigue et souvent provoque la dépression nerveuse. (Publicité du Dr. Chase Nerve Food, La Canadienne, novembre 1920, p. 50)
Sur l’image de cette publicité, la femme représentée, assise en train de repriser, est légèrement courbée sur son ouvrage. Son regard et ses traits donnent une impression de lassitude, voire de léger découragement. Trois ans plus tard, la compagnie utilise la même image, en adoucissant légèrement les traits de la femme, laissant entrevoir un visage un peu plus serein. L’image est accompagnée d’un texte sous forme de témoignage : « Je puis maintenant faire mon travail sans en ressentir de fatigue. Je souffrais d’épuisement et de débilité nerveuse […]. Aujourd’hui je me sens une tout autre femme, et puis vaquer à mes occupations sans ressentir cette affreuse lassitude. » (Publicité du Dr. Chase Nerve Food, La Canadienne, septembre 1923, p. 42).
L’association entre la vue et la fatigue nerveuse renvoie à une perception de la douleur cohérente avec l’époque. Dans son ouvrage Histoire de la fatigue (2020), l’historien Georges Vigarello montre comment, dans la 2ème moitié du 19e siècle, la fatigue est de mieux en mieux formulée. Elle est alors divisée en deux catégories possibles : soit elle est d’origine musculaire ; soit elle affecte la pensée. Vigarello précise que c’est à cette époque qu’on voit apparaitre le terme de surmenage : « La fatigue s’ouvre sur une histoire nouvelle, celle d’un immense versant intérieur, où l’impuissance à faire provoque hésitation et manque de confiance, obsession et malaise, voire affolement. » (2020, p. 249)
Vous avez dit douleur ?
Malgré les traces de l’effort physique lié à la confection et à l’entretien des vêtements repérés dans les manuels, les journaux et les magazines, les témoignages sont tout compte fait rares et les inconforts associés à ces tâches sont évoqués de manière détournée. Les femmes ne se plaignent pas.
Par exemple, à propos du lavage, on peut lire dans un manuel datant de 1896 : « On remplace maintenant la planche à laver par des calandres, (moulins à rouleaux) qui ménagent le temps et les doigts. » (Manuel d’économie domestique, 1896, p. 132) Dans un autre manuel, il est rappelé que grâce à la machine à laver, « on est dispensé de la dure corvée du frottage » et que « l’outillage perfectionné d’aujourd’hui en a beaucoup réduit la peine et les difficultés » (L’économie domestique à l’école primaire supérieure et aux cours de lettres-sciences, 1942, p. 69). Il semble que ce ne soit qu’une fois les fers électriques introduits dans les foyers qu’on en arrive à nommer l’inconfort des anciens fers en fonte, comme en témoigne une publicité de la compagnie électrique de Montmagny :
Pourquoi vous faire griller à la chaleur accablante du poêle, quand vous pouvez repasser avec tant de facilité et de confort à l’aide d’un fer électrique ? […] N’hésitez pas à vous le procurer ; vous éliminerez ainsi la chaleur épuisante du poêle, les allées et venues fatigantes – les maux de dos – les fatigues dans le poignet et nombre d’autres incommodités du repassage. (Publicité de la compagnie électrique de Montmagny, Le peuple de Montmagny, vendredi 29 avril, 1927, p. 2)
Au terme de cette exploration, on ne peut que constater que la douleur quotidienne est une « perception » pour ainsi reprendre les propos de David Le Breton qui écrit :
[La douleur] n’est pas une sensation mais une perception, c’est-à-dire la confrontation d’un événement corporel à un univers de sens et de valeur. Le ressenti n’est pas l’enregistrement d’une affection, mais la résonance en soi d’une atteinte réelle ou symbolique… Toutes les sociétés définissent implicitement une légitimité de la douleur qui accompagne des circonstances réputées physiquement pénibles. […] Là où il est socialement de rigueur d’endurer sa peine en silence, l’homme submergé qui donne libre cours à sa plainte encourt la réprobation. (Le Breton, 2005, p. 9)
Outre cette perception qui n’apparait parfois que de manière rétrospective, stimulée par les avancées technologiques, le contexte socio-culturel de l’époque semble également empêcher la femme (qui d’ailleurs n’a rien connu d’autre) de percevoir les douleurs quotidiennes ou, du moins, de s’en plaindre. Comme l’enseigne la science du ménage, tout serait une question d’organisation et d’efficacité. Être fatiguée ou avoir mal ne serait pas normal, cela traduirait plutôt une mauvaise organisation et de l’incompétence.
Dans l’ouvrage Le Coeur à l’ouvrage. Théorie de l’action ménagère, le sociologue Jean-Claude Kaufmann met en relation la notion de pénibilité rattachée à une tâche domestique, comme celle de repasser ou de ranger les vêtements, avec son degré d’incorporation, rappelant que « la pénibilité est le résultat d’une construction sociale » et que « c’est parce qu’une tâche n’est pas appréciée que la fatigue est ressentie. » (Kaufmann, 1997, p. 147-148) Conséquemment, le degré d’incorporation du geste, le contexte de l’activité ainsi que ses représentations individuelles et collectives influent sur le ressenti de la fatigue et la perception des douleurs associées à la tâche. Cette pénibilité n’est d’ailleurs pas propre au travail domestique. La femme ouvrière éprouve elle aussi tout au long du 20e siècle les conséquences des gestes répétés, du déplacement d’objets lourds, de l’effort physique, des longues journées de travail et de la fatigue (Pillon, 2014). Encore aujourd’hui, la souffrance expérimentée par les femmes dans divers milieux de travail peut être invisibilisée, ignorée ou sous-estimée par celles-ci (Messing, 2021).
Le travail domestique des femmes répond à une mission. Cette idée que l’abbé Albert Tessier – responsable provincial et inspecteur des écoles ménagères québécoises – présente dans son ouvrage intitulé Canadiennes en 1946, est reprise et martelée par le français Joseph Houyoux, visiteur assidu du Québec. En 1952, dans Le vrai visage des Écoles de Bonheur, il écrit : « La mission de la femme exige qu’elle mette du soleil et du bonheur à la maison…C’est à ce merveilleux résultat que tendent les Instituts familiaux du Québec. » (Houyoux, 1952, p. 45) Cette mission, soutenue par une éducation axée sur la science du ménage, répond aussi à l’idéologie capitaliste qui transforme le monde du travail depuis le milieu du 19e siècle. N’occupant pas un travail rémunéré à l’extérieur du foyer, les ménagères étaient exclues du calcul de la population active, les femmes ne représentant, en 1901, que 13% de la main-d’oeuvre canadienne (Connelly, 2015). Les discours valorisant un travail domestique efficace et productif cherchaient également à tenir la femme de la classe ouvrière à l’extérieur des usines alors que, comme le souligne Silvia Federici, « la respectabilité [était] devenue le dédommagement du travail non rémunéré et de la dépendance à l’égard des hommes » (2019, p. 140-141).
Après la Première Guerre mondiale, un mouvement de retour à la terre et de valorisation de la famille a mené à la création de plusieurs instituts à vocation d’éducation féminine, en cohérence avec un discours sur la place réservée aux femmes dans la société. Or, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et particulièrement la décennie des années 1950, a marqué un tournant déterminant des mentalités. Une rupture progressive s’est opérée avec les traditions, une prise de distance favorisée par une modernité technologique, celle-ci ouvrant la voie à un allègement des obligations domestiques. Après avoir été encouragées à devenir des « maîtresses de maison dépareillées »,4 les femmes sont peu à peu sorties de la maison, ce qui a inévitablement remis en question l’organisation du quotidien.
La douleur physique a-t-elle été évacuée grâce aux dispositifs automatiques qui mettent moins le corps à l’épreuve ? Sans doute, mais l’impression de souffrance, voire la souffrance ressentie, n’est-elle pas prolongée dans la lourdeur persistante de la tâche ? En raison de l’esprit d’abnégation qui leur était inculqué par l’Église et la société, les femmes, mères de surcroît, ne pouvaient ni ne devaient penser le moindrement à elles-mêmes. L’ère du sacrifice est toutefois révolue. Aujourd’hui, la prescription générale est d’éviter les souffrances à tout prix.
Bibliographie
Amrani-Boisseau, F. El (2012). Filles de la terre. Apprentissages au féminin (Anjou 1920-1950). Rennes : Presses universitaires de Rennes.
Baillargeon, D. (1991). Ménagères au temps de la crise. Montréal : les éditions du remue-ménage.
Blunden, K. (1982). Le travail et la vertu : femmes au foyer : une mystification de la Révolution industrielle : essai. Paris : Payot.
Cohen, Y. (1990). Femmes de parole : L’histoire des cercles de fermières du Québec, 1915-1990. Montréal : Le Jour.
Combes, P. (1952). Le livre de la maîtresse de maison. Avignon : Éditions Edouard Aubanel.
Connelly, M. P. (2015). Femmes dans la population active, L’Encyclopédie canadienne, https:// www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/femmes-dans-la-population-active
Du Berger, J. et J. Mathieu (dir.). (1993), avec la collaboration de M.Roberge et le Laboratoire d’ethnologie urbaine, Les ouvrières de la Dominion Corset à Québec 1886-1988. Québec, Presses de l’Université Laval.
Fahmy-Eid, N. et M. Dumont (1983). Maîtresses de maison, maîtresse d’école. Femmes, famille et éducation dans l’histoire du Québec. Montréal : Boréal Express.
Federici, S. (2019), L’invention de la ménagère. Le capitalisme patriarcal. Paris : La fabrique Éditions, p. 125-142.
Gallet, J. (dir.). (1947). La femme chez elle ; petite encyclopédie des travaux domestiques. Montréal : Éditions Pascal.
Gaudet-Smet, F. (1980). Bonheur du jour. Montréal : Leméac.
Houyoux, J. (1952). Le vrai visage des Écoles de Bonheur. Trois-Rivières : Éditions du Bien public.
Kaufmann, J.-C. (1997). Le coeur à l’ouvrage, théorie de l’action ménagère. Paris : Nathan.
Lemieux, D., et Mercier, L. (1992). Les femmes au tournant du siècle, 1880-1940 : âges de la vie, maternité et quotidien. Québec : Institut québécois de recherche sur la culture.
L'économie domestique à l'école complémentaire. (1950). Québec : Ateliers de l'Action catholique.
L'économie domestique à l'école primaire complémentaire. (1929). Montréal : Procure des missions.
L'économie domestique à l’école primaire supérieure et aux cours de lettres-sciences. (1942). Montréal : Congrégation de Notre-Dame de Montréal.
Lamontagne, S.-L. et F. Harvey. (1997). La production textile domestique au Québec, 1827- 1941 : une approche quantitative et régionale. Ottawa : Musée national des sciences et de la technologie.
Lebeaume, J. (2014). L’enseignement ménager en France. Sciences et techniques au féminin, 1880- 1980. Rennes : Presses universitaires de Rennes.
Le Breton, D. (2005). Douleur et anthropologie : esquisses. Frontières, 17(2), 7-12. « Leçon de choses, Le savon et la lessive » (1910). L’Enseignement Primaire : Revue illustrée de l’École et de la Famille, 31(3), 145-147.
Létourneau, A. (1918, 14 septembre) « Tant vaut la femme, tant vaut la ferme ; Un mot aux fermières», Le Bulletin des agriculteurs, 3(33), 9.
Manuel d’économie domestique. (1896). Montréal : Librairie Saint-Joseph.
Marchand, S. (1988). L’impact des innovations technologiques sur la vie quotidienne des Québécoises du début du XXe siècle (1910-1940). Material Culture Review/ Revue de la culture matérielle, (28), 1-14.
Mathieu, J. (2003). L’éducation familiale et la valorisation du quotidien des femmes au XXe siècle. Les Cahiers des dix, (57), 119-150.
Messing, K. (2021). Le deuxième corps. Femmes au travail, de la honte à la solidarité. Montréal : Éditions Écosociété.
Perrot, M. (2023). « À pas comptés ». Invention de la science ménagère et emploi du temps, de la fin du XIXe siècle aux années 1950. Communications, (1), 49-65.
Pillon, T. (2012). Le corps à l’ouvrage. Paris : Stock.
Pillon, T. (2014). Le corps ouvrier au travail. Travailler, 32, 151-169.
Thivierge, N. (1982). Écoles ménagères et instituts familiaux : un modèle féminin traditionnel. Québec: Institut québécois de recherche sur la culture.
Vigarello, G. (2020). Histoire de la fatigue : du Moyen Âge à nos jours. Paris : Éditions du Seuil.
Werner, F. (1984). Du ménage à l'art ménager : l'évolution du travail ménager et son écho dans la presse féminine française de 1919 à 1939. Le mouvement social, 61-87.
Biographies
Laurence Provencher St-Pierre est ethnologue et chargée de cours à l'Université Laval, à Québec. Titulaire d'une maitrise en ethnologie et patrimoine (Université Laval, 2012) et d'un doctorat en muséologie, médiation et patrimoine (Université du Québec à Montréal, 2020), ses recherches portent sur les pratiques de collectionnement dans les musées de société, le développement de l'ethnologie au Québec et l'étude du quotidien. Depuis janvier 2024, elle est également stagiaire postdoctorale à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal où elle mène des recherches sur la documentation des collections en contexte muséal.
Jocelyne Mathieu est professeure associée en ethnologie et patrimoine au Département des sciences historiques de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Laval, à Québec. Elle s’intéresse à la culture matérielle et aux coutumes, notamment en ce qui touche le costume et le textile, la vie domestique et quotidienne, les manières d’habiter, les arts populaires, en portant une attention spéciale à la vie des femmes, à leurs témoignages oraux et écrits. Elle a aussi été appelée à occuper plusieurs fonctions universitaires en gestion des études. Elle est membre de la Société des Dix depuis 2000 (fauteuil no 7).
Article Citation
Provencher St-Pierre, Laurence, et Jocelyne Mathieu. « La douleur quotidienne : Engagement du corps féminin dans la confection et l’entretien des vêtements au Québec ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 1-19. https://doi.org/10.38055/FCT040106
Copyright © 2025 Fashion Studies - All Rights Reserved
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license (see: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)