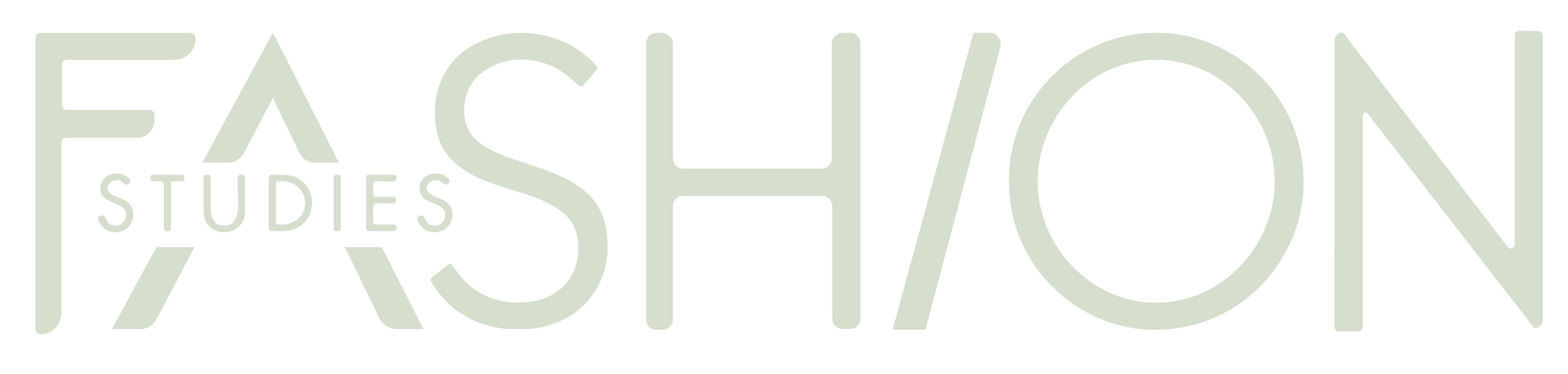Ornement, instrument et châtiment : Remarques sur l’habit religieux féminin dans le catholicisme français des temps médiévaux au XXe siècle
Par Nicole Pellegrin
DOI: 10.38055/FCT040101
MLA: Pellegrin, Nicole. « Ornement, instrument, et châtiment: Remarques sur l'habit religieux féminin dans le catholicisme français des temps médiévaux au XXe siècle ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 1-19. https://doi.org/10.38055/FCT040101
APA: Pellegrin, N. (2025). Ornement, instrument, et châtiment: Remarques sur l'habit religieux féminin dans le catholicisme français des temps médiévaux au XXe siècle. Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, 4(1), 1-19. https://doi.org/10.38055/FCT040101
Chicago: Pellegrin, Nicole. « Ornement, instrument, et châtiment: Remarques sur l'habit religieux féminin dans le catholicisme français des temps médiévaux au XXe siècle ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies 4, no. 1 (2025): 1-19. https://doi.org/10.38055/FCT040101
Special Issue Volume 4, Issue 1, Article 1
Mots-clefs
Habits religieux féminins
Identités
Pénitences
Violences
Résumé
« Quoy que la perfection Religieuse ne dépende pas de l’Habit, toutes-fois il en est le signe, & la marque », affirme la règle des Clarisses en 1659. Il en est aussi l’instrument du fait des contraintes physiques, morales et esthétiques qu’il impose.
Pesanteur, rugosité et pauvreté des tissus, incommodité et permanence des formes, uniformité au sein d’un même congrégation, indifférence aux conditions climatiques, difficultés d’entretien, sont autant de moyens d’une pénitence diversement consentie où le vêtement, tout à la fois, « distingue » et punit. Arraché ou dépecé, ne sert-t-il pas à dégrader sa porteuse en cas de faute grave ?
Une riche documentation - règlementaire, spirituelle et (auto) biographique - fait état de ces violences. Elles ne sont pas exclusivement symboliques et, pour être comprises, doivent être confrontées à de rares objets : pièces vestimentaires, « poupées de couvent », « boîtes de nonnes », imagerie, etc.
Je suis la plaie et le couteau (Baudelaire, L’Héautontimorouménos)[1]
Figure 1
Les dessous d’un mannequin (photos de vitrine du musée des Augustines de Québec). Crédit : Le Monastère des Augustines, collection du monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec.
[1] Baudelaire, OEuvres complètes, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1958, p. 1534-1535.
« Quoy que la perfection Religieuse ne dépende pas de l’Habit, toutes-fois il en est le signe & la marque ».[2] En ouvrant sur ces mots le chapitre XII de leurs Reglements et Coutumes (il est intitulé « Des Vestemens des Soeurs » et comporte treize pages), les Clarisses de Montbrison disaient, au milieu du XVIIe siècle, la fonction à la fois identitaire et pénitentielle de leurs habillements : parce qu’ils sont distinctifs, leurs vêtements les mettent à part et les glorifient ; mais pauvres, austères, et uniformes, ils les humilient tout autant et les dressent ou re-dressent, car ils servent à les tenir en contribuant à les briser, voire à les figurément crucifier grâce à une tenue et des accessoires appropriés.[3] Ils sont donc pleinement « signe » d’un langage partagé et la « marque », à l’instar des stigmates, d’une inscription quasi tégumentaire des souffrances incommensurables propres à l’imitatio Christi. Tout vêtement n’est-il pas d’ailleurs, en religion comme dans le monde profane, une seconde peau et son éphémère tatouage ?[4]
Pourtant, un « toutes-fois » sème le doute dans le texte d’apparence banale de ces Clarisses. Leurs considérations vestimentaires sont présentes dans tous les écrits de spiritualité, mais la fonction ornementale, à la fois nécessaire et pernicieuse, de tout habillement, y compris au couvent, semble y faire question.
Ne serait-il pas — partout et toujours — l’instrument idéal d’une progressive édification qui, faite de souffrances consenties et d’espérances angoissées, a eu ou pu avoir une grandiose (et perverse ?) efficacité, en soumettant-construisant-élevant des corps et des esprits grâce au pouvoir de décoration/ dé-naturation/ dé-corporation de toute parure?[5]
Une poignée d’images, choisies pour leur caractère diversement énigmatique introduiront des remarques fragmentaires, puisées dans un vaste ensemble de règlements monastiques et de textes hagiographiques, le tout voulant servir de points d’appui à une démonstration en trois étapes brèves.[6] Des étapes qui, traversant allègrement les siècles, pourraient s’intituler, à la manière partisane du très anticlérical romancier « fin-de-siècle » Octave Mirbeau (1848-1917) : « frontispice », « en mission » et « jardin des supplices ». [7]
[2] Reglements et Coutumes des pauvres religieuses du monastère de Sainte Claire de Montbrison, Lyon, Jacques Carteron, 1659, p. 87. La phrase suivante ajoute : « d’où vient que la diversité des habits dans la diversité des Ordres Religieux represente les différents Exercices des Vertus qu’on y observe plus parfaictement. Celles qui doivent plus paroitre dans nos habits, sont la Charité, l’Obeïssance, la Pauvreté, l’Austerité, & la Simplicité ». Montbrison, capitale du Forez, se trouve dans l’actuel département de la Loire (France). À noter que l’orthographe et la ponctuation des citations anciennes n’ont pas été modernisées.
[3] Le sens — mouvant et différencié — des mots liés au « redressement » par le vêtement mériterait attention. Pensons aux verbes anglais to dress, to redress, to stand, to straighten, etc. N’oublions pas que « tenue » fut, en matière vestimentaire, d’abord un terme militaire, avant de devenir une façon commune d’être habillé.
[4] N. Pellegrin, « Fleurs saintes. L'écriture des stigmates (XVIe-XVIIIe siècles », dans C. McClive et N. Pellegrin eds., Femmes en fleurs, femmes en corps. Sang, Santé, Sexualités, du Moyen-Âge aux Lumières, Saint-Étienne, PUSE, 2010, pp. 101-122.
[5] À noter qu’« Édifier », c’est bâtir, mais c’est aussi « porter à la piété » (A. Furetière, Dictionnaire universel […], La Haye et Rotterdam, Arnout & Reinier, 1690, non pag. : article « Edifier »). Voir le livre, pionnier mais oublieux des mondes religieux, de Georges Vigarello, Le Corps redressé [1978], rééd. Paris, Éditions du Félin, 2018.
[6] En l’absence de tenues complètes et précisément datées, ne pas oublier « la règle vivante », portée et transmise par les intéressées elles-mêmes, par ailleurs autrices et actrices anonymisées de leurs règlements et cela depuis le VIe siècle (Isabelle Réal, « Les normes monastiques à l’épreuve du genre », in Anne Baud et Alain Bauwel (dir.), Espaces monastiques au féminin, Vienne, Baraban, 2023, p. 16-20 ; entretiens réalisés en 2008 auprès des moniales de l’abbaye bénédictine de Sainte-Croix de Poitiers à Saint-Benoît, département de la Vienne, France).
[7] Octave Mirbeau, Le Jardin des supplices (1899), éd. par Michel Delon, Paris, Folio Classique, 2021. Je remercie vivement les organisatrices et tout l’auditoire du colloque Vêtir, faire et briser les corps tenu à Montréal en mai 2023 de m’avoir permis de condenser quelques éléments de mon cheminement au pays étrange des vestiaires monastiques.
I. Frontispice. L’extérieur d’un intérieur ou les leçons d’un tableau perdu
Choisir comme image première une gravure de 1743, signée Pierre-Louis de Surugue et inspirée d’un tableau perdu de Chardin, c’est interroger l’exotisme du peuple des couvents féminins, un monde peu accessible et aujourd’hui largement révolu, un monde où l’omniprésence du divin et du masculin ordonne, au propre comme au figuré, la totalité des faits, gestes et croyances de celles qui aspirent à vivre, loin du Monde, l’attente d’une mort rédemptrice dans l’union avec l’Absent, leur Époux. C’est aussi rappeler le rôle du vêtement dans ce processus de séparation distinctive.[8]
Sur l’image, une élégante petite fille en robe à carreaux, tablier clair et fleurettes dans les cheveux, est assise sur une chaise. Elle ne sourit pas, comme détachée du monde qui l’entoure. Elle porte et montre, de façon quelque peu distanciée, la forme rigide d’une effigie que son habillement de tissu classe immédiatement comme le simulacre d’une religieuse catholique : bandeau, voiles superposés, guimpe, manches et jupes très longues, scapulaire, ceinture de corde ponctuée de noeuds, masse d’enveloppes sombres, présence de quelques ornements blancs et d’une grande croix.
Ces vêtements situent dans le temps et dans l’espace la « poupée », ainsi que sa porteuse : un Ancien Régime sartorial qui s’est prolongé au moins jusqu’aux lendemains du concile dit de Vatican II, quand être et paraître devaient explicitement coïncider pour dire appartenances de genre, de statut, de (mi)lieu, d’âge, etc. — un temps où même les ordres monastiques et, à l’intérieur de ceux-ci, tous leurs membres, se distinguaient, au double sens de ce terme, grâce à des pièces vestimentaires spécifiques : la carmélite ne se vêt pas comme l’ursuline ou la franciscaine et, partout ou presque, la novice et la soeur-servante dite converse se singularisent par un voile blanc quand la professe le porte noir dans la plupart des ordres.[9]
Pourtant, ce qu’exhibe la gravure, ce sont autant les ressemblances que les différences entre les vêtements féminins profanes d’alors et les tenues traditionnelles des religieuses catholiques. Découvertes lors de travaux collectifs consacrés aux représentations tridimensionnelles de la vie monastique féminine (maquettes de bâtiments ou de cellules), les figurines de moniales qui habitent ces objets sont les cousines — miniaturisées — de plusieurs types de poupées : celles dites « de mode » destinées aux adultes, celles dont les enfants font leurs jouets, celles enfin, à finalité spirituelle et mémorielle, que j’ai nommées « poupées d’observance » et qui permettaient dans la plupart des monastères de garder la mémoire, palpable et incontestable, du vêtement règlementaire dans ses plus infimes détails : couleur et qualité des tissus, nombre et profondeur des plis, largeur des ourlets, quantité des épingles fixant le tout, etc. Soit une archive respectée, à garder dans « l’Archive des tiltres du Monastere […] afin qu’on ne perdît jamais l’esprit de conformité si nécessaire dans la religion ».[10]
L’intrigant portrait de Mademoiselle Mahon et sa poupée (titre originel du tableau perdu) ne saurait nous dire à quelle catégorie appartient exactement le petit mannequin de religieuse dont la fillette manipule — comme elle le ferait d’un chapelet — la ceinture-cordon. Annonce ou rejet d’une vocation monastique, l’attitude de la fillette et les intentions du portraitiste et de son commanditaire sont ambiguës.[11] Mais, par delà ses qualités esthétiques et morales, ce portrait est porteur d’enseignements variés sur la construction du féminin et le rôle — disciplinaire — de tout habillement.
Il faut noter en effet que malgré son décolleté, sa tête découverte et le bariolage de sa robe, la tenue de Mlle Mahon la tient, la rendant aussi corsetée et aussi fragile que sa poupée, comme si toutes deux étaient déjà absentes au Monde en leurs grandes robes à paniers, certes à la mode mais propres à leur genre, c’est-à-dire encombrantes et ouvertes, un revêtement du bas du corps bien différent du système fermé de la culotte qui a longtemps donné aux hommes d’Occident, agilité, légèreté, sécurité et assurance. Mais à cette contrainte physique commune à toutes les femmes d’alors, les règlements monastiques ajoutent une vaste série d’obligations d’ordre matériel et moral axées sur la double injonction de la pauvreté et de l’uniformité, des valeurs qui ont un caractère pénitentiel et — faut-il le rappeler ? — salvateur.
Figure 2
L’Inclination de l’âge (gravure d’après Chardin) en ligne, noir et blanc. Libre de droits: https://www. parismuseescollections.paris.fr/de/node/345097#infos-principales. Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris
[8] Voir l’article novateur de Marie-Elisabeth Henneau, « Se vêtir au couvent, quand on est femme ! », dans Quand l’habit faisait le moine. Une histoire du vêtement civil et religieux en Luxembourg, Bastogne, Musée de Piconrue, 2004, pp. 139-161 ; Christine Aribaud, « De la soie au drap : la scénographie de la vêture au Carmel (France, XVIIe-XVIIIe siècle) », Clio. Histoire, femmes et sociétés 36 | 2012, p. 91-108, et l’ensemble du volume dirigé par Isabelle Brian et Stefano Simiz, Les habits de la foi. Vêtements, costumes et religions du Moyen Âge à nos jours, Rennes, PUR, 2022.
[9] Fortement hiérarchisées, ces appartenances peuvent prendre des formes variables au cours du temps malgré leur prétendue intemporalité et suivre parfois — de très loin — la mode (N. Pellegrin, Voiles, une histoire du Moyen Âge à Vatican II, Paris, CNRS éditions, rééd. 2022, p. 291-381 ; « Folie ou Sagesse ? Un survol des modes monastiques féminines (XVIIe-XIXe siècles) » in Alberto Ambrosio et Nathalie Roelens (dir.), Modes modestes. Entre éthique et esthétique, Paris, Hermann, 2023, p. 21-42, ill.). Sur la « culture des apparences », voir le livre éponyme de Daniel Roche (Paris, Fayard, 1989) et, bien avant, celui d’Yvonne Deslandres, Le Costume, image de l’homme (Paris, Albin Michel, 1976).
[10] Pierre Fourier, Les Vrayes Constitutions des religieuses de la Congregation de Nostre-Dame […], s. l., s. n., 1649, p. 309, soit la fin des sept pages minutieuses du chapitre « Des Vestemens »). Sur maquettes et poupées, voir Élisabeth Lusset et Isabelle Heullant-Donat (dir.), Une vie en boîte. Cellules de religieuses et maquettes de couvent (XVIIIe-XXIe siècle), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2025. Parmi les rares communautés à conserver encore ces objets, celles des Augustines françaises et québécoises m’ont accueillie avec une gentillesse et une efficacité sans pareilles dont je les remercie (enquêtes en février 2023 à Morlaix et, entre 2000 et 2022, à Québec).
[11] Une ambiguïté renforcée par les vers intitulés L’Inclination de l’âge qui servent de légende, moralisante et générique, à la version gravée : on y apprend que l’enfance serait plus sage qu’il n’y paraît et encline, jusque dans ses jeux, à préférer aux mondanités la vie religieuse.
Figure 3a
Les dessous d’un mannequin (photos de vitrine du musée des Augustines de Québec) : en couleurs.
Figure 3b
Un pesant « feuilletage » vestimentaire : la mise en scène de la tenue des Augustines hospitalières de Québec du XVIIe au XXe siècle. Crédit : Le Monastère des Augustines, collection du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec.
C’est revêtir une panoplie, celle d’« épouse du Christ » et d’« amazone de Dieu ». Se faire guerrière et amoureuse éperdue. S’oublier, pour cela, dans l’obéissance et tenter d’obtenir, par la prière permanente et la quête — participative — de la douleur, les joies ineffables de « l’Union » avec Jésus et ses saint-e-s. Extérioriser donc, mais avec gravité et modestie, le choix de la désappropriation (de soi comme de tout bien matériel) et un désir d’approfondissement « intérieur » qui se doit de passer par des « croix » multipliées.[12] Or le vêtement est un des moyens possibles (à la fois anodin et proprement évident) de ce dressage des âmes et des corps voulu par des élites hantées par la mortification et, malgré tout, régies durablement par la hiérarchie des paraîtres. Affectant le corps et l’esprit, « l’Habit » use d’un langage sensible immédiatement lisible par tou-te-s : ses porteuses, leurs guides spirituels (volontiers narrateurs de leurs exploits), leurs observateurs et observatrices d’hier comme d’aujourd’hui.
Étendard et rempart, l’habit de religion aide à se séparer des trivialités du monde comme à « prendre le pli » et il révèle la profondeur d’un changement intérieur : « La pudicité pour estre entière & parfaite, disoit Tertullien, doit passer du dedans de l’ame iusques à l’exterieur de l’habit » et vice-versa.[13] Comme tel, celui-ci a pu être vénéré ; parfois aussi devenir insupportable et être l’objet de lacérations ignorées.[14] Dans tous les cas néanmoins, fonctionner comme un vigoureux et douloureux exosquelette.
II. En mission. Le dé-corps de la moniale ou les matérialités de l’exemplarité
La lecture des Règles, Constitutions et Coutumiers (les trois types de textes qui organisent et légitiment la vie des communautés religieuses) n’est pas le seul moyen de reconstituer la complexité des vestiaires monastiques, leurs finalités et leur contrôle.[15] Leurs dessus et leurs dessous, lorsqu’ils sont féminins (leurs nomenclatures n’ont pas d’équivalents masculins), se lisent aussi dans les dessins laissés par de trop rares religieuses.
Ces femmes, bien mieux que les peintres de portraits individuels de fameuses moniales (qu’elles soient saintes ou grandes dames), ne privilégient pas les particularités morales ou physiques de leurs consoeurs, mais leur commun costume. Un peu à la manière des graveurs de séries costumières religieuses, ce sont les contraintes d’enveloppements pesants, tout à la fois anoblissants et avilissants (c’est là leur paradoxe), que les artistes cloîtrées semblent vouloir mettre en avant, prêtant ainsi à leurs vêtements une exemplarité telle qu’elle tait les caractéristiques physiques de chacune.[16]
Le langage, silencieux et spectaculaire, de l’habit de religion se révèle clairement dans une aquarelle inédite et non datée, oeuvre et représentation d’une augustine anonyme ensevelie sous son habit de choeur. Sa haute silhouette de moniale sans visage se dresse « costumée » de pied en cap : ses habits sont coutumiers (inscrits comme tels dans les règles et coutumes de son ordre) et rappellent le sens ancien du mot « costume » (un moyen de faire être une « couleur locale » véridique). Quant aux traits de leur porteuse, ils sont comme effacés alors qu’est montrée l’exacte superposition de ses voiles, manteau, guimpe, rochet et robes.
[12] Croix « signifie figurément, Peine, affliction, douleur » (A. Furetière, op. cit., non pag. : article « Croix »). Voir Antoinette Gimaret, Extraordinaire et ordinaire des Croix. Les représentations du corps souffrant, 1580-1650, Paris, Honoré Champion, 2011 ; Odile Arnold, Le Corps et l’Âme. La vie des religieuses au XIXe siècle, Paris, Seuil, 1984, p. 91-96. Sur la quête des « croix » et l’avilissement du corps (le mater comme un esclave rebelle et en faire un mort), voir, parmi d’innombrables mystiques du passé, Marie de l’Incarnation, La Relation autobiographique de 1654, Sablé, Abbaye de Solesmes, 1976, passim et p. 41.
[13] Le père Claude Decret, La Vraye Veuve, ou l’idée de perfection en l’estat de viduité : Aves les éloges de quarante veuves éminentes en sainteté, Paris, Gaspard Maturas, 1650, p. 95-97. Tertullien, théologien de combat carthaginois (vers 160-220), est l’auteur de plusieurs traités sur le vêtement et l’impudeur.
[14] Le matin, les religieuses de certains ordres se devaient de « baiser amoureusement » leur habit avant de l’endosser, celui-ci étant fait des « étoffes les plus grossières et les plus rebutantes à la nature et à l’esprit du monde » (Louis-Marie Grignion de Montfort, « Règle primitive de la Sagesse » [1715] dans OEuvres complètes, Paris, Seuil, 1966, p. 748). Sur ces thèmes, N. Pellegrin, Voiles, ouv. cit., p. 350-353 et le Dictionnaire historique-portatif des ordres religieux et militaires […] avec les marques qui les distinguent les uns des autres, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1769, p. 24 (les augustines — italiennes — dites « filles du sac »).
[15] En cas de « relâchement », les communautés peuvent chercher à se « réformer » et à énoncer de nouvelles préconisations morales et vestimentaires qui prônent le retour à un habit « primitif » ou cherchent à en renforcer ses traits les plus incommodes : au Carmel en 1748, la pesanteur des lainages des robes et manteaux est accrue (Trésor du Carmel ou Souvenirs de l’ancien Carmel de France. Recueil des avis, règlements et exhortations de plusieurs visiteurs apostoliques, supérieurs particuliers, et de quelques unes des premières mères. Seconde édition, Tours, Carmel de Tours, 1879, t. I, pp. 281-282).
[16] Hypothèses qu’un travail en cours devra vérifier sur l’enlaidissement de certaines représentations de religieuses. Voir par exemple les gouaches de Geneviève Gallois (Noël Alexandre, Mère Geneviève Gallois, bénédictine, peintre, graveur, Bruxelles, Marot, 1999).
À de rares et précieux témoignages visuels souvent difficiles à interpréter,[17] il est parfois possible d’ajouter les propos de personnes qui ont vécu, de l’intérieur, la transition vestimentaire encouragée par le concile tenu au Vatican entre 1962 et 1965. Des femmes qui ont su décrire, dans la joie ou la tristesse, l’abandon obligé de tout ou partie de leurs anciens atours.[18]
C’est le cas, par exemple, de ce « quatorze pièces », attaché avec « vingt-six épingles » et surmonté d’une « pièce-montée » (la cornette), le tout pesant « vingt-cinq livres », qui a longtemps habillé les Filles de la Sagesse et que l’une d’elles décrit en 1978 avec un humour ravageur. Il faudrait tout citer des souvenirs de « fringues » de cette Québécoise née en 1907 et vingt-sept ans infirmière, puis bibliothécaire dans son ordre. Ils sont exemplaires. Mais je me contenterai d’en donner un extrait, celui qui concerne le « corps » (ou corset) qui servait de pivot à son harnachement, harnachement qui, je le répète, n’avait rien d’exceptionnel avant les années 1970 et donnait à toutes une « raideur hiératique ».
Figurez-vous une pièce conçue en guise de soutien-gorge à armature de fanons de fer et de fanons de baleine juxtaposés à la douzaine les uns à côté des autres… Une de ces charpentes solides, d’une rigidité inflexible, un vrai mur de soutènement pour notre remblai… pectoral ! […] capitonnées à l’intérieur par… devinez ? (je vous le donne en mille !) de la bourre de laine grossière, non cardée, jaunâtre et suintante à souhait… ensuite, par du papier journal […] deux patentes en tissu de coton archi-épais, archi-raide, superposées trois ou quatre fois […]. Lorsque notre « étau-corset » nous happait depuis les épaules jusqu’à la taille, commençait la difficile manoeuvre du laçage dorsal des interminables galons dans un chassé-croisé d’oeillets, lesquels nous ficelaient solidement depuis quatre heures du matin jusqu’à neuf heures du soir notre vie durant…[19]
Le cas du costume, au départ innovant et méprisé, des Filles de la Sagesse (un ordre non contemplatif créé au début du XVIIIe siècle) est d’autant plus intéressant que ces dernières, engoncées dans des habits créés sur le modèle des tenues paysannes françaises, ont su mener malgré tout une vie très active — et sans clôture — d’enseignantes et soignantes.[20]
[17] Poser de son vivant pour livrer son visage au public, fut longtemps condamné dans les couvents (N. Pellegrin, « Le visage interdit des religieuses » in Magali Briat-Philippe et Pierre-Gilles Girault (dir.), Voilé.e.s, dévoilé.e.s, Paris, In Fine et Bourg-en- Bresse, Monastère royal de Brou, 2019, p. 25-33, ill.).
[18] Tout aussi règlementaires, leurs nouveaux habits ont été allégés, écourtés et laïcisés, sauf dans les communautés « traditionnelles » (Roselyne Roth-Haillotte, « L’habit dans la vie consacrée féminine », in Jean-Pierre Lethuillier (dir.), Les Costumes régionaux, Rennes, P. U. R., 2009, p. 533-542).
[19] Yvette Aquin et Jean Simard, « Fringues et frusques. Texte d’Yvette Aquin, Fille de la sagesse », Rabaska. Revue d’ethnologie de l’Amérique française, 3/2005, p. 88-91. D’autres témoignages : Diane Bélanger et Lucie Rozon, Les religieuses au Québec, Montréal, Libre expression, 1982, p. 188- 192 ; Ch. de Chergé, Histoire des congrégations religieuses d’origine poitevine, Poitiers, A. Dupré, 1856, p. 101-124.
[20] Un costume contemporain, délibérément modeste et prolétarien, ridiculisé par les notables de la ville de Poitiers lors de sa création (Chanoine Allaire, Abrégé de la vie et des vertus de la soeur Marie-Louise de Jésus Supérieure des Filles de la Sagesse, Poitiers, Jean-Félix Faulcon, 1768, p. 41-42).
Figure 4
Une augustine de l’Hôtel-Dieu de Caen. Aquarelle non datée et non signée, fin XIXe siècle (Paris, BnF)
figure 5
Costumes des religieuses de la Sagesse dans la maison et hors de celle-ci. (Ch. de Chergé, Histoire des congrégations d’origine poitevine, 1856 ; coll. privée)
Superposition et poids des pièces vestimentaires, épaisseur et rugosité des textiles qui les bâtissent, linges rigidifiés par de l’empois, articles chaussants inadaptés, accessoires variés (poches de dessous mobiles et surchargées, lourde croix, chapelet), tablier à bavette épinglée, furent partout proprement « de règle » et complétaient des usages, à nos yeux révoltants mais inscrits dans une logique de mortification glorieuse : parcimonie du linge et des lavages, rareté des changes (saisonniers ou nocturnes), prolifération de puces, poux et autres vermines, bigarrure de rapiéçages (visibles, ils sont déshonorants et pour cela recherchés par les plus « humiliées »), inadaptation des tissus à l’absence de chauffage et de toute régulation thermique, réduction de la vision jusque dans les activités quotidiennes.[21]
Je rappelle ici que toute circulation, y compris en clôture, se faisait les yeux modestement baissés et qu’il fallait rabattre son voile en cas de rencontre avec des non-moniales. Quant au tunnel formé par les pans semi-rigides des coiffes « cornettes » que portaient les soeurs dans certains ordres apostoliques comme celui des Filles de la Charité ou de la Sagesse, il leur servait de chastes oeillères.[22] Et c’est cette même crainte qui explique aussi l’habitude, dans les interstices d’un emploi du temps surchargé d’offices, de moments d’adoration et de tâches domestiques variées, de garder ses mains enfouies dans les manches profondes de la robe.
Cependant n’oublions pas que ces armatures textiles et mentales fonctionnaient comme autant d’outils défensifs aptes à « l’édification » et à la protection d’êtres jugés, « par nature », faibles et peccamineux — les femmes. C’est d’ailleurs avec leur consentement que les couvents pouvaient leur inculquer les trois voeux d’obéissance, chasteté et pauvreté, et les former au retrait du monde et au repli mental dans l’attente d’un bien-mourir qu’épitomise la cape-suaire de la Sagesse.[23] Quant aux autres « mortifications extérieures », telles que le port d’une haire, d’un cilice, d’une « ceinture piquante » et/ou de diverses ligatures métalliques aux pointes acérées dont les effets physiques sont permanents (sanguinolences, suppurations, douleurs), leur secret usage est attribué aux plus grandes saintes par leurs biographes, souvent des « directeurs » fascinés mais inquiets de leur abus et libres d’en priver leurs « dirigées », en guise de… punition.[24] Car si ces diverses « parures » pénitentielles sont choisies par les plus sacrificielles (c’est-à-dire les plus « spirituelles ») des religieuses, ils sont parfois aussi imposés à celles qui sont coupables d’infractions.
[21] Des poches de tablier cousues sont commodes et donnent plus d’autonomie que celles, amovibles et de dessous, décrites par Barbara Burman et Ariane Fennetaux, The Pocket: A Hidden History of Women’s Lives, 1600-1900, New Haven (Conn.), Yale University Press, 2019.
[22] La crainte d’un contact personnel avec des laïcs explique la nécessité, au parloir comme au dehors, d’être toujours flanquée d’une compagne non choisie (N. Pellegrin, « Des amitiés "particulières" ? Nonnes et pensionnaires, entre normes et souvenirs (XVIIIe-XIXe siècles) » in Maurice Daumas (dir.), L’Amitié, Pau, Presses de l’Université de Pau, 2014, pp. 143-162).
[23] Aussi dite « cellule portative », cette cape-suaire garantit leur chasteté dans l’espace public et elle est « de règle », ce que ne sont pas, à la Sagesse, discipline ou cilice dont l’usage n’est pas obligé. Est extrême cependant le refus des « commodités, soit dans les habits, soit dans la chambre » et l’obligatoire « modestie dans leur visage & la vue […], dans la posture du corps […], dans le parler […], dans le marcher […], dans l’église » et l’injonction de « choisir le pire en tout, et notamment « les habits les plus vieux & les plus grossiers » (Jean-Marie Grignion de Montfort, ouv. cit., p. 740, 745, 748, 751, 763-764, 772-775).
Haire et cilice sont des moyens de mortification discrets portés à même la peau sous l’habit ; sorte de chemise dans le premier cas et large ceinture dans le second, tous deux sont coupés dans un matériau rugueux et irritant fait de poils ou de crin. Sur la logique des mortifications — un leitmotiv de tous les travaux sur la piété catholique –, voir tout d’abord Jacques Gélis, « Le corps, l’Église et le sacré », in Georges Vigarello (dir.), Histoire du corps.-1: De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 2005, p. 17-108.
[24] J.-M. Grignion de Montfort, ouv.cit., p. 763. Grande « mortifiée » volontaire, avant même son entrée aux Ursulines de Tours et son départ pour Québec, Marie Guyart dite de l’Incarnation est à l’occasion privée de cilice pour ne pas avoir demandé la permission de le porter (Marie de l’Incarnation, ouv. cit., p. 39, 41, 67, 71, 104).
III. Le Jardin Des Supplices. La quête du châtiment consenti ou le paradigme vestimentaire
En système catholique, la douleur n’est jamais assez rude puisqu’elle est incapable d’émuler les souffrances d’un Dieu crucifié, sauveur de l’humanité.
À l’instar de la littérature pieuse, l’iconographie sait le faire découvrir, comme sur le frontispice d’une Courte description des ordres des femmes et filles religieuses gravé par Adrien Schoonenbeek et publié aux Pays-Bas en 1700.[25]
Dix femmes occupent deux mondes superposés que sépare une tenture sombre. En bas, la moitié d’entre elles (des « Vierges folles » dit le commentaire en vers) se livrent à des plaisirs profanes, tandis que la partie supérieure montre la montée au Ciel de cinq religieuses voilées de noir qu’accueillent un archange et le Christ en gloire. « Sur le dessein du Titre » étalé sur une page et demie, on lit à leur propos:
Ah ! pour y parvenir voyez combien de peine,
Elles endurent constamment ;
Voyez leur pauvreté, ces cordes & ces chaînes,
Qui servent à mordre leur chair cruellement ;
Leur coeur ne cherche pas du Monde les délices,
Il aime les vertus, il abhorre les vices,
Il entend de Jésus la voix,
Dans le chemin de l’Evangile
Ce coeur regeneré, soumis, toujours tranquille
Porte joyeusement la Croix […]
Comment ne pas remarquer les corps, cassés en deux et lourdement habillés, de celles qui ont rompu avec les vanités et les plaisirs ? Tissus précieux, chemises fines, fontanges, parfums, miroirs, coussins, literies voluptueuses, gourmandises, tous ces objets interdits en clôture sont complaisamment représentés au premier plan de l’image. Mais s’il est facile de comprendre la nécessité, pour de futures moniales, d’un apprentissage de l’abandon des plaisirs terrestres, il est plus malaisé d’appréhender la recherche d’ascèses cruelles (et jouissives ?) s’ajoutant à tant d’autres austérités.
S’exercer aux rudesses de la vie monastique, c’est en premier lieu habituer son corps, c’est-à-dire apprendre à l’habiter et à l’habiller autrement. Aussi est-il conseillé aux mères de filles désireuses de « quitter le monde pour se consacrer à Dieu » de leur « faire pratiquer dans [leur] ménage une partie de la Règle, pour voir si leur santé sera assez forte, & si elles persisteront dans leur dessein ». D’après l’ironique et prudent abbé Musson (un homme des Lumières qui écrit en 1751), l’entrée au couvent devrait toujours être précédée de trois mois d’épreuves : elles concernent le silence, le sommeil, l’alimentation, mais elles débutent par de rudes apprentissages vestimentaires qui blessent leur corps et leur amour-propre:
Vous ôterez à vos Filles tous les petits ornemens qui leur conviennent, & vous les habillerez d’une manière fort simple. Au lieu de chemises vous leur ferez porter une étoffe de grosse bure, comme les Religieuses Capucines en portent, & elles ne coucheront que sur une paillasse piquée : vous aurez soin qu’elles se lèvent tous les jours à minuit : elles seront nuds pieds pendant tout l’hiver, il n’y aura point de feu dans leur chambre : elles ne se chaufferont que deux heures par jour dans les grands froids », etc., etc.[26]
Ce n’est qu’après cet endurcissement très physique que deviendront possibles le détachement du monde et la désappropriation perpétuelle (ne jamais rien posséder en propre).
Figure 6
La montée au Ciel des bonnes épouses du Christ, gravure frontispice d’A. Schoonenbeek, 1700 ; coll. privée)
C’est ce que montrent toutes les biographies de saintes, y compris celles — pionnières et peu connues — de la patronne de Poitiers, la reine et moniale Radegonde (520 ?-587), une femme « tortionnaire d’elle-même » aux dires de ses contemporain-e-s.[27]
[25] Adrian Schoonenbeek, Courte description des ordres des Femmes & Filles religieuses, Contenant Une petite Relation de leur Origine, de leur Progrès, & de leur Confirmation. Avec les Figures de leurs habits, Amsterdam, H. Desbordes, P. Scepérus et P. Brunel, 1700 (90 planches hors-texte).
[26] [Musson, abbé], Ordres monastiques, Histoire extraite de tous les Auteurs qui ont conservé à la postérité ce qu’il y a de plus curieux dans chaque Ordre, Berlin (sic), s. n., 1751, t. I, p. 138-139. Ce témoignage, certes corroboré par le récit de futures grandes spirituelles comme la soeur de Blaise Pascal, Jacqueline, n’en reste pas moins en partie sujet à caution du fait de l’anticléricalisme de son auteur.
[27] Plusieurs de ces « vies » figurent dans Robert Favreau, Radegonde. De la couronne au cloître, Poitiers, Association Gilbert de la Porée, 2005. Le chroniqueur Grégoire de Tours déclare succinctement dans son Histoire des Francs: « Radegonde, toute tournée vers Dieu, changea de vêtement et construisit pour elle un monastère à l’intérieur de la ville de Poitiers » (ibidem, p. 17).
L’évêque et poète Fortunat et la moniale Baudonivie ont longuement côtoyé Radegonde de son vivant avant de l’honorer de deux « vies » qui inaugurent en le féminisant un genre littéraire que structurent descriptions prosaïques, rêves de martyre et récits de miracles.[28] Ainsi narrent-ils, l’un et l’autre, sa détestation précoce des vêtements royaux et son recours permanent à un cilice : posé par terre il lui servait de couche la nuit quand elle n’était qu’une reine franque convertie au christianisme ; puis elle l’aurait utilisé, une fois entrée au monastère, comme linge de corps permanent. Devenu la pièce maîtresse de sa garde-robe de véritable chrétienne, il acquit de telles vertus qu’il guérit de sa cécité l’évêque Léonce de Bordeaux. Tout en jeûnant de façon drastique et en menant des tâches pénibles d’exorciste-guérisseuse à succès et de très humble servante de sa communauté (nettoyage des latrines et des chaussures de ses compagnes), celle qui n’a jamais voulu devenir abbesse du monastère qu’elle a fondé, se serait aussi fabriqué des appareillages, cruels et secrets, pour mieux tenter d'imiter le Christ des douleurs.
Une fois pendant le Carême, elle attacha à son cou trois cercles de fer […] puis y passant trois chaînes, elle les serra si étroitement autour de son corps que ses chairs tendres se boursouflant s’incrustèrent dans le dur métal […]. Pour revêtir ses bras, elle n’eut pour toutes manches que celles qu’elle se confectionna avec des jambières […].[29]
Onze siècles plus tard, l’héroïsme de Radegonde continue à faire des émules parmi les moniales de son ordre à Poitiers. Ainsi, l’abbesse Charlotte-Radegonde de Montaut- Navailles (1652-1696) est félicitée pour sa « régularité », c’est-à-dire son respect de la règle:
Elle prenoit la discipline si souvent & si rudement, que ses voisines [de cellule] fremissoient de l’entendre. Non contente de porter la serge pendant le jour, & de coucher durant la nuit dans des draps de laine, elle s’estoit fait faire un corset de fer blanc, tout hérissé de pointes. Il est vray que son Confesseur fut obligé, après quelques années, de luy interdire l’usage de ce meurtrier instrument ; mais il ne pût refuser à ses instantes prières celuy des brasselets & des cercles de fer, desquels elle se servit toujours.[30]
À noter que la tenue des religieuses bénédictines de Sainte-Croix était alors coupée de façon à faciliter la pratique de la discipline sans enfreindre la bienséance:
Les manches de votre chappe noire seront longues jusques aux genoux & auront deux pieds de largeur environ, afin que vous puissiez plus facilement vous humilier et abaisser à recevoir la saincte correction de la discipline, ayant defaict vos deux manches du dedans, & troussé vostre frocq sur la teste, & lasché votre robe de dessous jusqu’à la ceinture.[31]
[28] Sur les topoï des biographies spirituelles, voir Jacques Le Brun, Soeur et amante : les biographies spirituelles féminines du xviie siècle, Genève, Droz, 2013.
[29] R. Favreau, ouv. cit., p. 39-43, 47, 49, 62-63, 73, 84. Le linceul de Radegonde, mordu à pleines dents par un autre évêque, Leifaste d’Autun, le débarrassa de sa rage de dents. À noter qu’en 589, une partie des moniales se révoltèrent contre leur abbesse pour conserver, entre autres, leur habit originel. Il en fut de même à différents moments de la longue histoire des réformes de Sainte-Croix et d’autres ordres (P. de Monsabert éd., « Journal des abbesses de Sainte-Croix », Revue Mabillon, 1909-1910, p. 153 sq. et 476-477).
[30] Simon de La Vierge, le père, Oraison funèbre de tres-illustre, tres-excellente et tres-vertueuse Madame Charlotte, Françoise, Radegonde de Montaut de Navailles abbesse du royal Monastere de Sainte Croix de Poitiers, Poitiers, Jean-Baptiste Braud, 1696, p. 6. Le mot « Discipline » a le sens actuel et ceux, conjoints, d’instrument punitif et de châtiment corporel, que ce dernier soit auto-infligé ou non, ce « que souffrent les Religieux qui ont failli, ou ceux qui se veulent mortifier. On luy a donné la discipline en plein chapitre. Les dévots prennent eux aussi la discipline » (A. Furetière, ouv. cit., non pag. : article « Discipline »). Ce fouet est présent dans nombre de boîtes de nonnes (Cellules de nonnes, Paray-le-Monial, Trésors de ferveur, 2018).
[31] Reigles des filles religieuses de l’Ordre de S. Benoist. Pour le Venerable Monastere de Saincte Croix de Poictiers, Poictiers, Julien Thoreau, 1612, p. 297 (« Chap. 50 : Des vêtements »). Un ajustement commun à l’ordre de Sainte-Croix et à celui de Fontevraud, mais ici le XVIIIe siècle aurait adouci la rigueur de la pratique du fouet (Musson, ouv. cit., t. III, p. 136-138).
Ces détails dans l’ajustement des moniales ne sont pas courants et leur raison d’être — la flagellation (sur le dos ou sur les épaules) — n’a peut-être pas toujours été adoptée par le commun des religieuses ni même été tolérée par des autorités ecclésiastiques conscientes du caractère ostentatoire ou hypocrite de certaines pénitences excessives. Elles sont aussi de plus en plus contrôlées pour des raisons de morale et de décence. Elles n’en sont pas moins paradigmatiques des châtiments pénitentiels propres à une religion où la souffrance se vit aussi bien au niveau symbolique qu’au niveau réel, aussi bien par des détails que par la volonté de transformer toute sa vie en chemin de croix.[32] Un chemin d’humilité comme de gloire.
Ainsi le port d’un voile blanc (celui des novices mais aussi des converses, les soeurs domestiques d’extraction généralement modeste) peut sembler un fait insignifiant, tout comme l’usage de vêtements dégradés ou dégradants, mais ce sont là des moyens de mortification délibérée.[33] De ces signes d’appartenance au groupe des subalternes, se sont emparé plusieurs visitandines de haut parage ou avancées dans leur carrière religieuse.[34] Mais d’autres ont fait leurs des marquages plus sévères encore, comme cette « Madame de Longueval », en religion soeur Françoise du Saint-Esprit, contrainte par sa famille à devenir cistercienne et qui mena d’abord une vie déréglée, de nonne élégante portant frisures, bijoux, guimpe transparente et scapulaire de soie. Après sa « conversion » (une mutation intérieure profonde), elle choisit de se faire… converse, et adopta la serge rugueuse pour sa literie et ses vêtements de dessous. Refusant le voile noir des soeurs de choeur, elle couvrit sa tête de toile grossière (torchons de cuisine « pendus sur le front » et « bandeau de crin » serré si fort « qu’elle en avoit le visage tout plein d’enlevûres ») et c’est ainsi vêtue qu’elle participa à la réforme de son abbaye bourguignonne de Tart dans les années 1620-1630.[35]
[32] Antoine Roullet (« Autoflagellation », dans Isabelle Poutrin et Élisabeth Lusset (dir.), Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir, Paris, PUF, 2022, p. 69-73) insiste sur les multiples raisons des pratiques d’endurance et de purification, aptes à désangoisser d’éternelles pécheresses que virilise leur imitation effective des souffrances christiques.
[33] A contrario, c’est un moyen d’humilier des religieuses empêchées de profession et donc de prendre le voile noir : entrée en 1917 au monastère Saint-Louis du Temple de Paris, Geneviève Gallois n’est autorisée à prononcer ses voeux qu’en 1939, malgré ou à cause de ses succès artistiques de peintre, de vitrailliste, d’illustratrice et de chroniqueuse ironique de son couvent (N. Alexandre, ouv. cit.).
[34] N. Pellegrin, « "Au risque de se perdre ". Normes chromatiques et nuances de blanc dans le vêtement monastique féminin », Modes pratiques. Revue d’histoire du vêtement et de la mode, 2015, n°1, p. 6-25, ill.
[35] Le père Helyot, Histoire des Ordres monastiques, religieux et militaires, et des congrégations séculières de l’un & l’autre sexe, qui ont este establis jusqu’à présent […], Paris, J.-B. Coignard, 1714-1719, t. V, p. 471 sq. ; [E.-B. Bourée, 1699], La Vie de Madame Courcelle de Pourlan, dernière abbesse titulaire et réformatrice de l’Abaïe de Notre-Dame de Tart, première maison de Cisteaux au diocèse de Langres à présent transférée à Dijon, dite en religion la mère Jeanne de Saint-Joseph décédée le 16 mai, Lyon, Certe, 1699, pp. 250, 257.
D’autres tactiques individuelles de mortification semblent encore plus anodines mais s’avèrent particulièrement glorieuses en un temps où le rêche et « le mauvais blanc » sont l’apanage des vêtures prolétaires. En portant des vêtements qui n’avaient pas été préalablement assouplis et blanchis comme l’étaient notamment les chemises des castes privilégiées, une carmélite se réjouit de cette occasion d’endurer le mal sans en rien dire :
« celle des Soeurs [la robière] qui avoit soin des habits, ayant mis un jour par distraction dans sa cellule, une tunique de serge neuve, & qui n’avoit point été blanchie, […] grasse & malpropre […], il lui vint une dartre vive si étendue & si douloureuse qu’elle lui causa une insomnie qui dura deux mois […] ; étant tombée malade d’une fièvre continue, elle se vit enfin obligée d’avouer ce qui lui étoit arrivé ».[36]
Le « saint habit », en théorie toujours pauvre, incommode et inélégant (on l’a vu), doit toujours rester conforme et il est, pour cela, objet de surveillances multiples. Choisi comme un moyen privilégié d’anéantissement et de contrôle de soi, il peut aussi, dûment accessoirisé, être manipulé à des fins punitives par la communauté ou ses supérieures : bâillonner, humilier, exclure.
Ainsi à la Visitation, dont la règle, à première vue bénigne, n’est pas facile à suivre, la punition des jeunes religieuses trop mondaines passe par le port de pièces vestimentaires dégradantes, port auquel prendrait plaisir une maîtresse des novices, autorisée à employer des techniques d’aveuglement et de bâillonnement :
elle vous fera prendre un voile tout usé, une guimpe déchirée & de grosse toile, & une robbe pleine de pièces & de lambeaux ; & il n’y aura pas à répliquer. Vous aurez beau representer que cette robbe est trop longue, ou trop courte, ou trop large, ou trop étroite, qu’elle ne vous couvre pas les épaules. Votre Maîtresse ne daignera pas à vous écouter. […] filles dissipées ou immodestes […]. C’est pour cela que le noviciat est toujours fourni de grandes lunettes. Il y a un magazin de baillons, de voiles de grosse toile, de pierres & de billots de toutes sortes de grosseur.[37]
Le recensement des marques d’infamie utilisées dans les couvents reste à faire, ainsi que leur confrontation avec les pratiques analogues en vigueur dans le monde profane, qu’il soit judiciaire (la chemise rouge des coupables de parricide), réglementaire (la rouelle ou le bonnet jaune des juifs, les insignes pour prostituées) ou scolaire.[38] Ainsi une langue de drap blanc était cousue sur le scapulaire des carmélites convaincues de faux-témoignage, aux dires de la Règle. Mais leur fut-elle réellement infligée?[39]
S’il est facile de connaître règlements et normes, si l’on peut déceler les partis pris (négatifs ou positifs) des narrateurs de faits exemplaires, il faut avouer notre ignorance des conduites ordinaires et de leur nécessaire adaptation aux trivialités du réel comme aux folles ambitions des plus saintes.
[36] Abbé de Montis, La vie de la vénérable soeur de Foix de La Valette d’Epernon, religieuse carmélite, dite en Religion Soeur Anne-Marie de Jésus […], Paris, Charles-Pierre Berton, 1774, p. 226-227. La pesanteur et l’incommodité du « saint habit », notamment l’été, sont rappelées à plusieurs reprises par ce biographe (p. 219, 227).
[37] Musson, ouv. cit., t. I, p. 13, 104, 143 sq. et t. IV, p. 200-202, 214-215. Quant aux « lunettes » et autres bandeaux oculaires qui punissent ici et là les récalcitrant-e-s en les aveuglant, leur dénonciation (fondée sur des pratiques peut-être marginales) semble une des obsessions récurrentes de cet abbé… « éclairé » particulièrement réfractaire à la spiritualité des visitandines.
[38] Longtemps avant les bonnets d’âne de l’école républicaine française, « c’était un habit complet de la bure la plus grossière, bonnet, pantalon, et jusqu’à des souliers lourds et informes » qui punissaient les élèves récalcitrants de l’École Militaire à Paris, vers 1770 : un déclassement cruel dans le monde fortement hiérarchisé des jeunes nobles d’épée (Vincent Vienot, comte de Vaublanc, Mémoires, Paris, Firmin-Didot, 1857, p. 17 et 37). Voir Eirik Peirat, « Bonnet d’âne », dans I. Poutrin et É. Lusset (dir.), ouv. cit., p. 113-114.
[39] Au Carmel comme ailleurs, la punition passe aussi par l’obligation de « manger à terre » (du pain et de l’eau) et, pour les fautes les plus graves, par l’incarcération (Règle et Constitutions des religieuses primitives déchaussées de l’ordre de la glorieuse Vierge Marie Notre-Dame du Mont Carmel, Malines, H. Dessain, 1878, p. 79).
Conclure : Souffrir Pour Être (intérieurement) Belle 40
Entre les paradigmes — bien connus — de la sainteté et les pratiques — plus insaisissables — du quotidien monastique, entre la contrainte (sadique ?) sur des soeurs-filles soumises et leur quête (masochiste ?) de l’Absolu, entre correction et auto-macération, la frontière est poreuse et fluctuante. Cependant il faut reconnaître que la torture de soi et des autres — un des pivots du christianisme — ne saurait qu’être bienfaisante et bénéfique aux yeux de Dieu et de ses porte-parole terrestres. Le Salut passe par des agents matériels tangibles comme l’habillement. « Puissante & forte sauvegarde […] contre la superfluité, la vanité, la curiosité, la singularité »,[41] les vêtements de religion sont des outils indispensables. Des prothèses tout autant, capables de faire tenir de l’extérieur un « intérieur » et de faciliter l’émancipation imprévue de la croyante dans un monde où elle peut, enfermée dans son cloître et ses voiles, devenir martyre héroïque, intellectuelle ou artiste puissante, voire missionnaire ou directrice spirituelle.[42]
Mais, sur ce point, ne suis-je pas en train de faire des vêtements dits de religion des écrans de projection où se reflètent mes rêves et nos durables incompréhensions face à l’ambivalence du sacré ?
figure 7
Lavez Maria, 2022 ; pochoir anonyme sur une palissade de la ville de Nantes ; photographie de Pierre Mouchard
[40] Je paraphrase ici Antoine Roullet (« Souffrir pour être belle : l’enlaidissement au Carmel, entre image de soi et regard des autres », Europa Moderna. Revue d’histoire et d’iconologie, n°3/2012, p. 96-113).
[41] Pierre Fourier, ouv. cit., p. 304.
[42] Une analyse proposée par Arnaud Fossier (« Église, genres et sexualité : une approche critique », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 147/2020, p. 9-22) et Antoine Roullet (« Autoflagellation », ouv. cit., p. 72).
Biographie
Nicole Pellegrin (Ihmc/Cnrs-Ens Paris), historienne du genre et des pratiques vestimentaires, a notamment publié Écrits féministes, de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir. Une anthologie (Paris, Flammarion, « Champs », 2010) et Voiles. Une histoire, du Moyen Âge à Vatican II (Paris, CNRS éditions, 2017 ; réed. en poche 2022). Elle est co-fondatrice de la Société Internationale d’Études des Femmes d’Ancien Régime (siefar. org), de l’Association Française d’Etude des Textiles et de Musea (musée virtuel d’histoire des femmes et du genre : http//:musea. univ-angers.fr).
Article Citation
Pellegrin, Nicole. « Ornement, instrument, et châtiment: Remarques sur l'habit religieux féminin dans le catholicisme français des temps médiévaux au XXe siècle ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 1-19. https://doi.org/10.38055/FCT040101
Copyright © 2025 Fashion Studies - All Rights Reserved
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license (see: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)