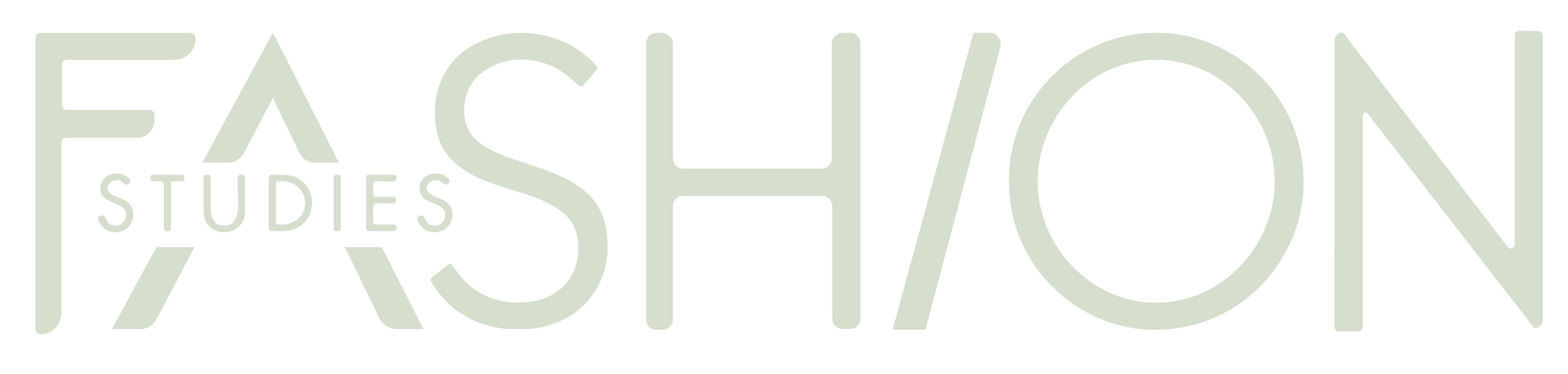Que portait-elle ? Le rôle du vêtement dans les représentations de violence sexuelle
Par Ersy Contogouris
DOI: 10.38055/FCT040107
MLA: Contogouris, Ersy. « Que portait-elle ? Le rôle du vêtement dans les présentations de violence sexuelle ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 1-21. https://doi.org/10.38055/FCT040107
APA: Contogouris, E. (2025). Que portait-elle ? Le rôle du vêtement dans les présentations de violence sexuelle. Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, 4(1), 1-21. https://doi.org/10.38055/FCT040107
Chicago: Contogouris, Ersy. « Que portait-elle ? Le rôle du vêtement dans les présentations de violence sexuelle ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies 4, no. 1 (2025): 1-21. https://doi.org/10.38055/FCT040107
Special Issue Volume 4, Issue 1, Article 7
mots-clefs
Art
Violence sexuelle
Viol
Vêtement
Consentement
Fragonard
Flou
Résumé
Cet article porte sur le rôle que jouent les vêtements dans les représentations de violence à caractère sexuel, comment les vêtements des victimes et des agresseurs sont porteurs de sens, comment ce sens a été interprété par les historien·nes (le plus souvent masculins) de l’art, et finalement, comment ces représentations sont nourries par, et nourrissent à leur tour, la culture du viol. Se penchant sur des oeuvres d’art du 16e au 18e siècle, j’étudie d’abord la façon dont les vêtements jouent un rôle clair dans la narration, notamment les vêtements déchirés portés par les femmes, par exemple, exprimant la violence de la scène, ou ceux portés par les hommes, dénotant leur pouvoir. Je montre aussi que le dévoilement des corps féminins – l’absence de vêtements –, lui aussi contribue au sens du tableau et à sa réception par les spectateur·rices ainsi que par les historien·nes de l’art. Dans une dernière partie, je me concentre sur Le Verrou, de Jean-Honoré Fragonard, pour examiner un cas où les vêtements portés par les protagonistes brouillent le sens de l’oeuvre. Il se crée alors un flou dans l’interprétation qui contribue à l’exploitation d’une marge de manoeuvre à l’intérieur de laquelle est nourri un imaginaire où la notion de consentement est elle aussi constamment floutée.
Cet article[1] porte sur le rôle que jouent les vêtements dans les représentations de violence à caractère sexuel, comment les vêtements des victimes et des agresseurs sont porteurs de sens, comment ce sens a été interprété par les historien·nes (le plus souvent masculins) de l’art, et, finalement, comment ces représentations sont nourries par, et nourrissent à leur tour, la culture du viol. Cet article s’inscrit de façon plus large dans une réflexion sur les façons dont les agressions sexuelles ont été représentées dans l’histoire de l’art, ainsi que sur les façons dont la discipline de l’histoire de l’art (telle que pratiquée dans le monde académique, muséal, ou autre) offre une sorte d’apologie de cette violence – plus que ça, même, elle la justifie, la reproduit, la circule. Je me pencherai d’abord sur des cas où le vêtement joue un rôle clair dans la narration, pour ensuite analyser une oeuvre où, au contraire, le vêtement floue notre compréhension de ce qui est représenté dans le tableau. Je m’intéresse à la portée discursive de ce flou et au rôle que jouent les vêtements dans ce flou. Pour mener cette analyse, je me concentrerai sur un corpus restreint d’oeuvres d’art européennes produites entre les 16e et 18e siècles.
Il ne fait aucun doute que les images et les discours sur lesquel·les j’écris sont souvent difficiles à regarder et à lire. Je me retrouve dans la situation paradoxale de vouloir parler de ces images et d’en discuter, parce que je suis convaincue que nous devons le faire afin d’essayer de comprendre comment elles fonctionnent et le rôle qu’elles jouent dans nos imaginaires. Toutefois, je reconnais qu’elles peuvent être déclenchantes et retraumatisantes, et je ne veux pas non plus leur donner encore plus d’oxygène et participer à ce qui me semble être une forme de commodification du trauma. Je suis donc partagée. J’ai décidé de ne pas reproduire la majorité des images dont je discute ici, elles sont facilement trouvables sur Internet. Si ce qui suit risque d’être déclenchant pour vous, écoutez-vous avec care.
Les vêtements jouent un rôle clair dans la narration
Une des scènes d’agression sexuelle les plus souvent représentées dans l’art classique est l’enlèvement des Sabines.[2] Peu de temps après la fondation de Rome, sa population étant majoritairement masculine, le dirigeant romain Romulus (lui-même issu d’un viol) envoie des représentants dans les régions voisines à la recherche de femmes, mais sans succès. Romulus élabore alors un plan : il invite ses voisin·es sabin·es à une fête durant laquelle, à son signal convenu secrètement à l’avance, les Romains s’emparent des Sabines. Les Sabins se battent pour empêcher ces enlèvements, mais sont vaincus. Quelques années plus tard, les Sabins déclarent la guerre à Rome pour ramener les Sabines capturées, mais ces dernières, désormais épouses et mères romaines, intercèdent, implorant la fin de la guerre qui oppose leurs maris à leurs pères et à leurs frères.[3] Les Sabins acceptent de s’unir aux Romains pour former une seule nation et la guerre prend fin. Ce mythe est typique de ce que Susan Brownmiller a appelé le « viol héroïque », soit un viol perpétré par un dieu ou un héros, glorifié et justifié, très souvent parce qu’il conduit à une fin « heureuse » – un mariage, par exemple, ou la naissance d’enfants. Ce type de viol permet à l’histoire d’avancer.[4] Dans le cas du viol des Sabines, non seulement ces femmes sont devenues épouses et mères, mais Rome a survécu et prospéré ; les Sabines ont même activement plaidé pour une réconciliation, démontrant ainsi leur satisfaction par rapport à leur nouvelle situation. Pietro da Cortona représente le moment où les Romains enlèvent les Sabines (c.1630).
Les cheveux des femmes sont épars, leurs vêtements sont déchirés, leurs poitrines et leurs cuisses sont visibles, le dos de l’une des Sabines est complètement découvert. En plus d’émoustiller les spectateurs – érotisant ainsi le viol – ces indices pointent vers la raison ultime de cet enlèvement de masse, soit que les femmes sont enlevées contre leur gré pour servir à des fins de reproduction. Le terme « enlèvement » est un euphémisme : il s’agit plutôt d’un viol collectif.[5]
Un·e artiste du 17e siècle ne pouvant pas montrer un viol (dans le sens le plus restreint du mot) en cours, dû à des considérations de bienséance au regard des normes culturelles de l’époque, plusieurs solutions s’offraient aux artistes pour passer outre cet interdit. Selon les règles de la peinture d’histoire classique, en vigueur au 17e siècle, le moment optimal à représenter est le plus prégnant, c’est-à-dire celui à partir duquel les regardeur·euses peuvent lire les événements qui précèdent ou suivent, de sorte que, même peu familiarisé·es avec l’événement dépeint, iels peuvent deviner les implications de ce moment souvent chargé d’émotion. Le·a spectateur·rice est invité·e à poursuivre la scène dans son esprit.
[1] Je tiens à remercier les rédactrices invitées de ce numéro de Fashion Studies, Anne Létourneau, Laura Kassar et Liza Petiteau. Cet article provient d’une conférence donnée dans le contexte du colloque Vêtir / Fashioning qu’elles ont organisé en 2023. Mes remerciements aussi aux autres participant·es de ce colloque. Je remercie sincèrement les deux lecteur·rices anonymes pour leurs lectures attentives et leurs conseils.
[2] L’événement est raconté par Tite-Live, Ovide, Denys d’Halicarnasse et Plutarque, entre autres.
[3] C’est le moment représenté par Jacques-Louis David dans L’Intervention des Sabines (1799), où l’on voit Hersilie, fille du roi sabin Titus Tatius et épouse de Romulus (ou de Hostus Hostilius dans certaines versions) s’interposer entre son frère et son mari.
[4] Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women, and Rape, New York, Simon and Schuster, 1975, ch.9.
[5] Voir Mary Beard, « The Erotics of Rape: Livy, Ovid and the Sabine Women », dans Female Networks and the Public Sphere in Roman Society, dir. Päivi Setälä et Liisa Savunen, Rome, Institutum Romanum Finlandiae, 1999, pp. 1–10 ; p. 9.
L’artiste peut rajouter divers éléments dans une scène pour contribuer à la lecture de ce moment sans contrevenir au décorum, détails qui pointent souvent vers le viol. C’est ici que les vêtements entrent en jeu.
Les vêtements des Sabines sont déchirés car elles se sont battues, se sont défendues. Elles ont néanmoins été maîtrisées par les Romains, qui se révèlent ainsi plus puissants, plus virils (donc, d’une certaine manière, plus méritants de ces femmes) que les Sabins. La puissance virile des hommes est également exprimée par leur musculature, leurs vêtements et leurs cuirasses étincelantes, entre autres. Les vêtements déchirés des femmes, leurs poitrines et leurs cuisses dénudées, sont également le signe des viols qui vont suivre.
Cette esthétisation de la violence s’accompagne d’une érotisation de la violence sexuelle. Comme le soutient le chercheur en études classiques Leo Curran à propos des Métamorphoses d’Ovide, où plus de cinquante cas de viol sont relatés, « [s]exual desirability is enhanced by disarray of clothing and hair, by discomfort and embarrassment, or by fear. For the rapist these are all aphrodisiacs ».[6] Le spectateur masculin est ainsi encouragé à s’identifier au violeur. Les scènes de violence sexuelle sont donc une occasion pour l’artiste de montrer le corps féminin d’une façon qui est considérée comme érotisée, de représenter la nudité (totale ou partielle) féminine sans contrevenir aux normes, et ce, dans des tableaux d’histoire empreints d’émotion et de tension dramatique. Pour l’historien de l’art Jérôme Delaplanche, ce ne sont pas seulement les violeurs qui sont émoustillés par le spectacle des femmes en désarroi, mais « la plupart des hommes ». Dans un passage sur L’enlèvement de Proserpine par Pluton de GianLorenzo Bernini (1661–1662), Delaplanche écrit : « Pour la plupart des hommes, le désir sexuel est accru par la vue de l’embarras ou de la peur d’une femme, par le désarroi de ses vêtements et de ses cheveux. » Delaplanche invite ici les spectateurs à s’aligner avec lui et l’agresseur dans un exemple clair d’empathie masculine.[7] Il cite l’artiste et écrivain sur l’art Gian Paolo Lomazzo (1538–1592) dans un texte qui insiste sur l’effet agréable que produisent sur les spectateurs (masculins) les signes de résistance des femmes dans ces scènes :
Elles doivent se défendre, mélancoliques et souffrantes, frapper avec leur poings, faire des gestes vifs, en agitant les jambes, en voulant échapper. Elles doivent aussi mordre, tirer les barbes, crier, implorer humblement leur liberté. Les ravisseurs doivent les tenir dans les bras de diverses façons. Cela ne peut réussir sans montrer des jambes nues, des vêtements déchirés, des bras et des poitrines, et des gestes violents faisant gonfler les seins, tourner les cous et ouvrir les bras. Il y a également de la sueur, des morsures, des griffures, des coups. Tous ces gestes réunis ensemble produisent une plaisante vision de robustesse et de violence.[8]
Ainsi, ce n’est pas seulement la nudité qui serait émoustillante, mais les signes de résistance des femmes, dont leurs vêtements déchirés. D’autres historiens de l’art, comme Norman Bryson, nous disent que nous ne devrions pas lire dans ces représentations des scènes de violence sexuelle. Dans un article dans lequel il étudie deux versions de l’enlèvement des Sabines par Nicolas Poussin (1634–1635), Bryson nous explique son raisonnement. Selon lui, le fait que les hommes soient encore entièrement habillés et les femmes pas entièrement nues montre que la violation sexuelle n’a lieu qu’après les mariages. De plus, ce ne sont pas vraiment des viols, nous dit Bryson, parce que l’ordre est donné par le chef romain que l’on voit vêtu de nobles robes de cérémonie, et qui supervise le tout.[9]
[6] Leo C. Curran, « Rape and Rape Victims in the Metamorphoses », Arethusa 11, no. 1–2 (Printemps/Automne 1978), pp. 213–241 ; p. 227.
[7] Pour l’empathie masculine, ou « himpathy », voir Kate Manne, Entitled: How Male Privilege Hurts Women, New York, Crown, 2020.
[8] Jérôme Delaplanche, Ravissement : Les représentations d’enlèvements amoureux dans l’art de l’antiquité à nos jours, Paris, Citadelles & Mazenod, 2018, p. 80. Le jeu de mots dans le titre du livre de Delaplanche et l’euphémisme « enlèvements amoureux » pour relater un viol renforcent mon argument et démontrent la rémanence de ce positionnement dans les écrits depuis des décennies.
[9] Norman Bryson, « Two Narratives of Rape in the Visual Arts: Lucretia and the Sabine Women », dans Rape, dir. Sylvana Tomaselli et Roy Porter, Oxford/New York, Blackwell, 1986, pp.152–173; p.159. L’argumentation étonnante de Bryson a été commentée de façon incisive par Mary Beard (op. cit.), Diane Wolfthal (Images of Rape: The Heroic Tradition and Its Alternatives, Cambridge, Cambridge University Press, 2000) et Susanne Kappeler (« No Matter How Unreasonable », Art History, vol. 11, no 1, pp. 118–123), entre autres, ainsi que dans Ersy Contogouris, « Discursive Blurring in Representations of Clasical Rapes and Abductions », dans On the Nude : Looking Anew at the Naked Body in Art, sous la dir. de Nicholas Chare et Ersy Contogouris, Londres et New York, Routledge, 2022, pp. 55–66. À l’apologie de la violence sexuelle faite par Bryson et d’autres, il existe heureusement des contre-exemples, notamment dans les analyses des oeuvres d’Artemisia Gentileschi comme sa Susanne et les vieillards (1610).
En effet, Bryson écrit que, parce que Romulus est roi – ce qui est mis en évidence par ses vêtements – son action de donner le signal pour enlever les Sabines devrait être considérée comme un acte politique.[10] Dans ce cas, Romulus, mais aussi les hommes qui lui obéissent sont déresponsabilisés de leur crime. Dans cette interprétation – qui peut être décrite comme du gaslighting –, le vêtement ne sert donc pas seulement à vêtir le corps, mais à dissimuler la violence de l’acte sous un manteau de respectabilité.
Lucrèce, une femme de la noblesse romaine, est mariée à Lucius Tarquinius Collatinus. Tite-Live relate qu’ils sont dévoués l’un à l’autre et qu’elle est un parfait exemple de beauté et de pureté. Collatinus devant s’absenter, son cousin Sextus Tarquin se rend chez eux, où il est reçu comme il se devait de recevoir un invité. La nuit, muni d’une épée, il s’introduit dans la chambre de Lucrèce sans y être invité, menace de la poignarder si elle crie et tente de la forcer à se soumettre à lui. Devant son refus, il menace de la tuer, ainsi que son esclave et de placer leurs corps côte à côte sur son lit, afin de prétendre qu’il les avait surpris ensemble. Comme cette deuxième option la mettrait dans l’impossibilité de défendre son honneur puisqu’elle serait morte, elle cède. Le lendemain, elle fait revenir son mari et son père, leur relate ce qui s’est passé et déclare : « Bien que je m’acquitte du péché, je ne me libère pas de la peine ; aucune femme impudique ne vivra désormais et ne plaidera l’exemple de Lucrèce », puis elle se poignarde et meurt.
Titien montre le moment où Tarquin s’est infiltré dans la chambre de Lucrèce pendant qu’elle dormait et la menace. L’esclave est visible à l’arrière-plan. Le site web du musée Fitzwilliam, où se trouve le tableau, note l’importance des différents tons de rouge dans les vêtements de Tarquin, tout comme sa barbe et ses cheveux roux pour communiquer son « ardeur » : « “Inflamed” is an appropriate description of the thrusting Tarquin, for Titian dresses him in a variety of hot reds to emphasize his sexual ardour – look at his scarlet stockings, his crimson breeches, the red stripes on his sash, his reddish beard and hair. Even the shadows cast on the green valance are expressed in red. » [11] Cette prolifération de tons écarlates exprime ainsi la force de Tarquin, alors que c’est la nudité de Lucrèce qui est relevée. Recouverte, à peine, d’un simple drap, et ne portant que des bijoux, le corps de Lucrèce est décrit comme étant doux et sensuel, soit invitant.
La question du consentement ou non de Lucrèce fait de longue date l’objet d’un débat. Il pourrait sembler évident que, puisqu’elle a été contrainte de se soumettre à la volonté de Tarquin, on ne peut pas dire qu’elle ait consenti. Il ne peut y avoir de consentement sous la contrainte. Les spécialistes ont pourtant longtemps discuté de cette question, revenant sur la formulation de l’histoire, les derniers mots prononcés par Lucrèce, etc. Norman Bryson voit dans la nudité de Lucrèce un signe de son consentement : « in his presentation of Lucretia he [Titien] stresses themes which belong more to consent or seduction, than to forcible rape », et parmi ces signes, il mentionne « Lucretia’s nudity1». [12] La nudité de Lucrèce serait non seulement un signe qu’elle a consenti à avoir des relations avec Tarquin, mais qu’elle l’a séduit. Le manque de vêtements servirait donc à nous orienter vers le consentement.
Jérôme Delaplanche le dit clairement dans sa description du tableau de Pierre Paul Rubens dépeignant l’enlèvement d’Orithye par le dieu grec du vent du nord Borée (v.1615). Ce viol mythologique est peut-être moins connu que d’autres.[13] L’histoire commence de la même manière que beaucoup d’autres histoires de viols par des dieux : le vieux Borée voit la jeune Orithye, la désire, mais essuie un refus. Il la saisit contre son gré et s’envole avec elle, l’enveloppant dans un nuage, jusqu’à un rocher où il la viole. Les récits d’Apollonios de Rhodes et d’Ovide indiquent clairement qu’Orithye n’était pas consentante : Apollonios de Rhodes écrit que Borée l’a forcée à se plier à sa volonté, et Ovide, que Borée a eu recours à ses « armes, la rudesse et la violence, la colère et les dispositions menaçantes ».[14] Malgré ces indications claires qu’il s’agit d’un viol, Delaplanche propose une autre interprétation en se référent au tableau de Pierre Paul Rubens ; dans un passage curieux, il s’adresse d’abord directement à Orithye, puis parle d’elle à la troisième personne :
Mais pourquoi es-tu nue Orithye ? Qui a fait glisser ta chemise et ta robe ? Te voici dévêtue dans les bras du dieu. Est-ce lui qui a repoussé tes vêtements ou toi qui l’a tenté ? Cette nudité t’accuse. Ce corps dynamique, musclé et mouvant, cette peau tiède, lumineuse et luisante est d’une beauté insupportable. Orithye exhibe sa propre responsabilité.[15]
Après lui avoir demandé ce qui a fait qu’elle s’est retrouvée dévêtue, Delaplanche passe immédiatement en mode juge et juré, la déclarant responsable de son propre viol. C’est ici que l’on voit le caractère parfois pernicieux de la discipline de l’histoire de l’art, qui interprète et nous dicte, en quelque sorte, comment comprendre la scène devant nous. Alors que nous savons qu’il s’agit d’un viol, reconnu comme tel déjà dans l’Antiquité, l’historien de l’art introduit ici une brèche, un doute, et ce, alors qu’il écrit pourtant au 21e siècle, à une époque post-MeToo, durant laquelle de tels discours ont été désavoués. Continuant sur le sujet du viol d’Orithye, Delaplanche écrit, au sujet du tableau de Giovanni Battista Cipriani représentant cette scène (1745), qu’Orithye « se débat tant qu’elle peut. Mais l'érotisation du corps est toujours la même. Et le consentement toujours absent ».[16] Delaplanche reconnaît ici qu’il s’agit d’un viol, mais en tient Orithye responsable à cause de la façon dont le peu de vêtements qu’elle porte découvrent son corps.
Qu’il s’agisse des vêtements royaux de Romulus ou de la nudité de Lucrèce ou d’Orithye, Bryson, Delaplanche et d’autres historien·nes de l’art, dans leur interprétation qui tombe souvent dans le gaslighting, introduisent un flou, une marge de manoeuvre [17] qui permet de faire abstraction de la violence.
[10] « He is a king, and his action is more clearly considered policy and less like a starter’s pistol. » Bryson, op. cit., p. 159.
[11] The Fitzwilliam Museum, « Tarquin and Lucretia », https://fitzmuseum.cam.ac.uk/explore-our-collection/highlights/914 [consulté le 28 mars 2024].
[12] Bryson, op. cit., p. 170.
[13] On la retrouve entre autres dans les Argonoautiques d’Apollonios de Rhodes et dans Les Métamorphoses d’Ovide.
[14] « […] forced her to his will », 1.221 (https://topostext.org/work/126) [consulté le 30 mars 2024] et Ovide, Les Métamorphoses, VI, p. 683–707.
[15] Delaplanche, op. cit., p. 71.
[16] Ibid.
[17] C’est la meilleure traduction que j’ai trouvée pour ce que j’appellerais en anglais « wiggle room », un espace à l’intérieur duquel on peut se tortiller pour dire un peu n’importe quoi. Je remercie les collègues présent·es lors du colloque Vêtir, pour leurs commentaires enrichissants sur cette notion.
Les vêtements transmettent un flou dans la narration
Il nous faut plonger dans le 18e siècle pour étudier une des oeuvres qui rend le mieux compte de ce flou discursif à travers (entre autres) les vêtements : Le Verrou (v.1777–1778), réalisé par Jean-Honoré Fragonard (fig.1). Cela fait plusieurs années que j’enseigne ce tableau à des étudiant·es de premier cycle à l’Université de Montréal. On cherche ensemble à comprendre ce qui s’y passe d’après les indices que nous a laissés l’artiste. Est-ce un avant ou un après ? Est-ce une scène de séduction ? Une scène d’agression sexuelle ? Est-ce un « jeu de séduction » ? de galanterie ? La femme fait-elle « semblant de dire non alors qu’elle veut dire oui » ? Comment peut-on faire la part des choses ?
Figure 1
Jean-Honoré Fragonard, Le Verrou, vers 1777–1778. Huile sur toile, 74 x 94 cm. Paris, musée du Louvre.
Le tableau a été commandé vers la fin des années 1770 par le marquis de Véri, qui aurait probablement vu un des dessins de Fragonard connus aujourd’hui montrant une scène très similaire à l’oeuvre peinte (fig.2). Véri, décrit comme étant quelqu’un de « favorable à la cause libertine »[18], aurait alors demandé à Fragonard d’en peindre une version pour faire pendant à son Adoration des Bergers (v.1775). Si on a vite vu dans cette juxtaposition quelque chose de plutôt scandaleux, les historien·nes de l’art ont offert plusieurs explications : il s’agirait, par exemple, de deux pendants, l’un représentant l’amour sacré et l’autre l’amour profane ; ou la Faute et la Rédemption. Dans ces deux cas, il y a un sacrifice de la chair : du Christ d’une part et de la jeune femme de l’autre.[19] D’autres y reconnaissent une accointance avec les écoles italienne (Adoration) et hollandaise (Verrou), auxquelles Fragonard aurait emprunté pour créer un style entièrement français.[20]
Figure 2
Jean-Honoré Fragonard, Le Verrou (dessin), vers 1765. Craie rouge et encre brune, 24 x 36,5 cm. Collection particulière.
[18] Guillaume Faroult, « L’amour moralisé », dans Fragonard amoureux : galant et libertin, dir. Guillaume Faroult, catalogue d’exposition, Paris, Réunion des musées nationaux, 2015, p. 208.
[19] Ibid., p. 210.
[20] Pour cette analyse ainsi qu’un résumé des précédentes tentatives pour expliquer la juxtaposition, voir Julia Kloss-Weber, « Fragonard’s Companion Pieces for the Marquis de Véri : The Art of Pendants or a Transcultural Narrative of Modern French Painting », dans Networks and Practices of Connoisseurship in the Global Eighteenth Century, dir. Valérie Kobi, Kristel Smentek et Chonja Lee, Berlin/Boston, De Gruyter, 2024, pp. 171–188.
Dans une note d’un article récent portant sur ce tableau et son pendant, l’historienne de l’art Julia Kloss-Weber résume cette incertitude de la façon suivante :
Is the moment depicted thus only part of a love game? Or, does Fragonard not present us with an incipient rape after all? In my opinion, this is a pictorial representation of roles in a sexual code conceived and established by men at the time, which is so perfidious – and must therefore outrage us today – because it systematically thwarts a clear demarcation between these two possibilities.[21]
Je désire continuer dans la foulée de Kloss-Weber et d’autres, qui soutiennent qu’il n’existe pas de démarcation claire entre la possibilité du jeu amoureux et celle du début d’un viol. Et qu’on devrait s’en indigner. Or, démarquer clairement entre ces deux possibilités est justement ce qu’essayent de faire les critiques et historien·nes de l’art qui écrivent sur ce tableau depuis près de deux siècles et demi. Parfois, les écrits se rangent clairement d’un côté ou de l’autre, sans admettre la possibilité d’une ambiguïté. Ou alors, on admet qu’il y a flou, une imprécision, qu’il existe des indices faisant basculer d’un côté et de l’autre tout en essayant quand même de prendre position. On n’arrive pas à rester dans l’ambiguïté.
Un élément que l’on retrouve souvent dans les écrits sur cette oeuvre – et ceci est tributaire du fait que c’est une oeuvre qui est tellement ambiguë – est qu’il y a des contradictions au sein même des descriptions et/ou interprétations proposées. Martin Schieder, par exemple, écrit :
[…] [E]ncore en chemise et en sous-vêtement, le jeune homme s’étire le bras afin de pousser le verrou de la porte avec sa main droite, tandis que de l’autre bras il saisit la jeune femme par la taille pour l’attirer à lui. Elle semble vouloir échapper à son étreinte passionnée, détourne la tête, se sert de ses mains pour prévenir le rapprochement des corps ou empêcher son compagnon de verrouiller la porte. Assistons-nous à un tête-à-tête polisson […] ? c’est en effet ce qu’il semble, du moins à première vue. Ou bien l’artiste fait-il du spectateur non seulement le voyeur d’un acte de séduction tumultueuse, mais aussi le témoin d’une volupté débridée à laquelle la jeune femme se sent incapable de résister ? Se pourrait-il, enfin, que l’acte ait déjà été consommé et qu’elle ne fasse que tenter de retenir son amant un peu plus longtemps ? Fragonard s’en remet ici à l’imagination du spectateur pour compléter le scénario.[22]
Plusieurs questions se posent ici : « encore en chemise et en sous-vêtement » implique que la scène est interprétée comme l’après d’une activité sexuelle non définie. Schieder explique les éléments du tableau qui indiquent que la femme résiste à l’homme (« détourne la tête », « se sert de ses mains »), mais rien pour affirmer ensuite pourquoi il considère qu’elle « se sent incapable de résister », ni « que l’acte [a] déjà été consommé » ou qu’elle « [tente] de retenir son amant un peu plus longtemps ». Notons d’ailleurs que l’appeler « son amant » indique que Schieder a déjà décidé de la nature de la relation entre les deux. Dans la dernière phrase, l’auteur conclut que c’est au spectateur de « compléter le scénario » dans son imagination. Pourquoi un spectateur et pas une spectatrice ? Sans vouloir essentialiser les genres, on peut se demander si une femme compléterait la scène différemment que ne le ferait un homme. Mon but ici n’est pas de critiquer l’argument de Schieder, mais de montrer les diverses façons dont les sous-entendus et les semi-déclarations circulent dans la discipline et imprègnent nos compréhensions de ces oeuvres. L’ambiguïté de l’interprétation de Schieder vient du flou introduit par Fragonard lui-même dans la mise-en-scène du tableau quant à la narration et au consentement ou non de la jeune femme.
Ce flou joue un rôle important dans le discours sociétal sur les rapports sexuels, notamment entre personnes de sexe différent, et sur le consentement, au 18e siècle, quand le tableau a été peint, tout comme aujourd’hui, quand on le commente. Comme l’indique l’historienne de l’art Mathilde Léïchlé au sujet d’oeuvres représentant des scènes de violence à caractère sexuel : « L’ambiguïté inhérente à ces oeuvres fait souvent obstacle à un discours critique sur l’impact de ces imaginaires. »[23] Ce tableau s’inscrit en effet dans une culture visuelle plus large dans laquelle les scènes d’agression sexuelle sont légion, et où ces scènes sont vues, absorbées, reproduites, circulées, mais à peine reconnues comme telles. Ce phénomène se poursuit aujourd’hui, dans des médiums largement diffusés sur les réseaux sociaux, telle que la caricature. Quels sont donc les imaginaires dont il est question ? Et quel est leur impact ?
Dans Le Verrou, on voit un homme et une femme dans un intérieur dans lequel il y a un lit, indiquant qu’il s’agit probablement d’une chambre à coucher. L’homme, musclé, pieds nus et en sous-vêtements, a le bras gauche autour de la taille de la femme, et de la main droite essaie de pousser le verrou pour fermer la porte. La femme, complètement vêtue, porte une robe luxueuse et des chaussures. Elle est debout sur un pied, alors qu’un bout de sa robe repose sur le lit derrière elle, indiquant qu’elle était assise ou allongée et qu’elle vient à peine de se lever. Elle a la tête renversée en arrière. Sa main droite s’interpose entre son visage et le cou et menton de l’homme. Sa main gauche s’étire vers le verrou.
[21] Ibid., p. 173, n4.
[22] Martin Schieder, dans Au temps de Watteau, Chardin et Fragonard : chefs-d’oeuvre de la peinture de genre en France, dir. Colin B. Bailey, catalogue d’exposition, Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada, 2003, p. 290.
[23] Mathilde Léïchlé, « Brève histoire des images et imaginaires du viol au XIXe siècle », Malaises dans la lecture, 6 juin 2019. https://malaises.hypotheses.org/author/mathildeleichle#identifier_3_1078 [consulté le 18 mars 2024]
Derrière elle, un lit désordonné est recouvert de draps en soie qui rappellent la soie de la couche intérieure de la robe de la femme. Un énorme baldaquin en tissu rouge tombe lourdement du plafond et recouvre une partie du lit. Ces deux éléments de décor recouvrent la moitié du tableau. De l’autre côté du lit, une petite table avec une nappe, une pomme et une cruche renversée, ainsi qu’une chaise, elle aussi renversée, sur laquelle il semble y avoir une sorte de manteau ou un autre vêtement noir ou de couleur sombre. On voit une rose sur le lit, et, à la toute droite du tableau, un siège qui semble être mis à moitié devant la porte, et des roses par terre.
Regardons les éléments de la toile un par un. Le rouge foncé du baldaquin, qui recouvre près de la moitié de la toile, peut être associé, comme dans le Tarquin de Titien, à la passion, comme à l’agression.[24] La pomme, symbole biblique de la Chute d’Eden, fait ici référence à la chute de la femme, la perte de sa vertu. La pomme, rappelons-le, est aussi symbole d’Ève, la séductrice : est-ce donc la femme qui a séduit l’homme ici ? La cruche renversée et les roses par terre sont d’autres symboles de la chute de la femme : sont-ils alors, avec la chaise par terre, des signes de passion ou de violence ?[25] Ces éléments indiquent certainement qu’il s’est passé quelque chose dans cette chambre, mais on ne sait pas quoi. La puissante ligne diagonale de lumière allant de la pomme au verrou dénote un mouvement inarrêtable, indiquant sans doute que la scène n’est pas terminée, et invitant les regardeur·euses à la compléter.
Le verrou est lourd de signification.[26] Alors qu’il est censé servir à protéger la femme de l’extérieur (Molière y fait référence de façon comique dans L’École des maris : « les verrous et les grilles / Ne font pas la vertu des femmes ni des filles »)[27], il est ici un des éléments qui servent à piéger la femme. L’impression qu’elle est coincée vient également du meuble devant la porte, mais aussi des tissus voluptueux de la robe qu’elle porte et des draperies du lit derrière elle ; ce sont autant de façons dont les vêtements et les draperies contribuent au sens de l’oeuvre. La femme ne peut pas s’échapper. Le verrou, titre du tableau[28], devrait nous offrir des pistes d’interprétation, mais ce n’est pas le cas. Dans son film sur Le Verrou, Alain Jaubert affirme voir un lien clair entre le verrou et le viol du fait d’expressions qui emploient ce mot : « […] rompre le verrou, faire sauter le verrou, dit-il, l’instrument appelle des images de viol ».[29]
[24] Kassia St Clair, The Secret Lives of Colours, Londres, John Murray, 2016, p. 136.
[25] Pensons aussi à La cruche cassée de Greuze (v.1771–1772), dont Véri possédait une version.
[26] Alors qu’en français, le mot verrou semble ne désigner que cet objet spécifique qui sert à fermer une porte, en anglais, le mot bolt a d’autres significations qui sont également intéressantes lorsqu’il est question d’interpréter le tableau de Fragonard. Par exemple, le terme a bolt of fabric peut créer une relation entre le verrou et l’immense quantité de tissu et de drapés dans la scène ; le verbe to bolt (s’enfuir) peut quant à lui souligner ce que la femme ne peut pas faire à cause du verrou qui est en train de se refermer et des tissus qui la retiennent. Je remercie Rose MacLaren d’avoir suggéré différentes significations de ce mot.
[27] Molière, L’École des Maris, 1661. I, 2 (Ariste), et III, 6 (Sganarelle).
[28] Je n’ai pas réussi à trouver de preuves que c’est le titre que Fragonard lui a donné ; cependant, l’on peut affirmer qu’il est connu sous ce titre dès 1784, car on le retrouve sur la gravure de Maurice Blot, ainsi que dans les journaux.
[29] Alain Jaubert, L’amour dans les plis – Jean-Honoré Fragonard, Le Verrou (réal. Alain Jaubert, 1991).
S’il y a suggestion de viol, l’action de fermer le verrou, métaphore du sexe masculin, ne confirme ni n’infirme le consentement de la femme. De plus, s’il s’agit en effet d’un avant, il serait opportun de fermer le verrou pour ne pas se faire surprendre, mais le lit est déjà défait, l’homme a enlevé ses vêtements, la chaise à l’avant-plan est renversée. Et si c’est un après, ce qui serait étrange puisque la femme est encore entièrement vêtue, jusqu’aux chaussures, ce pourrait être un signe qu’elle ne veut pas qu’il parte, ou alors qu’elle regrette d’avoir consenti et qu’elle veut s’assurer de sa discrétion. En outre, le verrou lui-même semble trop haut placé pour que la femme puisse l’atteindre facilement, et il ne semble pas que de tels verrous aient été communs dans les chambres à coucher du 18e siècle. La femme est-elle donc en train d’accompagner le geste de l’homme pour fermer le verrou, ou essaie-t-elle de l’arrêter ? Nous tournons en rond.
Parmi d’autres éléments de la scène qui contribuent au flou narratif, mentionnons le contraste entre, d’une part, le caractère dépouillé des murs de la chambre et le fait que c’est une porte simple et non double, qui indiqueraient que nous nous trouvons peut-être dans une mansarde ou une chambre de bonne, et, d’autre part l’immense drapé du baldaquin et le luxe des draps en satin. Si les drapés ne nous éclairent pas sur la narration de la scène, ils étaient utilisés dès 1784 pour identifier le genre du tableau. En effet, un débat a lieu dans Annonces, affiches et avis divers au sujet de la gravure réalisée par Maurice Blot d’après le tableau.[30] L’Abbé de Fontenai admire les multiples qualités de la gravure même si elle ne « contribuera pas à la réforme des moeurs ». Il poursuit : « Les Grâces toutes nues de l’Antique sont bien plus décentes que ce jeune homme & cette jeune fille, tout habillés qu’ils sont. » Fontenai estime par ailleurs que le graveur aurait dû mieux différencier entre les diverses « étoffes » représentées (le « tapis de la table, les rideaux du lit, les couvertures »). Deux semaines plus tard, un certain M. de Saint Félix répond qu’ayant vu le tableau, il peut attester de la fidélité de la reproduction gravée. Il explique que puisque Fragonard devrait être considéré comme un peintre d’histoire, il ne lui était pas tenu de différencier les étoffes comme l’aurait fait un peintre dans un autre genre. Fontenai réplique que le tableau n’est pas un tableau d’histoire, mais une « bambochade », et qu’il aurait donc été impératif que le traitement des drapés reflète ce statut. Débattre sur le genre d’un tableau était un sujet de prédilection au 18e siècle ; dans le cas présent, on assiste à la sublimation d’une image de violence sexuelle en un débat sur le genre et le rendu technique, un exemple – ici datant de l’époque où le tableau a été réalisé – de l’évitement de la violence sexuelle représentée, et de la conversion esthétique du viol en théorie artistique.
S’il s’agit en effet d’un tableau d’histoire, et que le tableau a une portée morale, quelle est cette morale ? Est-ce une prise de position contre les personnes qui s’adonnent aux plaisirs de la chair ? Contre la violence de l’homme ? Difficile de trancher.
L’expression sur le visage de la femme n’est pas non plus facilement déchiffrable. Elle ne semble pas acquiescer, se détourne de l’homme, mais n’a l’air ni très effrayée, ni surprise, ne semble pas être en train de crier. Il y a une contradiction entre son visage et son avant-bras, lequel par son emplacement repousse la tête de l’homme, ainsi qu’avec l’angle de sa propre tête, à 90o de son corps pour vraisemblablement s’éloigner le plus possible du visage de l’homme. En comparant Le Verrou avec des scènes de viol comme celle de L’enlèvement de Proserpine par Pluton par Bernini (v.1621–1622), on retrouve le même angle de la tête des deux femmes, mais le visage de Proserpine exprime, lui, une terreur indéniable.
Comment se fait-il que la femme soit entièrement habillée, et que l’homme ne soit qu’en sous-vêtements et pieds nus ? Où sont ses chaussures et ses vêtements ? Et comment se fait-il que le bout de la robe de la femme soit encore sur le lit ? Serait-il entré dans la chambre (à qui est la chambre ?) déjà déshabillé ?[31] Pourquoi les draps sont-ils en désordre ? Si nous nous retrouvons invariablement devant le même mur d’interprétation, nous devons nous rappeler que nous sommes dans une fiction, il n’y a pas besoin d’y avoir une résolution à cette question. Il s’agit simplement de reconnaître le rôle que joue ce flou dans l’histoire de l’art dans la construction de nos imaginaires par rapport au consentement.
En effet, je ne cherche pas à résoudre ces contradictions. Au contraire, mon argument est qu’il n’est peut-être pas censé y avoir une cohérence narrative. En comparant le tableau final avec un dessin préparatoire – possiblement celui qu’avait vu Véri –, on note plusieurs différences qui suggèrent que l’ambiguïté était voulue par Fragonard. Dans le dessin, les visages sont beaucoup plus rapprochés, la tête de la femme est à un angle moins abrupt, elle regarde l’homme du coin de l’oeil, et elle est plus souriante que dans le tableau final. Elle est plus éloignée du lit, ce qui fait que le bout de sa robe ne repose pas dessus. Sa main gauche est posée sur le bras droit de l’homme et ne tend pas vers le verrou, il y a des vêtements par terre qui pourraient appartenir à l’homme, il y a des tableaux au mur, il n’y a pas de siège devant la porte ni de pomme. Le baldaquin prend beaucoup moins de place, et l’on ne retrouve pas cette diagonale qui donne l’impression d’un mouvement irrépressible. La comparaison entre le dessin préparatoire et l’oeuvre finale nous permet de rendre compte de choix qu’a faits Fragonard. Chaque élément possède une charge symbolique, et l’ambiguïté de la scène est accrue : davantage d’éléments remettent en question le plein consentement de la femme, mais sans non plus indiquer clairement qu’il s’agit d’une scène de viol.[32]
Pourquoi ce flou discursif ? Pour l’historienne Michelle Perrot, « [l]a troublante indécision du tableau crée son pouvoir de suggestion libertine ».[33] En effet, le manque de clarté dans la narration semble être au coeur du libertinage. Catherine Cusset explique que les romans libertins s’intéressent justement à ces moments où l’on est déchiré·e. D’après elle, beaucoup de romans libertins sont incomplets. Elle précise : « A conclusion would bring a resolution. Libertine writers show that resolving the contradictions in the human mind is not so simple since humanity implies contradiction. Truth lies not in conclusion, but in the moment at which all contradictions are revealed. »[34] Le flou ne serait donc pas causé par manque de clés de lecture, mais serait voulu et correspondrait à une des caractéristiques que l’on retrouve dans les romans libertins.
Ces derniers, écrits par des auteurs tels que Crébillon, insistent sur une certaine construction de la sexualité féminine : les femmes ne peuvent pas déclarer leur désir, car ceci serait mal vu. Elles doivent résister, ou feindre de résister, afin de démontrer qu’elles sont vertueuses. Même si la résistance est réelle, elle sera donc interprétée comme une feinte. Cette idéologie crée ainsi une brèche, une marge de manoeuvre, dans laquelle on peut (se) convaincre de toutes sortes de choses et notamment du désir ou non de la femme. Pire que cela, si une femme résiste, si elle se débat, ceci ne contribuerait qu’à émoustiller l’homme davantage, comme nous l’avons noté avec Leo Curran. En d’autres mots, il n’y a rien que les femmes puissent faire pour convaincre qu’elles ne désirent pas un homme ou pour échapper à une agression. Et c’est dans cette situation toujours dangereuse que se trouvent les femmes.
[30] Voir Abbé de Fontenai, « Gravure » dans Annonces, affiches et avis divers, ou Journal général de France, 8 mai 1784, p. 272 ; M. de Saint Félix, « Lettre à M. l’Abbé de Fontenai, Auteur de ces Feuilles », ibid., 22 mai 1784, p. 300 ; et Fontenai, « Réponse à la Lettre précédente », ibidem.
[31] Ceci rappelle la scène dans Hamlet, où Ophélie relate à son père Polonius que Hamlet est entré dans sa chambre, tout déshabillé, cherchant à la séduire, et qu’il l’a attrapée au poignet (un geste qui traditionnellement, représente un acte de violence sexuelle), mais qu’elle lui a fait comprendre qu’elle ne voulait rien savoir. Polonius lui répond qu’en effet, Hamlet est devenu fou parce qu’elle a refusé ses avances. William Shakespeare, Hamlet, II, 1.
[32] Cette ambiguïté n’est pas rare dans l’oeuvre de Fragonard. Voir également Le Serment d’amour (s.d.), La Culbute (1766), Les Débuts du modèle (1769), ou La Résistance inutile (v.1770–1773).
[33] Michelle Perrot, Histoires de chambres, Paris, Éditions du Seuil, 2009, p. 580.
[34] Catherine Cusset, « Editor’s Preface : The Lesson of Libertinage », Yale French Studies, no 94, 1998, pp. 1–14.
Si l’on reconnaît que la femme dans Le Verrou a peur ou qu’elle résiste, le flou discursif permet à chaque regardeur·euse, à chaque auteur·rice d’apporter sa propre interprétation de ce qui lui fait peur (perte de virginité ou viol) ou ce à quoi elle résiste (son propre désir qui mènera à sa chute ou le viol).
L’imaginaire ainsi créé – et permis – s’est traduit, en 2015–2016, par le choix de mettre Le Verrou au centre de la campagne de promotion de l’exposition Fragonard amoureux. Galant et libertin au Musée du Luxembourg à Paris. On retrouvait en effet des reproductions de cette oeuvre sur la page de couverture du catalogue d’exposition et sur d’autres publications autour de l’exposition, ainsi que sur des affiches annonçant l’exposition dans l’espace public (fig. 3). La juxtaposition du mot « amoureux » avec une scène où le consentement de la femme n’est pas clair est une indication d’une célébration du flou concernant le consentement et d’une conception de la sexualité où amour et agression (de l’homme) sont inextricablement liés.
Figure 3
Page couverture du catalogue d’exposition et autres images publicitaires autour de l'exposition Fragonard amoureux au musée du Luxembourg, Paris, 2015–2016.
Le Verrou se retrouve également sur la couverture de plusieurs livres, dont la publication du texte sur Fragonard par les frères Goncourt et de très nombreuses éditions des Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, publié en 1782, donc cinq ans environ après Le Verrou (fig. 4). Il serait donc impossible que Fragonard ait été inspiré par Les Liaisons dangereuses pour réaliser le Verrou, quoique l’inverse est possiblement vrai. Nous sommes ainsi saturé·es par des reproductions du Verrou. Fragonard ne pouvait évidemment pas prédire que son tableau se retrouverait sur les murs du métro parisien ni sur les couvertures de livres qui n’avaient pas encore été écrits, mais l’oeuvre existe en-dehors de son contexte de production. Le fait que le tableau est reproduit partout, et que l’imaginaire auquel il participe est ainsi construit et reconduit, a un impact important. Entre les mains d’adolescent·es du secondaire qui sont à un moment de leur vie où leur sexualité se développe et où iels font leurs premières expériences sexuelles et connaissent leurs premières relations amoureuses, cette normalisation ou banalisation d’une image de violence fondée sur le genre – juxtaposée, de plus, au mot « amoureux » dans le cas des publicités entourant l’exposition[35] – a un effet délétère sur leurs imaginaires. Elle leur apprend que le non-consentement est acceptable, que la zone de flou qui existe souvent dans les relations entre les gens se traduit en un feu vert, renforçant ainsi un sentiment que tout est permis aux jeunes garçons, que les filles ne sont pas maîtresses de leur sexualité ni de leur corps. Ceci n’est pas un phénomène isolé.
Figure 4
Sélection de pages couverture du roman de Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, 1782.
[35] Pour Valérie Rey-Robert (Une culture du viol à la française : du « troussage de domestique » à la liberté d’importuner, Paris, Libertalia, 2020, p. 211), de telles décisions servent à alimenter la culture du viol.
[36] Voir Maggie Nelson, The Argonauts, Minneapolis, Graywood Press, p. 66–67.
Dans Le Verrou, il ne s’agit donc pas de résoudre la question de savoir s’il y a ou non consentement, mais de considérer les différents éléments du tableau afin de reconnaître la création d’un flou discursif (au 18e siècle comme aujourd’hui) et le rôle pernicieux qu’il joue quant à la compréhension du consentement – dans le tableau et de façon générale – par les observateur·rices du tableau. Si l’ambiguïté quant au consentement ou non de la jeune femme est ici inhérente au tableau, dans le cas d’autres oeuvres, ce sont les historien·nes de l’art qui ont créé un flou par leurs interprétations de l’oeuvre. Depuis des décennies, sinon des siècles, et dans une quasi-homogénéité déconcertante, iels se sont rendu·es complices des violences sexuelles représentées. Iels ont perçu dans le peu de vêtements portés par des femmes violentées dans ces tableaux une preuve de leur consentement, ou une légitimation de la violence qu’elles subissent. Les vêtements portés par les hommes, quant à eux, sont vus comme des signes de leur force politique ou militaire, ou encore de l’ardeur de leur désir. Leurs actes sont ainsi légitimés, faisant appel à une empathie masculine des spectateurs envers les agresseurs. Les débats sur le rendu esthétique des tissus et des draperies détournent notre attention de la violence représentée. Toutes ces lectures ont pour but d’encadrer notre compréhension des scènes de violence sexuelle et de justifier la charge érotique que certains spectateurs pourraient ressentir. Ainsi, si, comme dans L’enlèvement des Sabines de Pietro da Cortona, les vêtements et les draperies peuvent indiquer une agression sexuelle, ils peuvent aussi contribuer à la création ou à l’exploitation d’une marge de manoeuvre à l’intérieur de laquelle est nourri un imaginaire où la notion de consentement est constamment brouillée.
Biographie
Ersy Contogouris est professeure d’histoire de l’art à l’Université de Montréal. Ses recherches portent principalement sur l’histoire de l’art des 18e et 19e siècles, et sur l'histoire de la caricature et de la satire graphique, qu’elle étudie notamment à la lumière d’approches féministes et queer. L’éthique du care est au centre de son enseignement et de ses préoccupations de recherche. Elle est l’autrice de Emma Hamilton and Late Eighteenth-Century European Art : Agency, Performance, and Representation (Routledge 2018), et a codirigé les ouvrages On the Nude : Looking Anew at the Naked Body in Art (avec Nicholas Chare, Routledge 2022) et Pour des histoires audiovisuelles des femmes au Québec : confluences et divergences (avec Julie Ravary-Pilon, Presses de l’Université de Montréal 2022). Elle travaille présentement sur un livre portant sur les représentations de violence sexuelle dans la caricature.
Article Citation
Contogouris, Ersy. « Que portait-elle ? Le rôle du vêtement dans les présentations de violence sexuelle ». Corpus textile, numéro spécial de Fashion Studies, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 1-21. https://doi.org/10.38055/FCT040107
Copyright © 2025 Fashion Studies - All Rights Reserved
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license (see: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)